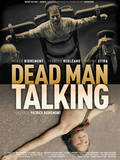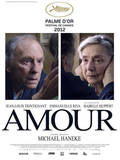VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 27
Publié le 29 novembre 2012
Le critique, toujours d'abord spectateur, ne peut qu'être saisi de stupeur et tremblements à l'idée d'entamer quelques lignes sur le cinéma de Guy Debord, a fortiori le toujours-brûlant « In girum imus nocte et consumimur igni », son dernier film. Celui qui se rêvait en anti-cinéaste, réfractaire à toute réception possible de ces films (son court-métrage « Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur le film "La Société du Spectacle" » le martèle avec une méchante conviction : les critiques sont qualifiés de « crétins », d' « apprentis bureaucrates », de « ramasse-miettes » ; ici il confie « Je me vois donc placé au-dessus de toutes les lois du genre. Aussi, comme disait Swift "Ce n'est pas une mince satisfaction pour moi que de présenter un ouvrage absolument au-delà de toute critique" »), qui n'a jamais tourné un seul plan de sa vie, cinéaste du banc titre et de la voix-off, inventeur du sampling en cinéma, apparait rétrospectivement dans une Histoire du cinéma encore à écrire comme le symbole ou l'exemple (seul, mais l'Histoire aime les héros solitaires) d'une forme spécieuse d'underground à la française au sens premier, straubien du terme, un cinéma placé en deçà du reste de la production, sous les autres, étouffé, stratifié, sous-prolétaire (« (...) je préfère rester dans l'ombre, avec ces foules, plutôt que de consentir à les haranguer dans l'éclairage superficiel que manipulent leurs hypnotiseurs. ») mais engrais d'une pensée assourdie qui peine toujours à se faire entendre, si tant est qu'elle parvienne aux oreilles. "In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni" n'a rien du film-testament qu'on attend des grands auteurs classiques : c'est plutôt, sans vraiment exagérer, un film-kamikaze, une répétition de son futur suicide. Suicidaire, l’œuvre, toujours en phase avec la vie, de Guy Debord l'aura été depuis les poussées lettristes des "Hurlements en Faveur de Sade" en 1952 (Debord avait 21 ans). Le cinéma était-il commencé ? Il était déjà fini, bon à enterrer, déjà enseveli sous ces couches de discours que l'auteur levait dans les fulgurantes formules énoncées de sa voix cynique, monocorde et nasillarde. Ici Debord évoque sa jeunesse, son amour pour un Paris populaire et beau, défiguré et détruit petit à petit par un monde nouveau qui le dégoûte (thème déjà de « Sur Le Passage de Quelques Personnes A Travers Une Assez Courte Unité de Temps » (1959)) et pour lequel son indignation se soulève, comme à la base de l’œuvre elle-même. C'est aussi le temps du bilan sur l'après-mai 68, sur l'I.S. Sa génération, qui « tourne en rond dans la nuit et est dévorée par le feu » a si « parfaitement la forme et le contenu de la perdition » de la phrase originelle en latin, palindrome parfait enroulé sur lui-même, labyrinthe sans issue. Le désespoir de laisser ce monde est absolu (on se souviendra toujours de ce travelling sur l'eau d'un canal de Venise, débouchant sur la lagune à perte de vue), mais ne s'agit-il pas aussi du film le plus sentimental de son auteur, qui loin de s'abandonner au rejet sardonique de son époque lui préfère la lucidité douloureuse, la nostalgie gonflée de larmes de regret, du visage de l'homme âgé contemplant des clichés de lui jeune ? « L'ordre règne et ne gouverne pas. La perfection du suicide est dans l'équivoque » disaient deux des voix de "Hurlements...". Non-réconcilié : de la Nouvelle Vague Straub était l'objecteur de conscience, Garrel le poète ; Debord sera l'imperturbable et pince-sans-rire trouble-fête, renvoyant dos à dos l'un contre l'autre, les tendances et les modes, l'art et le spectacle. « Tout contre » (comme Groucho Marx), Guy Debord a inventé le cinéma d'arrière-garde. Ce que Mai 68 a porté comme espérances se devait, dix ans plus tard, passer à la caisse, avant de passer à la casse. La sagesse ne reviendra jamais : tout est encore-toujours « à reprendre depuis le début ».


Publié le 25 novembre 2012
Ce qui préoccupe Assayas, notoirement, c'est le mouvement. Le mouvement des idées, des êtres dans leur époque, le mouvement des choses : le cours de la vie. Si les personnages sont sensiblement similaires et la charge tout aussi autobiographique, le spectral et gothique « L'eau Froide » (1994) a laissé place à la nostalgie feutrée et à l'internationalisme touristique (une visite à Pinewood, en Ardèche, en Toscane, à Florence, Haarlem) d'Après Mai, chaleureusement éclairé par Eric Gautier (Taking Woodstock, On The Road, les derniers Resnais). Malheureusement, on ne trouve dans Après Mai que deux séquences, l'une crépusculaire et l'autre nocturne, qui parviennent à combiner célérité du déplacement et brusque accès à l'émotion. La première est une scène de fête dans une grande maison au son du « Abba Zabba » de Captain Beefheart, bientôt éclairée par des feux de joie. Gilles et Laure s'isolent dans un petit jardin en forme de paradis perdu à la faveur d'un ample mouvement de grue qui les perd un long moment derrière les branchages. Elle choisit un dessin de Gilles, lui le brûle pour qu'elle reste la dernière à l'avoir regardé, ils s'allongent dans l'herbe. Il s'en va, elle en plein bad trip monte à l'étage et lorsque l'incendie l’accule, elle se défenestre. Mais la caméra a suivi le personnage dans la maison jusqu'à s'étourdir, et créer un déplacement hallucinogène, une errance fébrile au son du « Why Are We Sleeping? » de Soft Machine qui en raconte plus long sur l'époque que beaucoup de scènes de dialogue que Assayas met laborieusement en scène. La seconde intervient plus tôt, lorsque la bande décide d'aller taguer leur lycée pour protester. La grâce chorégraphique des ombres inquiètes qui sillonnent la cour est interrompue par l'arrivée des vigiles qui se mettent à les pourchasser dans les rues calmes. Rupture de rythme, dispersion et retour à la course introductive, chargée d'une fièvre dont le reste du film manque.
Le point commun de ces deux scènes est un mouvement qui suit les personnages d'en haut, un même déplacement latéral et perte momentanée de repères dans le feuillage touffu des arbres qui métaphorise involontairement la dissolution des caractères dans le paysage auquel procède le film.
Même l’impressionnante baston qui ouvre le film, qui oppose des CRS franchement SS à un groupe de jeunes manifestants et où se tissent en contrebande les croisements de personnages qu'opérera ensuite le récit n'est mémorable que pour sa violence. Assayas n'est ni un cinéaste du plan ni de la scène, il serait plutôt un cinéaste de la séquence ou mieux: de l'épisode (d'ailleurs, il a rendu hommage au maître du feuilleton, Louis Feuillade, dans « Irma Vep »). Son film est structuré en une série de « tableaux » d'une vingtaine de minutes chacun, tous clos par un fondu au noir qui en dit aussi long sur l'indécision à couper et à ellipser franchement que sur l'inachèvement intrinsèque de chacune de ces capsules (et dont le charme est très divers, mention spéciale pourtant à l'apparition/hommage d'une figure paternelle, producteur à l'ORTF, nuancée et drôle). Après Mai s'absorbe trop longtemps dans des effets de reconstitution, certes soignés, mais qui ne dépareillent pas de n'importe quel téléfilm « en costumes ». En capitalisant ainsi sur la nostalgie à coups de scènes maigrement jointes sensées en raconter long sur l'époque et bardées d'oripeaux d'apparat (ah, on pouvait acheter la presse libre au kioske ! Ah, ils mixaient la colle avec du verre pour empêcher qu'on retire leurs affiches ! Ah, la belle ronéotypeuse avec laquelle ils imprimaient leur fanzine, etc.), Assayas fige les comportements dans une impression, bien paradoxale, de stagnation descriptive qui joue contre la dynamique qu'il tente d’insuffler par l'hyper-mobilité de son appareil. Le problème avec le mouvement continuel imprimés à ces héros (pas habiles mais agiles), c'est qu'à force de ne jamais s'attarder sur eux (et sur leurs désirs et leur positionnement politique, exposé très schématiquement : voir les discussions des étudiants en AG ou les débats entre cinéastes militants en Italie), les choses et les êtres ne sont que frôlés, les notations s'entassent sans se ramasser et tout glisse sur une surface lisse alors qu'Assayas croit nous en révéler les aspérités. S'il s'agissait de « Traduire le vent invisible par l'eau qu'il sculpte en passant » (Bresson), les premières heures de la décennie 70 pour la jeunesse ici représentée à grands renforts de propositions capillaires irritantes de contemporanéité, de chemises ouvertes, de chapeaux excentriques et de pins n’achoppe sur aucun « punctum », sur rien de poignant qui viendrait en fixer la mémoire comme sur un instantané d'époque (en passant de la nostalgie à la mélancolie). La bande originale, pourtant sélectionnée avec une minutie et un goût qu'on aimerait plus constant dans le cinéma français (Captain Beefheart, Nick Drake, Soft Machine,...) ne vient qu'impulser quelques moments du montage d'un vernis d'authentique qui fait parfois cruellement défaut à l'image ou aux sentiments mal drainés par des silhouettes de personnages, figures trop statiques dans un paysage qu'elles n'habitent jamais (à force de trop bouger, exception faite de la toujours admirable Lola Créton). Patrocle a raison de s'interroger sur l'unanimité critique pour un film si terne, si pauvre en émotions, si inégalement interprété (Carole Combes, catastrophique ; heureusement qu'elle se déshabille rapidement) alors que cette même critique en ignore superbement d'autres plus habités. On aura donc raison de préférer l'(affect) originel ("L'Eau Froide") à cet addendum dispensable et discursif à la série « Tous les garçons et les filles de leur âge... ».
Publié le 19 novembre 2012
Sensation première : jouissance déjà nostalgique, embaumée, digérée par l'époque en tout cas, de retrouver le grain, le piqué moindre et le principe d'incertitude de netteté du 16mm. La projection est certes digitale, mais quelque chose filtre, vibre encore du passé, et les palpitations des sels d'argent nous paraissent encore plus vivifiantes que lorsqu'on les avaient laissées.
Le film prolonge ses sensations. Douloureusement inspiré au réalisateur par une relation étendue sur dix ans avec un consommateur régulier de crack, Keep The Lights On est le récit des temps forts et des éclipses de cet amour, de ses corps-à-corps passionnés et espiègles et de ses absences intolérables, du plein et du manque, etc. sur le mode du carnet de notes intime, mais heureusement tenu à bonne distance de toute complaisance possible. La réussite est d'autant plus frêle, surprenante et timide qu'elle s'arc-boute en permanence sur le violon chevrotant et la voix tremblée de Arthur Russell, situés hors du temps et presque de l'espace, dont les ballades concordent avec les longues déambulations somnambuliques des personnages dans la ville. La plus belle scène (la plus périlleuse aussi) fait se retrouver les deux amants Erik (Thure Lindhardt) et Paul (Zachary Booth) dans une chambre d'hôtel que ce dernier refuse de quitter. Paul demande à Erik de partir pour éviter de lui faire de la peine. Il commence alors à fumer son crack et recevoir un jeune prostitué. Erik attend dans le salon, hésite en entendant les râles de Paul, brûle un peu sa silhouette dans la lumière du dehors, puis retourne dans la chambre sombre. Il attrape la main de son compagnon pendant que le jeune prostitué le sodomise, dans un geste d'une infinie affection et tendresse. La réussite d'une pareille scène est possible par la distance respectueuse que Sachs impose avec ses sujets, mais aussi à ses sujets entre eux : Erik et Paul restent, d'un bout à l'autre de la décennie, qu'ils se disputent sur le statut de leurs métiers respectifs ou passent un temps considérable au lit, des mystères l'un pour l'autre, des effigies autant que des êtres opaques et insaisissables, et bientôt des fantômes. Forme elliptique et allusive, trajet d'une histoire d'amour sur dix ans racontée comme un « festival d'affects » barthésien, ce Keep The Lights On partage beaucoup avec le Laurence Anyways de Xavier Dolan, promenade au ressenti, par à-coups dans une décennie d'un « ni avec toi ni sans toi » invivable, sauf qu'ici la mode majeure de l'époque ne l'emporte jamais sur le mode mineur de l'intime. Ce cinéma de chambre évoque avec un luxe inouï de détails les sentiments en les ornant d'un réalisme photographique cru et de notations sur un quotidien qui tend vers les sommets de l'état de grâce (fussent-ils le fond de la dépression).
Et si Sachs cite Nolot ("Avant Que J'oublie" et ses scènes de sexe filmées comme n'importe quelle autre scène) et Pialat ("L'Enfance Nue" et sa construction par événements successifs, par ricochets, association), c'est à Garrel qu'on pense le plus évidemment, la lumière crue et blafarde de New York au petit matin saisie par Thimios Bakatakis, le chef opérateur grec de "Kynodontas" et "Attenberg". Ira Sachs s’embarrasse du sentiment d'abandon, de la puissance douloureuse du souvenir sur l'euphorie du moment vécu en lui-même. Le parallèle avec "Shame" de Steve MacQueen (où l'homosexualité était associée sans plus de précautions au fin fond de la déchéance), autre ballade solitaire dans New York dont Keep The Lights On est l'antithèse absolue, permet de soulever ce qui éclaire ce film, à savoir cette lumière crue, son manque d'afféterie, sa mélancolie intime et pas du tout sociétale, son absence d'effets de manche ostentatoires. Sachs s’embarrasse de sentiments, et pas de formes apprêtées de mise en scène, et c'est bien là que le cinéma gagne.
Keep The Lights On et son spleen garrelien ne sortiront pas sur grand écran en Belgique, et c'est bien dommage.
Publié le 13 novembre 2012
C'est la revanche des comédiens de pub. Ridremont, Couchard, Leborgne, Efira : tous condamnés (au mieux) à des seconds rôles dans des films de seconde zone (et je ne parle pas de protection des DVD), bien décidés à se tailler une place au soleil (petite alors) par l'entremise du premier qui a réuni tout le monde dans un exercice de style en forme d'idéal collectiviste où chacun aurait son temps d'écran bien délimité, son petit rôle qui troquerait dix minutes de cinéma mal payées contre leur dix secondes d'antenne bien rémunérées. François Berléand, le bon pote de tout le cinéma francophone, vient compléter les rangs et il y a aussi Christian Marin, mais on est au regret de constater qu'il ne ressemble qu'à un ersatz mou et dégonflé de Michel Piccoli, qu'il imite péniblement jusque dans son souffle et ses sourires carnassiers. Mais après tout, si l'entreprise est sympathique et relativement sincère, pourquoi pas ? Eh bien parce que, comme dans le Ozon, ça ne tient pas les promesses énoncées dans le pitch et que le film se vautre rapidement (sursis : 10 minutes mémorables sans dialogue) dans l'indécision la plus plate, hésitant entre différents tons, genres, situations (noms, accents et décors belges/ambiance néo-noir américain, drame/comédie, farce/esprit de sérieux moralisant, satire/réalisme : ce genre de grands écarts risqués sinon impossibles que seuls les grands cinéastes peuvent concilier). Une authentique bonne idée suffit-elle à faire un film ? Oui, mais encore faudrait-il qu'elle soit tenue jusqu'au bout! Ici, le condamné passe à l'arrière-plan après le premier acte, et ce qui aurait pu être une variation intéressante sur les Mille et Une Nuits dérape, parce que Ridremont n'a tout simplement pas confiance en lui et surcharge la barque d'une tonne de personnages mal croqués (la fille du directeur de la prison, l'ange gardien) et y greffe une série de problématiques annexes, du politique (les réélections du gouverneur local) au médiatique (show télévisé) qui tendent toutes vers l'éparpillement. On lui sait gré de nous épargner le coup de l'erreur judiciaire mélodramatique, mais tous les autres clichés sur le « film de condamné à mort », genre archi-balisé s'il en est (Beyond a Reasonable Doubt (1957), The Thin Blue Line (1988), Krótki Film o Zabijaniu (1988), True Crime (1999), Into The Abyss (2011) pour ne citer que les meilleurs) s'y retrouvent. Quand Ridremont aura appris qu'une caméra peut s'utiliser autrement que comme un miroir (au vu des complaisants gros plans qu'il se réserve), les quelques bons moments de son scénario cesseront d'être noyés dans une auto-indulgence pour son égo de acteur-scénariste-réalisateur. Les dialogues, écrits avec une volonté de bon-mot franchouillard ou de punchline hollywoodienne assez préhistorique (on les croirait presque mal traduits de l'américain) achèvent de rendre excessivement laborieux le déroulement du récit, quand on ne se demande tout simplement pas si les tirades des acteurs vont déboucher sur une de leurs harangues commerciales trop (re)connues. Que viennent-ils nous vendre cette fois : une assurance-vie, des bons d'épargne, une véranda, des pompes à chaleurs..? Ce retour de la pub qui semble menacer sans cesse sous ces images confuses peinturlurées par un épigone de Darius Khondji, sous ces voix très compressées, au timbre et au grain traités immédiatement reconnaissables, est le vrai événement du film. La pub, comme chez Luc Besson, devient la menace mais aussi l'horizon : la narration peine à dépasser son pitch initial, le « message » (Ridremont y croit très fort) est martelé avec une conviction dont la candeur n'a d'égal que le sentimentalisme gnan-gnan.
Ceci n'empêche pas quelques accrocs, quelques moments d'authentique trouble dans ce film franchement étonnant, notamment la très belle scène où la fille du directeur (Pauline Burlet, très bien) détache le prisonnier et que celui-ci résiste et lui intime de fuir, puis cet échange qu'ils ont sur « son histoire et l'histoire de l'autre » dans laquelle on peut entrer, comme par effraction. Splendide dialogue réflexif, exceptionnellement simple dans ce premier film où tout est ampoulé, trop vite rattrapé par deux ou trois gros plans grimaçants sur Ridremont en courte focale, qui aime décidément beaucoup se regarder.
Mais puisqu'on est dans un cinéma catho (il faut voir la position du condamné à mort sur sa table) et fier de l'être (la morale sera sauve et le meurtrier mourra), toutes ces bonnes intentions se ravalent à un chapelet de clichés qui font déjà rire dans la salle, du genre « il faut prendre dans ses bras les gens qu'on aime avant qu'il ne soit trop tard » et autres aphorismes de la hauteur philosophique d'un Patrick Sébastien, nappés d'une musique de sitcom très vulgaire qui vient comme une chape de plombs sous ce déluge de bons sentiments terminaux. Avec une telle mentalité réactionnaire et cette collection de cartes rouges esthétiques, on ne serait pas étonné d'apprendre que Steve MacQueen (auteur du sentencieux Shame) en préparerait un remake outre-Atlantique. Mais d'un côté, c'est l'aspect le plus étrange de ce film étrange et assez inexportable : une radiographie involontaire de l'esprit d'un Belge moyen, révélatrice dans l'expression à tout crin de son inconscient. Jugez plutôt : bon sens populaire, sinon populiste, pudeur excessive avec la mort comme avec la religion, mocheté super-moyenne du décorum, humour noir pour oblitérer un fond de misère sociale et humaine vertigineux, réflexes catholiques presque inconscients dont le scénario est saturé, et racisme proto-colonial de base (le Noir rit très fort et parle lentement). Le flash final est à pleurer de rire de ridicule, digne des pires moments de Terrence Malick : enfants qui jouent à se tracer des ailes à la craie, ouverture de cages d'oiseaux qui reviennent s'y loger comme des boomerangs, etc. : rien ne nous est épargné du petit kit symboliste lourdingue de l'imagier d'Epinal. Plus perturbant : on trouve aussi vers la fin un écho d'esthétique du fascisme « ordinaire » (comme dans le Batman) troublant lorsque Lamers appelle à voter Raven (Berléand) au moment même où celui-ci enfile une képi qui fait très « chef des armées » et que la foule massée devant l'écran se met à scander violemment son nom en levant le poing. Sur un sujet connexe et avec infiniment plus de profondeur métaphysique, on ne peut que préférer le récent et hallucinant Into The Abyss de Werner Herzog.
Publié le 5 novembre 2012
A Cannes, le conclave présidé par Moretti avait quelques options intéressantes : choisir l'avant-garde et l'audace (Holy Motors) jusque dans ses dérives nombrilistes à outrance (Post Tenebras Lux) ou encore privilégier l'austérité de quelques auteurs un peu sidekicks mais qui en remettaient trois couches dans le glauque avec Mingiu et Loznitsa. Au sujet du film de ce dernier, Technikart avait écrit dans son quotidien du festival « mégalomanie+antiaméricanisme+radicalité+sérieux papal = Palme d'or ». Le journal s'était trompé sur le résultat, mais l'équation était déjà correcte. A côté de ça, beaucoup d'académisme, de sentence, de « radicalité autrichienne » (Haneke, Seidl), de machisme et de Loi du Talion (Audiard). Si tout le monde s'accordera sur la sécheresse et l'absence de sentimentalisme de Haneke dans son traitement d'un sujet en soi sentimental et mélo (évitement d'une tautologie), personne ne voit en revanche que c'est pour tomber dans une autre tautologie, celle de l'auteurisme creux.
Le jury présidé par Moretti nous a donc primé le seul film à nous faire le coup du « grand film classique de la maturité », lui qui a précisément été honoré à Cannes pour La Stanza del Figlio (2003). Habemus Palmam : Amour de Haneke, huis-clos dreyerien dans sa rétention esthétique mais aussi suffocant comme aux pires heures de ce cinéma qui nous (as)somme de soutenir l'insoutenable : un meurtre. Deux « monstres sacrés » s'y aiment et s'y affrontent, comme deux revers d'une même médaille, dans l'appartement terminal de la Nouvelle Vague (c'est le vrai sujet du film). Ce que Haneke filme, c'est bien la mort d'une modernité cinématographique (française) qu'il est assez joyeux de piéger dans son laboratoire et de boucler dans un retour à une structure très classique qui n'a jamais été autant la sienne. L'expression « monstre sacré » est méritée : ces personnages aux actes intolérables sont embaumés dans la parure la plus noble d'un « humanisme » complexe et torturé, mais jamais ces comédiens n'auront eu un visage si peu humain ou humaniste, si ce n'est dans la belle scène (hitchcockienne, langienne) du robinet ouvert, qui est le premier signe du déclin mais aussi du glissement du film, et s'autorise une belle volée de gros plans aussitôt giflés par la photo clinique de Darius Khondji. Glissement sémantique, en voie de sédimentation : l'auteurisme a glissé vers l'autoritarisme, et tout ce qu'il y a gagné, c'est une syllabe en plus.
On peut aussi voir dans ce choix un non-choix, une résilience plutôt qu'une mise en évidence d'un talent déjà souligné trois ans plus tôt par une Palme d'Or pour Das Weisse Band (alors qu'il y avait Vincere de Bellochio et Les Herbes Folles de Resnais en compétition) par Isabelle Huppert, actrice principale de La Pianiste & Le Temps du Loup. Était-ce parce que l'arbitre était vendu il y a trois ans qu'on se prend d'envie de « refaire le match » ?
C'est pourtant en se débarrassant de ces considérations qu'on s'apercevra que ce film est bel et bien à prendre avec des pincettes, sous ses dehors faussement compassionnels. L'habit ne fait jamais le moine chez Haneke : ses films « structurels » (71 Fragments, Code Inconnu) sont ceux qui contiennent le plus d'émotions. Tentative de prévenir pour ne pas guérir : avec Amour, surtout depuis l'auréole cannoise qui va lui amener un public encore différent que même Das Weisse Band ne drainait pas, Haneke va probablement passer aux yeux de beaucoup pour le contraire de ce qu'il est : un apôtre de l'amour du prochain, un grand dramaturge classique (capable d'écrire un huis-clos à deux personnages), voire un moraliste du hors-champ pudique et sacralisé. Imposture. Le cynisme d'Haneke est intact à celui des premiers jours (disons celui de Benny's Video et 71 Fragments, son film le plus intéressant avec son adaptation du Château de Kafka), et peut-être même un peu plus ferme avec l'aigreur de l'âge.
Il y a des idées brillantes dans Amour, qui ressemble beaucoup à un film d'horreur (et très terrifiant lorsque Riva dérape ou crie : elle donne vraiment beaucoup d'elle-même), comme la serrure fracturée en début de film (et jamais expliquée) ou le studium poignant des fleurs entourant le cadavre d'Anne (Riva). Haneke essaie de regarder ses personnages en face comme on regarderait la mort ou le soleil, mais il est difficile de ne pas ciller lorsqu'on veut aussi dire confusément que ses personnages = la mort = le soleil.
Il y a deux films dans Amour, un film des acteurs et un film du réalisateur. Le premier a droit à dix minutes assez fabuleusement descriptives : on cherche les acteurs dans le plan d'ensemble d'une salle des Champs Élysées, on les suit dans leur appartement, ils enlèvent leurs manteaux, enfilent leurs pantoufles, avec un luxe de temps que n'ont plus que les vieux couples routiniers (un temps dans lequel ils nous entrainent). Leurs voix sont belles, les plus belles de tout le cinéma français probablement, ce qui confirme que le grand gagnant du festival de Cannes, c'est le son de la voix humaine dans un sarcophage-écrin à sa beauté (le palais-tombeau des acteurs du « Vous n'avez encore rien vu » de Resnais, les limousines proustées d'Eric Packer & DL dans « Cosmopolis » et « Holy Motors »). Puis survient l'attaque, et le film du réalisateur prend la relève. Ce basculement est dramatique : surpuissance de l’ellipse brutale (chacune signifie une dégradation plus profonde encore d'Anne) comme affirmation du suprématisme de l'auteur qui signe sa mainmise sur ses personnages et dont chaque réaction est dès lors téléguidée par un petit programme d'humiliations et de rapports de pouvoir sadiques (les connaisseurs de la filmographie d'Haneke reconnaitront ce parcours-type de Funny Games, La Pianiste Caché, etc.) à ceci près qu'ici les deux personnages principaux semblent souffrir en même temps. L'homonymie des couples hanekien (Georges et Anne) n'est pas qu'un effet de signature de cette uniformisation. La direction de spectateur hanekienne fonctionne à plein. Le game n'est plus funny, mais funeste, il reste pourtant un jeu : « jusqu'où encaisserez-vous cela ? » redemande sans cesse Haneke.
Il y a deux films dans Amour, et seul le premier mérite son titre. Le premier est toujours-encore vivant que le second est toujours-déjà mort. Cette dichotomie n'est pas une dialectique, plutôt une impasse morale qui amène à de curieuses contradictions dans le propos et sa réception. Trintignant se croit obligé par exemple d'assurer le service après-vente en interview (et à défaut de commentaire de l'intéressé) en assurant qu'Haneke se marrait beaucoup et racontait même des blagues sur le plateau. C'est le super-auteur dont il faut maintenant démontrer l'humanité ! A vrai dire, on en doute pas vraiment. Chez Haneke, il y a toujours eu un humour noir cynique, peu analysé et discuté, profondément germanique. Voyez la scène où Trintignant rentre de l'enterrement et le raconte à sa femme : un mini-sketch à visualiser, une bouffée d'ironie et de trivialité qu'Haneke fait résonner sous l'adage/avertissement originel d'Anne « Tu es un monstre parfois, mais tu es gentil ». Même dans la « pire » scène du film, au début de l'anecdote racontée par Georges, celui-ci interrompt sa narration hésitante en surlignant les mots « étouffé... dans l’œuf » accompagné d'un regard qui erre hors champ (peut-être déjà sur ce fameux oreiller). Lorsqu'on connait ce qui suit, on se dit que l'humour d'Haneke tombe souvent bien à plat et n'est pas du meilleur goût. A peine plus loin, dans une métaphore étonnamment balourde et paresseuse au milieu de tout ce rigorisme sourcilleux, un pigeon s'introduit par la fenêtre alors que Georges écrit une lettre à sa femme défunte, comme si elle était partie en vacances. Georges attrape une couverture. Il se déplace difficilement, et tente de la jeter sur l'animal pour le capturer, mais doit s'y prendre à plusieurs reprises. Légers rires dans la salle, moment de répit croit-on. Mais quand il parvient enfin à l’attraper, Georges serre le pigeon contre lui, et ce geste mime l'étouffement d'Anne, et George le prolonge en gardant l'oiseau longtemps, épuisé. Tout ce qui reste à voir, c'est la pénibilité du travail du bourreau : Haneke a dû lire quelque part que « le cinéma de fiction, c'est toujours la mort au travail » et l'a mal interprété. La scène est obscène, même dans son acception latine d'origine rapportée par Régis Debray dans L'Obscénité démocratique (2007) : « ob-scenus : ce qui reste d’un homme quand il ne se met plus en scène (ob : à la place, en échange de). Quand s’exhibe ce que l’on doit cacher ou éviter. » Cette phrase rappelle ce que dit Georges à sa fille (Isabelle Huppert) en larmes à propos de sa femme qu'il tient captive, à l'abri des regards : « Parfois elle rit, elle pleure aussi, mais rien de tout cela ne mérite d'être montré ». On a droit à un précis de rétention émotionnelle très direct de la pensée d'Haneke. Sous sa méfiance pour le kitsch, pour la sentimentalité qu'il confond avec le sentimentalisme et le mélodrame (lire le "Haneke par Haneke" publié chez Stock), Haneke imagine qu'il n'existe qu'un spectateur-type, et tout l'art de l'auteur ne serait que de lui ménager un petit chemin très balisé à travers le film afin qu'il/elle éprouve les sensations voulues au moment voulu. Cette méprise cache-t-elle un mépris ? A tout le moins, on peut avancer que cette croyance que le public est une masse et non une somme d'individualités à même de ressentir des choses différentes à un moment donné est schématique, réductrice, voire naïve. Le film en devient lui aussi obscène, parce qu'il n'obéit qu'à la programmatique énoncée par Anne : vous avez vu que George était un monstre parfois, maintenant il nous reste à montrer qu'il est humain (malgré tout). Trois scènes suivent donc : Georges écrit à sa femme, sort acheter un bouquet (pay-off du studium des fleurs qui orneront le cadavre), avant que la mise en scène ne l'évacue pudiquement dans un scène fantasmée où le couple marche et vit de nouveau comme avant le drame. Ce départ touche à une dimension esthétique qui est la plus intéressante de l’œuvre. On trouve en effet à la vision de la description de l'appartement qui ouvre et clos le film, et de ces plans sur les fauteuils du salon notamment dans les champs-contrechamps, qui commencent souvent avant l'entrée dans le champ du personnage, une dimension objectale, quasi Nouveau Roman abâtardi, cette immuable présence des meubles et des ustensiles (une belle scène, rare chez lui, faite de plans de coupes de chaque pièce dans l'obscurité pour ellipser une nuit) qu'Haneke s'empresse de ranger derrière son analyse du confort bourgeois des musiciens mais qui le dépasse dès que ces objets sont ceux « qui nous regardent passer et puis mourir ». Le plan le plus émouvant du film n'est-il pas celui, fixe, qui commence sur le fauteuil vide pendant quelques secondes avant qu'Isabelle Huppert ne vienne s'y effondrer? Enfin un rapport s'installe chez ce cinéaste où personne ne dialogue jamais vraiment (voyez la scène où la méchante infirmière est renvoyée par Georges et comment le public est flatté de la trouver idiote lui aussi, endossant son point de vue), mais il est inattendu : c'est un rapport de couleurs de ce brun-verdâtre du fauteuil couvert par les yeux rougis sur la peau trop blanche de l'actrice, c'est ce petit creux menaçant pour le récit (ozuien) du plan vide mais déjà plein (de textures, d'un aplat uniforme) qui renvoie tout le manège de la cruauté hanekienne de même que les épanchements spectatoriels freinés à un fond d'absurdité qui dépasse vrai(semblable)ment le cinéaste.
Alors on est triste d'en revenir sans cesse aux mêmes questions de cinéma, chagriné de voir qu'il faut encore les reposer en 2012, qui plus est lorsqu'une unanimité critique les oblitère. C'est la sempiternelle rengaine du travelling de Kapo qui se pose ici avec la scène de la gifle et celle du coussin. Occurrence supplémentaire : on aura remarqué que l'actrice que recadrait cet homme qui n'avait droit qu'au plus profond mépris en 1960 était déjà Emmanuelle Riva. Alors peut-être qu'Haneke est plus cultivé que Pontecorvo, plus rusé aussi sûrement, car il sait que lorsque Georges gifle Anne ou l'étouffe, il ne faut pas faire de travelling avant mais bien river sa caméra pour changer son plan en tombeau.
Mais lorsqu'on lit que l'Autrichien ne se pose qu'un problème de cadre lorsqu'il filme Riva la culotte baissée sur les toilettes, n'a-t-il pas droit, lui aussi qu'au plus profond mépris ? Il n'estime pas que les larmes ou les fous-rires sont dignes d'être montrés, mais l'humiliation elle, peut l'être sans aucun frein. Amour est un film dangereusement schizophrène, où tout le monde prend l'autre pour ce qu'il n'est pas, entre un auteur qui imagine son public comme uniforme et docilement lacrymal, une critique qui prend le cinéaste pour ce qu'il n'est pas, et des acteurs qui ne se rendent pas compte de l'entreprise à laquelle ils ont participé.
La dernière fois que le cinéma d'auteur s'était à ce point figé dans un petit confort paternaliste et une uniformisation esthétique jusqu'à la caricature, c'était à la fin des années 60/début 70, et un film définitif de l'époque était venu clore un temps les expériences stériles : le Salo de Pasolini, dont même Barthes (qui n'aimait pas beaucoup le cinéma) remarquait qu'il était probablement « irrécupérable » (il n'a toujours pas été récupéré depuis). Notre époque attend encore son Salo. En attendant, les films de « gentils monstres » s'empilent et se ressemblent tous...
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 27