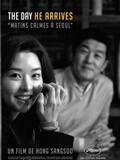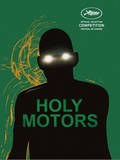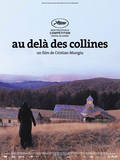VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 27
Publié le 7 février 2013
On nous les casse depuis un mois avec les fausses questions de genre, les tarantineries habituelles de pseudo-réinterprétation des codes, le rapport soi disant ludique au western dans « Django Unchained »... S'il y a un western projeté ce mois-ci, c'est bien « Le Fossé » (et bien sûr, il ne l'aura été qu'une seule fois) ! Le seul à poursuivre une réflexion sur les rapports impassibles du fond (le paysage) et les formes qui s'en détachent (les silhouettes frêles des humains). Le western -où plutôt l'eastern- dans son essence : pas de substantialité entre arrière et avant-plan ; assèchement de la forme, fatigue des hommes, déflation du récit. Le seul à montrer une vision aussi indélébile que celle-ci : après une tempête de sable, les cadavres d'un cimetière, à peine recouverts de couvertures, affleurent de la terre par centaines sur le désert. Mais tout ceci n'est que périphérique... « L'Histoire, rien que l'Histoire », martèle Wang Bing avec cette reconstitution d'un camp de travail de 1960 sous Mao de « droitistes » subissant la rééducation par le travail et pendant fictionnel au récit de He Fengming (« Fengming, chronique d'une femme chinoise », montré en 2007 à Cannes et sorti l'an dernier en France). Dans un premier temps éprouvant, le film se concentre sur le quotidien du travail et le manque de nourriture. Sujet redoutable que la faim, plus terrible que tous les autres parce qu'il leur préexiste (là, ça rejoint le Luc Moullet de Genèse d'un Repas). Nous savons gré à Wang de nous épargner les horreurs de la “mode rétro” galopante (revenant avec la crise économique comme le naturel, au galop), sensé nous faire voir qu'il y a de la jouissance dans la servitude et qu'on doit aimer son bourreau : Trois Mondes de Corsini, Amour de Haneke, Después de Lucia de Franco, Au Dela des Collines de Mingiu, etc. Position intenable chez Wang et sous Mao, et il faut traverser un petit calvaire de spectateur, porter une croix de plans séquences bien longs qui s'enfoncent dans les tréfonds d'un désert aride, écouter le vent ininterrompu qui les balaie, subir l'apathie généralisée des hommes affamés sous quelques mètres de terre, l'insalubrité, la mort qui rampe dans les couches. Le film est honorable en ça, mais lui qui clame si haut et si longtemps, comme une note tenue, qu'il ne faut pas cesser de s'indigner (c'est ce que l'épouse de Lao Dong hurle au responsable des enregistrements) a la main paradoxalement lourde lorsqu'il s'agit de convoquer le pathos. Ainsi la scène précitée devient complaisante lorsqu'elle s'attarde sur la performance de l'actrice, filmée dans sa douleur, ses larmes et ses cris qui viennent fendre le vent qui souffle sur la plaine. Ainsi par contraste la « radicale radicalité » de Wang Bing frise par instants le caricatural, l'aridité du paysage vide formant un complément ironique à la monumentalité en voie d'effondrement de « A L'Ouest des Rails » (1999-2003). Il ne s'agit pas de critiquer la teneur en émotion bien réelle de l'Histoire, qui exorcise ici son trop long silence dans l'exposition de ces stigmates refoulés, mais son filmage trop exclusif sans décollement d'un naturalisme strict mais parfois ampoulé, surtout lorsque la négation de l'humain dans ces goulags ne peut éviter à une conscience occidentale d'être renvoyée à la représentation de l'enfer des camps nazis (les images du cimetière rappellent celles des charniers). « Rien que les faits » assure Wang, « je n'ai rien rajouté » et pourtant si : un jeu d'acteur qui se regarde jouer, et Wang, en documentariste puceau de la fiction, s'étonne de ces prouesses en les jugulant comme il peut dans un montage en forme de test de rattrapage pas toujours assumé (le final, médiocre errance de parcours). Ce pathétique, jamais misérabiliste, plutôt du niveau d'une tragédie antique, jure dans un paysage moral qui atteint souvent à l'épure expressionniste du Trou de Jacques Becker, auquel on pense tout le temps. Et il ne rejoint que dans une scène (l'échappée nocturne du « professeur » et son élève) le grotesque qui donnait sa résonance si puissante à la scène bouffonne et sidérante du réveillon avec le père cheminot et son fils mort bourré dans « Rails »(« A L'Ouest des Rails », 2003). Les projets d'évasion se résument à des embryons de fiction (la prison à ciel ouvert est plus cruelle que quatre murs) là où prime un rapport documenté au décor: c'est l'épuisement d'une obsession et l'obsession d'un épuisement qui guide tout le geste artistique. Comme dans « Rails » , les manœuvres de travail sont d'absurdes entreprises qui maintiennent en vie autant qu'elles étouffent l'existence. L'amoncellement de cadavres qui rythme la narration n'est pas aussi glaçant que les gestes répétés, d'empaquetage de ces cadavres dans les couvertures, les trois nœuds faits avec de la corde, que le film répète avec pédagogie : pour ne pas qu'on oublie ce qu'on voit.


Publié le 30 janvier 2013
Hong Sangsoo en vient, par suite de principes de réduction et de minimalisme d'écriture et de mise en scène, à une condensation inouïe de son art. Depuis « Night & Day », expérience cruciale à l'étranger (le film fut tourné à Paris) et d'une longueur inusitée (2h18), Hong ne cesse de réduire la durée de ses films (celui-ci dure 1h18), de raffiner une figure de cinéaste-critique-protagoniste inactif en manteau à capuche et sac-à-dos et de présenter des héros déboussolés, voyageurs (Isabelle Huppert dans « In Another Country ») ou en transit (Seongjun ici). Cette faculté de bien se servir de ses moyens parce que leur nombre diminue se trouve ici catalysée dans une scène ou Seongjun retrouve son ex Kyungjin après une errance alcoolisée dans la nuit. Comme dans une scène analogue de « Hahaha » (2010), le héros se retrouve à pleurnicher comme un enfant au bord du lit tandis que la fille le réprimande sévèrement. Mais suite à une déclaration d'amour ruisselante de larmes et de soju, la fille craque et tombe à la renverse dans le lit. Seongjun rampe jusqu'à elle et ils confondent leur tristesse et leurs corps retrouvés. Cut abrupt : on retrouve leurs jambes sur le seuil, l'homme s'est déjà rechaussé et les deux amants font le serment de ne plus jamais s'envoyer de messages ou s'appeler. Hong frôle avec cette séquence l'essentiel de son art ; jamais il n'a mêlé de façon aussi proche le grotesque et le pathétique, la compromission et la droiture, le code moral autoproclamé et son infraction. N'importe quel autre réalisateur moins sûr de son art aurait situé cette scène après quarante minutes de film ou dans le dernier acte, voire en climax. Hong la situe à la quinzième minute, et son film parait une étape plutôt qu'une addition au canon de sa filmographie à la production exponentielle.
Les zooms et panoramiques se font plus tendres qu'à l'habitude (dans le couloir à la sortie du bar notamment), les vieux amis cessent de se mettre systématiquement dans l'embarras lorsqu'ils passent à table (à part dans une scène hilarante avec l'acteur Jungwon), la nourriture devient presque un temps de partage, et le noir et blanc hivernal très défini contraste et temporise une nostalgie paradoxale, secrète et numérique. Et si les filles demandent toujours aux garçons quel genre de personnalité elles ont selon eux comme pour se jauger face au désir, la neige qui tombe près des deux fumeurs et le ton délié de leurs conversations laisse entrevoir ce qui, de loin (on approche pas chez Hong, on zoome), pourrait ressembler à de la tendresse. La tendresse, c'est peut-être au fond le seul tabou de ce cinéma qui n'est jamais cynique ou misanthrope mais simplement cru, brutal, qui aborde la sexualité de manière plus frontale (voir « La Femme Est l'Avenir de l'Homme ») que chez un Im Sangsoo qui forge dans sa complaisance de façade une marque de fabrique. La tendresse menace les dispositifs de Hong, propose pour ce The Day He Arrives un charme autre, incertain, plus éphémère peut-être, brodé sur le beau et limpide thème de piano de Yong-jin Jeong. Autre instant d'intimité non feinte : les larmes de Boram en plein détresse solitaire lors du repas à trois, dans une de ces séances rohmériennes où les personnages explicitent les traits de la personnalité des autres pour mieux parler de la leur. Le son direct dans The Day He Arrives est extrêmement agressif, toujours en plan très proche (a-t-on utilisé beaucoup de micros HF ?), du froissement des draps au réveil au sac plastique serré qui couvre les baisers des amoureux dans la nuit. La fin est presque parodique, une suite de rencontres fortuites dans la rue comme son cinéma en est constellé, grisantes à force de répétitions. Si une maitrise esthétique est ici à l’œuvre, elle tient probablement à une disponibilité toute particulière du cinéaste et sa méthode qui se raffine (sept jours de tournage, scénario écrit le matin du tournage, équipe réduite : choix économiques donc anticonventionnels) et d'une continuité de la démarche qui livre sa maturité avec une étonnante disposition émotionnelle. Plus serein, plus souriant (notamment dans le démontage des stratégies de drague, les trois étudiants qui imitent le comportement de Seongjun avant qu'il ne s'enfuie effrayé), The Day He Arrives présente aussi un Hong Sangsoo plus paisible et distant, qui aime nous donner ce fortuit et régulier rendez-vous du cœur de proche en proche, dont le dernier en date, « In Another Country » avec Isabelle Huppert, a confirmé l'inclination pour la comédie éperdue et la musique de chambre des sentiments.
Publié le 2 janvier 2013
L'année est terminée, c'est l'heure des tops cinéma. Publiez les vôtres ! Voici le mien : 1. (loin devant) HOLY MOTORS, Leos Carax / 2. TWIXT, F.F.Coppola / 3. PODSLON (SHELTER), Dragomir Sholev (inédit) / 4. TAKE SHELTER, Jeff Nichols / 5. UNTER DIR DIE STADT, Christoph Hochhäusler / 6. COSMOPOLIS, David Cronenberg / 7. INTO THE ABYSS, Werner Herzog (inédit) / 8. LAURENCE ANYWAYS, Xavier Dolan / 9. THE DAY HE ARRIVES, Hong Sangsoo / 10. TABU, Miguel Gomes / 11. 4H44, DERNIER JOUR SUR TERRE, Abel Ferrara (inédit) / 12. LA FOLIE ALMAYER, Chantal Akerman / 13. LES CHANTS DE MANDRIN, Rabah Ameur-Zaïmeche / 14. MEKONG HOTEL, Apichatpong Weerasethakul / 15. VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU, A. Resnais / 15bis. LIKE SOMEONE IN LOVE, Abbas Kiarostami (inédit).
Et j'ajoute deux mentions honorables, une pour KOI NO TSUMI/GUILTY OF ROMANCE (inédit) de Sono Sion, qui ressemble au film que réaliserait le Marquis de Sade s'il vivait aujourd'hui (il ferait d'ailleurs sûrement du cinéma), et une autre pour le très beau, quasi-testamentaire MY SOUL TO TAKE de Wes Craven. 2012, moins grandiose, romantique, eschatologique et tranchante que 2011, a été l'année de quelques « happy few », élus de cœur depuis longtemps, qui ont épinglé à leur filmographie une voire plusieurs directions complètement inattendues (exactement ce qu'on attend d'eux). Leos Carax évidemment, mais aussi Abel Ferrara et Hong Sangsoo. C'est l'occasion de pousser un nouveau coup de gueule envers distributeurs et exploitants : les films de ces deux derniers cinéastes, qui sont parmi les plus importants en activité aujourd'hui, ne sont toujours pas distribués en Belgique, malgré les sélections cannoises systématiques de Hong, la présence de Willem Dafoe chez Ferrara et celle de Isabelle Huppert dans In Another Country. Moins réjouissant que les bêlements de cette dernière et l'imbroglio désormais culte du « lighthouse » dans le film précité, le Cosmopolis de Cronenberg a peiné à trouver son public... et à le garder ! Les projections furent nombreuses (les commentaires sur le film en témoignent) où la salle se vidait petit à petit. Taxé d'hermétique, d'opaque par ceux qui s'attachent encore superficiellement à l'anecdote du récit et des dialogues, Cronenberg a pourtant offert le film qui était le miroir le plus exact et dé-poli tendu à notre époque, terrifiant et grotesque, tragique et comique souvent au sein de la même scène. Sans aucun doute, Cosmopolis, Holy Motors, Take Shelter, n'en déplaisent à leurs détracteurs, sont des films dont on parlera encore dans 50 ans.
Jeff Nichols justement, dont le Take Shelter sorti en janvier (présenté en mai 2011 à la Semaine de la Critique) réalise un exploit en s'étant si bien fiché dans les mémoires qu'on s'en souvient encore à l'heure de faire les tops de décembre, en attendant son élégant « Mud » (bien qu'inférieur) présenté à Cannes, pour juin. On a beaucoup jasé sur l'apparente mollesse de la sélection cannoise, effectivement bardée de quelques films ratés et anachroniques (Lawless, The Angel's Share, Paperboy,...) quand ils n'étaient tout simplement pas ignobles et souvent idiots (Amour, De Rouille et d'Os, Paradise:Liebe, Au-delà des Collines, Jagten en sélection officielle, Trois Mondes, Despues de Lucia à Un Certain Regard) mais il ne faudrait pas oublier que le Kiarostami, le Resnais, le Carax, le Hong Sangsoo, le Cronenberg, le Xavier Dolan et le Wes Anderson sont bien les films qui ont fait l'année et ne pas occulter les très beaux Aqui Y Alla, Sofia's Last Ambulance et Augustine montrés (et primés pour les deux premiers) à la Semaine de la Critique ; Rengaine, Camille Redouble, The We & The I de Gondry (dont on dit beaucoup de bien) à la Quinzaine des Réalisateurs ; La Tête La Première à l'ACID et une très belle séance spéciale d'un moyen-métrage d'Apichatpong Weerasethakul, Mekong Hôtel (diffusé début décembre sur Arte), sorte de balade blues languide et fantomatique d'un hôtel à la dérive (on dirait un paquebot enlisé) qui venait nous rappeler gentiment, sans esbroufe et avec un humour d'un calme olympien que Weerasethakul est le meilleur pourvoyeur d'ambiances, de textures sonores et de sensations du cinéma contemporain. Plus encore, il fait partie de ces films et de ces cinéastes, avec le Tabu de Miguel Gomes et Holy Motors de Carax, qui parviennent à réactiver, avec peu de moyens, la magie des premières heures du cinéma, cette promesse de sidération offerte du cinéaste à son spectateur, une sorte de croyance primaire et totale qui conjugue archaïsmes techniques avec un brouillard de nostalgie cinéphilique. Les festivals, jusque dans l'idée dérivative d' « auteurisme » qu'ils colportent, restent les baromètres les plus importants d'une année de cinéma. Berlin a primé le beau « Cesare Deve Morire » des Taviani et de Venise on attend le Brian De Palma (« Passion », remake de Crime d'Amour de Corneau) et surtout le « Spring Breakers » de Harmony Korine. Les festivals belges, même s'ils ne jouent pas dans la même cour, reste des territoires encore à topographier, pour lesquels une fouille approfondie peut révéler des pépites cachées. Mons montrait par exemple un des meilleurs films de l'année, « Podslon » (Shelter) de Dragomir Sholev, qui confirme la bonne santé du cinéma bulgare (après Avé de Bojanov, Eastern Plays de Kamin Kalev et Sofia's Last Ambulance de Ilian Metev) à coups de paris de mise en scène racés, absurde à la roumaine sur le sujet du clivage des générations et ironie grinçante sur le naturalisme tire-la-tronche du cinéma d'auteur actuel. Il ne reste qu'à vous souhaiter une belle année 2013, pleine de cinéma. Meilleurs vœux à toute la Communauté CINEBEL.
Publié le 30 décembre 2012
Euphémisme que de dire que Mingiu était attendu au tournant, cinq ans après la Palme d'Or pour "4 Mois, 3 Semaines & 2 Jours". Euphémisme que de dire qu'il déçoit. Si ses expositions narratives sont toujours aussi efficaces, certaines lourdeurs de mise en scène, tout à coup exagérément symboliste, détonne dans cette austérité affichée : le plan séquence introductif où le personnage remonte le flux des voyageurs à contre courant ou le panoramique à 180° qui découvre le couvent niché au dessus de la colline, loin du village. Cette autorité voyante de l'apparatus (plans séquence, caméra portée, naturalisme strict de la photo d'Oleg Mutu) redouble sans cesse, bêtement, l'autorité sèche du couvent, du prêtre et de la loi qu'il y fait régner. Ici, on déverse des seaux de poissons vivants dans l'évier, l'eau est prise au puits, on s'éclaire à la bougie, les prolos ont des trognes pas possibles, le format Scope est de pure convention : autant de signes qui nous signalent bien que celui qui osera rigoler pourra sortir.
Mais comment l'humour noir du thriller "4 Mois...", taillé à la corde, a-t-il tourné à tant de raideur discursive ? Si ce film était isolé, on ne se poserait pas la question, mais les sorties consécutives de Shame, Amour, Des Hommes Sans Loi, Dark Knight, De Rouille et d'Os, Dans La Maison, Millenium obligent à ce poser ces questions. Qu'est-ce qui fait défaut à ce cinéma caricatural ? 1) L'absence d'humour, d'ironie ou de toute autre forme de distance qui permettrait de sortir de l'impasse asphyxiante du « point de vue auteuriste unique ». Cela invaliderait la piste ambivalente qui porte à croire que le cinéaste dit et pense la même chose que ses personnages. De tous ces jeunes réalisateurs roumains, Porumboiu est le plus talentueux parce qu'il allie la lecture sociale via l'absurde administrationnel, genre kafkaïen s'il en est, avec le sondage minutieux de conscience. 2) L'absence de marquage de genre. "Au-delà des Collines" pourrait être : -un mélodrame en huis clos à la Dreyer, -un thriller spiritualiste et existentiel à la Tarkovski, -un film d'horreur ou fantastique sur la possession. Il n'est rien de tout cela, et mélange cette absence de balises référencées avec sa pesante démonstration de mise en scène au forceps, confondue avec un genre en soi. Comment lui reprocher d'ailleurs, puisque c'est l'impasse de l'auteurisme actuel. Mais les meilleurs films de l'année (Twixt, Cosmopolis, Take Shelter, 4h44 Last Day on Earth, Laurence Anyways,...) obéissent tous à un ou plusieurs genres définis dont ils malaxent les contours et les formes, pour finir par en faire éclater les codes. Précisons que ce jeu est avant tout un jeu avec le spectateur, qui jubile dans son siège. 3) L'absence de « Weltanschauung », d'une vision du monde singulière, personnelle, et pas calquée sur une super-pesanteur réaliste, sociétale et sociale, d'où découle 4) une absence d'amour, de sentiment, de compassion pour ses personnages, position soigneusement calfeutrée derrière un point de vue pseudo-objectif, évidemment impossible à atteindre. C'est tragique, surtout lorsque le sujet de film est la passion, au sens originel, latin : une souffrance, un mouvement impétueux de l'être vers l'objet de son désir (stricto sensu, le film l'histoire d'un trio amoureux), mais aussi au sens christique : « les derniers jours de la vie de... » D'autant que Mingiu semble obsédé par le système d'oppression d'un homme de pouvoir sur deux femmes et la redistribution de ce pouvoir une fois le mâle castré, symboliquement s'entend... Mais il n'y a ici qu'une scène intéressante, c'est -passage obligé du nouveau cinéma roumain- le retour du bâton de l'institution (souvenez-vous du coup du dictionnaire dans "Politist, Adjectiv", de la déclaration à la police au bout d'"Aurora"), celle du retour à l’hôpital et la constatation du décès d'Alina par la doctoresse, pique d'humour noir d'un sarcasme enfin sidérant. Le dernier plan, qui rend à la loi des hommes celle de Dieu, est heureusement mémorable pour son absurdité (une flaque de neige boueuse vient s'abattre sur le pare-brise du fourgon de police avant d'être balayé d'un coup rapide d'essuie-glaces).
Publié le 8 décembre 2012
Ceux qui ont cru que la belle surprise qu'était « The Assassination of Jesse James... » (2007), splendide western crépusculaire et métaphysique, pouvait se prolonger avec le film suivant du même Andrew Dominik déchanteront rapidement avec Killing Them Softly/Cogan/La Mort en Douce, où une bande de gangsters en vestes en cuir déblatèrent sur le contexte économique américain dans une série B sans éclat, sans rythme, dont chaque scène transpire le déjà-vu, chaque réplique le déjà-entendu, et qu'on jurerait échappé d'un lointain creuset des années 90. Seul le mixage et le sound design inspiré, bardé d'effets de phase (étonnante introduction du générique, haptique aller-retour des deux criminels vers la salle de tripot où a lieu le braquage), peut distraire un moment, mais c'est bien trop peu pour soutenir l'intérêt d'un film qui se borne à aligner une série de champs/contrechamps et quelques plans séquences poseurs, se disant que les acteurs feront tout le travail, alors que la plupart cabotinent (Pitt, Curatola) ou s'autocaricaturent lourdement (Ray Liotta ou James Gandolfini, avec pourtant le plus beau personnage du film, celui d'un tueur à gages vieillissant, alcoolique et radoteur). Dominik et certains critiques croient peut-être que mettre une télévision crachant des allocutions d'Obama ou Bush au fond de chaque plan est une idée de mise en scène consistant à renvoyer la situation particulière du business du crime à une dimension socio-politique plus large ; sa démonstration de maitrise est d'autant plus vaine qu'elle souligne l'anachronisme flagrant de l'entreprise. Au lieu de rendre poreuses les frontières entre discours des politiques sur la crise et l'économie parallèle que constituent ces malfrats, ces limites sont sans cesse soulignées et le propos reste de la plus complète opacité. Les deux dimensions du film sont rigoureusement imperméables : jamais le commentaire politique ne vient faire autre chose que commenter ironiquement la situation, et souligner le caractère désuet du récit, son esthétique de vieille production Miramax (Ray Liotta pour citer les Goodfellas de Scorsese, James Gandolfini des Affranchis, les gangsters logorrhéiques de Tarantino), alourdie d'effets pesants à force de sursigner qu'un auteur se cache derrière. En tête : le shoot d'héroïne le plus lourdinguement mis en scène depuis longtemps, avec morceau du Velvet Underground (« Heroïn », littéralement), passages au flou, le combi travelling arrière/fondu au noir, super gros-plans fiévreux (redoutables), changements de polarisation personnage (incohérents), répétés ad nauseam pendant de longues minutes. L'éclatement du récit dans des intrigues secondaires de personnages secondaires, plus bras-cassés les uns que les autres, n'aide en rien à s'accrocher à l'ensemble, pris de vagues convulsions de violences cyniques mais souvent d'une platitude effarante, puisqu'on sait d'avance, clichés en chapelets obligent (Dominik a un humour proche du zéro absolu) que les deux tiers de la distribution vont finir avec quatre balles dans la poitrine. Il serait temps d'enterrer une bonne fois pour toutes ces tombereaux de poses boursouflées, dont seul Dominik croit qu'ils sont encore opérationnels. A l'exception de la tirade finale de Cogan, rien ne parvient à se hisser au niveau de la critique du contrat social américain, dimension qui donnait tout son relief à la mythologie en berne de « Jesse James ». Comme Cogan le dit dans le dernier plan, « L'Amérique n'est pas un pays, c'est un business » et l'erreur de Dominik est de ne pas se rendre compte que son film n'est qu'un pion de ce business.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 27