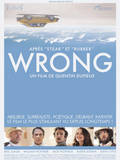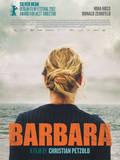VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ...
- 27
Publié le 4 octobre 2012
Bien entendu, ce nouveau Resnais n'a rien du « théâtre filmé ». Il n'a pas grand chose à voir avec les approches les plus connexes de Resnais à ce sujet, que ce soit Mélo, Smoking/No Smoking ou Pas Sur La Bouche et ne ressemble pas plus au Prénom, le petit boulevard-TF1 en conserve qui a inexplicablement eu son succès public récemment. « Bien entendu » seulement, car ce film l'est souvent mal (entendu) : pour relever ce qu'il a de plus beau en lui, il faudra fermer les yeux, et écouter : jeu d'échos, d'hésitations et de reprises, où la mémoire (grand sujet resnaisien) joue des tours (à Anny Duperey), ressasse, recrée. Cette qualité formelle, ce jeu sur la granulométrie des voix, leur timbre, leur façon de s'incarner dans l'air puis de s'enfoncer sous terre prime ici, ne pas la remarquer, c'est rater son point d'accès au cœur de la dramaturgie d'Anouilh. Le fond de ce film est assurément la voix humaine, en tant qu'elle est la limite d'humanité dans un monde de marbre sans celluloïd, la pointe courte du désir. La voix d'un jeune acteur, rendue métallique par la captation vidéo, devient une chaleur légèrement hésitante avec Michel Piccoli. Une même réplique chez une Eurydice de vingt ans est contrite dans les sanglots fébriles d'Anne Consigny, les hauteurs de Sabine Azéma. On peut se moquer, c'est toujours aussi facile, mais la transition est dramatique. Les mots n'ont pas changé, leur sens oui, la science aussi, l'expérience : radicalement, l'âge : tragiquement.
Au-delà d'un certain ennui poli soulevé par une part de la critique, et même chez les ardents défenseurs de l'auteur de Je T'aime, Je T'aime (1968) et L’année Dernière à Marienbad (1961), personne ne semble avoir relevé cet intérêt majeur qui rapproche le film des expériences de Syberberg avec Edith Clever, leurs Parsifal (1983), Die Nacht (1994) & Die Marquise Von O. (2000), qui se déroulaient déjà moins sur une scène que dans la Black Maria originelle d'Edison. Le décor de Vous N'avez Encore Rien Vu n'arrête pas de subir compositing numérique, torsions et redéfinitions (gare, quai de gare, chambre, coin de forêt) particulièrement oniriques. Resnais ne pratique pas le cinématographe bressonien, mais dire que ces adaptations d'Anouilh ont quoi que ce soit à voir avec le théâtre (hormis le texte d'origine et une certaine technique d'acteurs) ne résiste pas à un examen un tant soi peu sérieux. Les décors changent à la faveur d'un morphing numérique, le gros plan rend palpable la technique d'un Pierre Arditi ou Sabine Azéma (pour ne citer que les plus remarquables), les faux raccords changent sans cesse les acteurs et leurs personnages de place dans le salon et Resnais repousse avec eux sa direction dans un jeu où les outrances, le léger cabotinage de chacun est façonné, modelé pour la caméra, seul « public » du cinéma, appareil froid et non présence humaine vivante (public de théâtre). L'imbécile notion de « théâtralité », fondée par des critiques paresseux, y prend même pour son grade. A Cannes, le film a pris tout le monde a rebrousse poil, dès son générique téléphoné avec son graphisme digne d'un film de kung-fu avant d'être immédiatement minoré comme une folie d'un grand metteur en scène, mais anodine. Le public de Cannes est bien « le pire public du monde », et croit surpasser Resnais en charme de la mort en l'embaumant dans ses révérences pré-posthumes. Le véritable problème critique autour de Resnais est d'ailleurs ailleurs. Il réside plutôt dans cette « fatigante valse-hésitation des critiques qui n'osent jamais dire que Resnais est un auteur important-mais-sinistre ». Daney écrivait ça en 1989, et c'est toujours valable (le macabre chez Resnais a pris des proportions ahurissantes : souvenez-vous des finales de Cœurs, Les Herbes Folles). « Vous n'avez encore rien vu » est un soleil noir, qui darde très fort de puissants rayons, créant du dispositif (salle avec spectateurs/projection) une dialectique moquerie-révérence envers la mort (du cinéma et au cinéma : « Mon film nait une première fois dans ma tête, meurt sur papier ; est ressuscité par les personnes vivantes et les objets réels que j’emploie, qui sont tués sur pellicule mais qui, placés dans un certain ordre et projetés sur un écran, se raniment comme des fleurs dans l'eau. » Robert Bresson). Chaque acte se clôt par une mort, invariablement. En « troussant » le gant à l'envers (la caméra étant braquée sur le public, qui est aussi les comédiens, c'est-à-dire ceux qui d'ordinaire sont à l'écran), Resnais résume simplement un amour vivant, passionné pour sa troupe mais aussi sa célébration de la douceur et du plaisir de la mort. Même le rebondissement consistant à révéler que Danthac n'est pas mort est fondu au noir avec sa musique jazzy de Mark Snow pour être projeté dans une de ces accélérations mortifères du récit dont Resnais fait une science de l'épilogue depuis trois films.
Cette fission est possible parce que le film de Resnais est situé au-delà de la mort, comme les épilogues de Cœurs (2006) ou des Herbes Folles (2009), ces avancées excitantes et terrifiantes au bord du gouffre (au bord du cinéma), par delà lesquelles, c'est certain, il n'y a pas de lumière mais juste d'insondables ténèbres où résonne encore avec un peu d'écho la voix d'une petite fille qui demande à sa mère : « Quand je serai un chat, est-ce que je pourrai manger des croquettes ? ». Resnais est terriblement proche de l'écriture du désastre décrite par Blanchot, voire du désastre lui-même. Son film est situé dans une forteresse à l'ambiance d'une ère post-atomique, un funérarium aux parois duveteuse, ouatées, où la voix est absorbée. Peu de cinéastes ont aussi bien exploité la pulsion de mort du spectateur de cinéma pour la sublimer.
Un linguiste s'amuserait à dessiner une petite chaine, la séquence resnaisienne : prose - proposition – prosopopée – épanorthose – palinodie – poésie. Voilà le trajet de quelques unes ses fictions depuis Providence (1977) au moins. Non seulement nous n'avions encore rien vu mais ce film vient nous dire que nous n'avons rien vécu. Il serait temps.

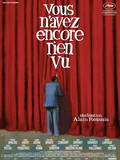
Publié le 26 septembre 2012
Et si la grande affaire de Dupieux c'était l'arnaque, la fumisterie, le hold-up hipster à grands coups de chemises à carreaux et de déstructuration capillaire? Ce serait fichtrement pratique pour lui, ça expliquerait beaucoup pour nous : les albums bâclés, inaboutis de Mr Oizo, où les idées sont accolées sauvagement sans souci de structure (de Moustache à Stade 2), les fins en queue de poisson, les films qui démarrent très fort puis s’essoufflent dans leur conceptualisme envahissant (Nonfilm, Rubber) mais surtout leur séduction immédiate à tous, insolente et d'une bizarrerie qui n'est pas une façade, mais bien le fond de sa personnalité (leur sujet, pas leur objet), d'où leur capacité d'embrayage rapide dans une fiction bricolée et leur manœuvre chaloupée dans le brocardage du portnawak le plus rationalisé qui soit.
Dupieux a trouvé son territoire dans la banlieue californienne moyenne, baignée d'une lumière blanche un peu aveuglante, et mine de rien, sa critique sociale est plutôt profonde et riche en détails qu'elle n'en a l'air (ne fut-ce que grâce aux propriétés techniques de la caméra prototype HD-Koi utilisée). Le loufoque est-il véritablement logé dans ce bureau où il pleut toute la journée, dans ce réveil qui indique 7h60 chaque jour (les gags sont volontairement répétés jusqu'à l'épuisement, c'est-à-dire très exactement trois fois), ou plutôt dans ce bureau de détective situé dans l'arrière-salle d'une pharmacie (une des meilleures idées, très discrète), dans ce dialogue avec un voisin vexé à l'idée qu'on connaisse sa passion du jogging, mais exige qu'on lui parle à bonne distance ? Le réalisateur a aussi trouvé un tempo propre, plutôt lent, reposé sur quelques figures de styles simple (le panoramique de recadrage haut-bas, ou droite-gauche, le léger zoom avant dans les plans de coupes et inserts) magistralement rendu dans sa séquence de générique (un pompier défèque sur la chaussée tandis qu'une fourgonnette se consume) dont la fonction est inverse : si l'un dilue le gag dans sa «Weltanschauung» (à la Tati somme toute), rendant son absurdité locale à une absurdité totalisante, non plus périphérique mais généralisée (humour absurde : toujours métonymique), l'autre le resserre autour d'un suspense sans objet, d'une tragédie toujours à venir, mais toujours-déjà-passée.
Wrong est un film amusant et facile à psychanalyser (vite fait, niveau « de comptoir » s'entend...), comme bon nombre de chefs-d’œuvre de l'absurde et du non-sens (pêle-mêle Duck Soup des Marx Brothers, Never Give a Sucker An Even Break de W.C.Fields, And Now For Something Completely Different des Monty Python, Le Roi de l'Evasion de Guiraudie). Le héros comme le personnage moyen de ce monde est un célibataire (Dolph mais aussi son voisin joggeur, le jardinier français) et happé par une standardiste de pizzeria vaguement nymphomane... mais surtout très dépendante et maternelle (un prototype de maman-putain horripilante), pour laquelle le réalisateur élude les scènes de sexe avec une pruderie digne du Code Hays. Lorsque Victor (Eric Judor) se réveille dans le lit à côté d'elle, il a comme un mouvement d'effroi et ne pense qu'à fuir au plus vite la chambre. Elle le retient, veut déménager chez lui. En un seul rapport, elle est tombée enceinte. Dans la scène où elle cherche un prénom à leur futur enfant, elle se maintient à bonne distance à la porte du jardin tandis que l'autre plante un sapin. Lorsqu'elle est trop proche de lui et que leur corps manquent vraiment de se toucher, il lui enfonce un tesson de bouteille dans le ventre dans ce qui est le seul geste de violence d'un film très fier de son principe de rétention (mais aussi de son ruban moebiusien qui déroule la fin dans un cycle onirique assez creux). Dupieux semble développer une peur sinon un dégoût à la simple idée de deux corps qui se touchent (ce que montre déjà plus tôt la scène où Dolph et son voisin discutent, et que celui-ci le fait se rapprocher de plus en plus de lui, sous prétexte d'une meilleure communication). Si l'on ajoute à ça une véritable vision d'horreur au milieu du film (on propose à Dolph d'adopter provisoirement un autre chien qui se révèle être... un petit garçon à lunettes!), on obtient une vision angoissée de la paternité pas très éloignée d'Eraserhead (la connectique lynchienne est probablement là plutôt que dans un vague rapport d'«inquiétante étrangeté » freudienne). Dupieux convoque bien malgré lui tout un imaginaire de la peur de castration que le cinéma classique a largement relayé au siècle dernier ; il est curieux et roboratif de voir que c'est ce cinéma qui pose et se pose comme violemment contemporain soit en réalité celui qui puise le plus dans un passé cinématographique des archaïsmes de représentations issus des années 30 & 40. La constante de Dupieux, une appétence pour une forme d'ataxie burlesque des corps (un monde où tout le monde est apraxique), fonctionne à plein. Ce n'est plus la caméra qui tombe, fait des hoquets, cherche à se stabiliser dans des angles improbables (Nonfilm), ce sont les corps qui sont trop (a)droits, se tiennent à bonne distance (on téléphone à celui qui est en face de nous, pour mieux le tenir loin de soi). Principe d'incertitude, logique de séduction (séduction: l'art de se rapprocher de l'autre). Dupieux écrit des films au conditionnel, où le réel a plus d'importance et de pouvoir de fléchissement sur la fiction qu'on ne peut le croire, et c'est suffisamment rare et remarquable que pour aimer Wrong.
Publié le 19 septembre 2012
Les films de Christian Petzold (depuis Die Innere Sicherheit/Contrôle d'Identité en 2000) ne sont jamais aussi séduisants (de cette beauté glacée, lointaine), troublants, intrigants que lorsqu'ils empruntent les sentiers sinueux qui bifurquent du réalisme magique à la Delvaux : Wolfsbürg (2003) et sa topographie circulaire dessinée à grands traits, Gespenster (2005) et ses personnages quasi-invisibles aux yeux des autres, désincarnés, décollés du réel et surtout Yella (2007), remake non-avoué d'Un Soir Un Train. Barbara appartient malheureusement à une seconde catégorie de sa filmographie, des drames moins habiles, moins labiles aussi, qui sondent l'inconscient d'un pays, l'Allemagne, sinistré par ce trou béant qu'est la Seconde Guerre Mondiale et laissé comme un no-man's land à la Wenders (hypnotiques autobahns immortalisées dans le rock par Neu!, non-lieux vides comme des sentiers, des stations-services, des routes au milieu de la forêt, hôtels anonymes, bureaux aseptisés, bordés d'une végétation d'un vert uniforme et absurde), et l'inconscient d'une époque (le zeitgeist hégelien) plutôt que celui d'un personnage, mais ravale trop souvent ses enjeux à cette forme sibylline de reconstitution, moins savamment formelle, qui débouche souvent sur des demi-déceptions, des finales en queue de poissons un peu courtes. Jerichow (2008) n'ambitionnait rien tant que déplacer l'intrigue du "Postman Always Rings Twice" de Cain dans le contexte de l'Allemagne contemporaine (et encore, le premier tiers du roman, la(i)ssant dans l'état d'inachèvement dont on parlait). Contrôle d'Identité qui a révélé l'auteur à l'Europe après plusieurs fictions pour la télévision le disait très bien dans son titre international, "The State I'm In" : déroute existentielle, présence évanescente, antonionienne, renvoyée à son vide et ses creux par ceux qu'elle traverse. Carte de visite peut-être idéale (la presse belge découvre enfin son cinéma avec sa paresse intellectuelle et son retard habituel et risible), toujours coincé dans le circuit de ses migrations pendulaires qu'il en est sursigné, le présent Barbara (prix de la mise en scène à Berlin) ajoute peu ou rien à ce canon : la présence puissante et le regard magnétique de Nina Hoss reste un plaisir sans cesse retrouvé (à défaut d'être renouvelé) dans lequel on peut tomber à l'infini, mais la situation de l'action en « Allemagne de l'Est, 1980 », période étrangère au cinéma de Petzold ne nous vaudra que quelques digressions assez mal écrites ou déjà balisées sur l'ère de suspicion généralisée, la lourdeur obsédante de l'administration, l'omniprésence du troc et du trafic de denrées et sur "Leçon d'Anatomie du Docteur Tulp" de Rembrandt somme toute assez académiques, sinon folkloriques – c'est qu'à bien y regarder, une lointaine et étrange programmatique de détournement du « heimat film » guide l'intrigue en sourdine.
Publié le 14 septembre 2012
Un des pires films américains de l'année, même pas baroque. C'est quoi C. Nolan© ? Notez bien : je ne demande pas « qui ? ». Nolan© doit être une marque déposée, une corporation de mecs importants qui viennent sur les plateaux avec leur serviette comme des fonctionnaires ; ça doit être une méthode martiale, une certaine façon arrogante d’assommer son spectateur d'effets, mais sans aucunement une science de la « direction de spectateurs » chère à Hitchcock. Nolan est aussi ennuyeux que ses films, trainés dans des longueurs faussement réflexives, qui masquent mal une imagination tout juste bonne à setdesigner des plateformes de jeux vidéos (souvenez-vous du niveau « bunker dans la neige » de Inception). Propulsé nouveau maitre des séries A hollywoodiennes, Nolan ne sait plus quoi faire de ce statut, hormis le dilapider dans un cinéma bavard et pantouflard où on parle beaucoup plus que dans n'importe quel Rohmer. On y retrouve, sous forme de catalogue, tous les symptômes qui font que les séries A du cinéma hollywoodien se sont rarement aussi mal portées (Avengers, Amazing Spider Man, Bourne Legacy, etc) : monotonie du continuum d'actions surenchéries pendant plus de deux heures trente, classicisme pompier d'un petit faiseur de séries B catapulté au mauvais endroit au mauvais moment (cessons l'onanisme : Nolan est un tâcheron sans envergure passé expert dans le filmage de scénarios faussement intelligents mais vraiment débiles, dont Following et Memento restent tout juste regardables), découpage pachydermique (notons que l'adjectif est devenu laudatif selon La Dernière Heure), absence tragique de distance ironique, interminables scènes d'explications, profusion de personnages secondaires insipides et/ou pleurnichards, distribution pitoyable, dialogue plat, sex-appeal de l'emballage « latex noir » (et de la vulgaire Anne Hathaway) proche de zéro. Avec tous ses « moyens », ce Dark Knight parvient même à n'appeler à son casting que deux bons acteurs, Joseph Gordon-Levitt et Juno Temple (celle-ci à droit à trente secondes à l'écran), le reste étant perclus de rhumatismes, d'horribles voix rocailleuses, Tom Hardy qui « campe » un ridicule Bane en tête. On découvre aussi au réalisateur une fascination plus fâcheuse pour la chorégraphie de masses avançant d'un pas militaire (sous des allusions confuses à Occupy Wall Street): un goût pour l'esthétique du fascisme franchement louche même en ces temps étrangement proches des années 1975-77 (de sa « mode rétro » et ses films de nazisploitation bientôt en re-vogue). Nolan bute sur une question cruciale, jamais vraiment résolue dans le cinéma américain (et ça commençait avec Naissance d'une Nation en 1915, avec lequel ce Dark Knight partage plus d'une affinité) : comment filmer le peuple en évitant l'effet de masse, comment montrer une foule en lui donnant un visage humain, et non l'aspect d'une meute de loups enragés ? Question bien au-dessus de ses facultés bien sûr (Nolan n'est ni Griffith ni Vidor ni DeMille), auquel son film répond par une ambiguïté de propos mal placée qui en fait un anti-« Indignez-vous ». Nolan ne sait faire que du « Agenouillez-vous » (devant mes bagarres chorégraphiées, mes plans en hélicos, ma pyrotechnie, mes acteurs aux roucoulements orsonwellesiens, ...). Si on y rajoute la brusquerie des cordes et timbales immondes de Hans Zimmer, vraisemblablement sponsorisé par une association d'oto-rhinos en manque de patients, on peut concevoir que ce qui se rapproche le plus de ce film sont les bombardements de l'armée américaine en Irak. Le blockbuster moyen veut maintenant ressembler aux mauvais romans fleuves de sa mère patrie (ou à ses jeux vidéos mais certainement pas à ses comics) et ne réussit qu'à se croire plus gros que le bœuf. Qu'il s'enfle si bien qu'il crève.
Publié le 9 septembre 2012
Ou de la naïveté (barbare) du naturalisme. Ce « petit film sympa » qui ne s'attend à cueillir que de la tiédeur et se réjouir de sa moyennitude absolue (voir la presse française : assurément un film hollandien!) manquera d'avis emportés, comme il a été conçu pour les invalider, qu'on tempère donc par avance les excès de ce démontage qui n'en est d'ailleurs pas vraiment un. Fin du préambule. Ce discursif Mobile Home prolonge les longues heures de la production bâtarde franco-belge dans ce qu'elle a de plus idiot (c'est-à-dire le marchandage de sa particularité, ce qu'on pourra trouver inadmissible). Évacuons le seul motif d'étonnement d'un produit déjà-vu, pré-pensé pour ne pas fatiguer le spectateur : il n'y a pas d'handicapé dans Mobile Home (à peine un père convalescent) et pourtant il s'agit d'un « film belge » dans ce que l’appellation d'origine contrôlée a de plus pittoresque, et malgré ses difficultés d'en être un : acteurs français, mocheté banale des Ardennes surlignée, anonymat des décors comme des relations humaines, sous couvert d'une pseudo-universalité de l'amitié, l'amour et ses emmerdes. Les meilleurs comédiens belges de la distribution, comme Catherine Salée, Edwige Baily ou Gaël Maleux, sont encore une fois réduits à des seconds rôles caricaturés/raux et on en voit même certains qui se saluent en se faisant deux bises au lieu d'une : plus pratique pour l'exportation. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce film ? Difficile de le savoir : la station de deux potes en décrochage sentimental qui achètent un mobile-home pour toucher le rêve de leur quinze ans, partir sur les routes, s'offrir et goûter à la véritable liberté. Le film est très fier de l'inanité de ce parcours qui n'en est pas un, ce sur-place obligé qu'il croit ériger en propos.
On voit très bien le genre de film qu'on nous promet et François Pirot pourrait opter pour la bromance, avec l'obsession de ses personnages qui pensent plus à tirer un coup qu'à partir sur les routes et se cherchent sans arrêt des excuses pour ne pas bouger. Voilà pourtant qu'une dramaturgie de vierge effarouchée ou de midinette sous ses airs auteuriste et sociologique (genre : typologie de l'adulescent de la génération Y) programme le film, avec un coup « j'y vais » un coup « j'y vais pas » agaçant parce qu'il ne répond jamais à une oscillation des envies des personnages, mais à des coups de tête des scénaristes. Pirot devrait accepter qu'un peu de passion (lorsqu'un des thèmes du film est la passion, celle de la musique par exemple) n'est ni négligeable ni forcément méprisable. Cette tentative sociologique est d'autant plus vaine que ce concept de « génération Y » a été inventé par des créatifs de pubs pour marketer un public cible, et pas par des artistes. Et l'art ne récupèrera jamais la publicité : c'est toujours l'inverse qui se produit. Mais ça le film ne le dit pas, en faisant semblant que ce retour aux sources pourrait se confondre avec un retour à une sorte de Nature. Il est plus revitalisant d'arracher des sapins dans le vrai monde que de découvrir la vacuité de l'amitié virtuelle via facebook, même quand on est pas très doué. « Quel bonheur d'être fatigué après une journée de dur labeur » est une morale provisoire du film, très paradoxal dans son côté réalisme soviétique. Pirot n'a pas tort, il a même sûrement raison, mais encore fallait-il suivre la logique jusqu'au bout, assumer son côté semi-parodique. A la fin, ce seront pourtant les meilleurs amis (et les scénaristes) des deux potes qui avaient raison : l'un reste avec son père qu'il n'aura pas su quitter (ni heureux ni malheureux) et l'autre, qui s'est complètement affadi et dévitalisé dans son ombre, part sur les routes dans un travelling qui ne va nulle part (ni joli ni moche) mais trop tard, puisqu'on se fout déjà depuis pas mal de temps de ce qui peut lui arriver. Mobile Home se résume donc très rapidement à un fatiguant catalogue de tics de comédiens (pourtant excellents, Guillaume Gouix en tête), une tentative épuisante d'épuisement de la fonction phatique du langage, où toute la distribution se répand en hésitations, suspensions, bégaiements, tics, rhumatismes, déglutitions décalées (mention spéciale à Arthur Dupont) autant d' « effets de réel » sensés « faire vrai », qui se répand jusqu'à l'accesoirisation en forme de sinistre placement de produits locaux (des pots de sirop de Liège aux cannettes de Jupiler à la marque bien mise en évidence). Pirot fait semblant de ne pas savoir que ce « vrai » qu'il fabrique de toutes pièces est le comble du faux, de l'apprêté, de la technique pure, que ses personnages sont à mille lieux de toute réalité. Toute la spontanéité convoquée est étouffée sous cet artisanat laborieux où le spectateur est sommé non plus seulement d'admirer le jeu des acteurs, mais la facilité qu'ils ont à convoquer ces aspects microscopiques de leurs caractères.
Le réalisateur n'a pas la mémoire de Barthes, et c'est regrettable. Extrait de circonstance (il suffit de remplacer les mots écriture et Littérature par cinéma, écrivain par réalisateur, etc.), daté mais pertinent : « L'artisanat du style a produit une sous-écriture, dérivée de Flaubert, mais adaptée aux desseins de l'école naturaliste. (...) aucune écriture n'est plus artificielle que celle qui a prétendu dépeindre au plus près la Nature. L'écriture réaliste est loin d'être neutre, elle est au contraire chargée des signes les plus spectaculaires de la fabrication(...), elle ne peut jamais convaincre ; elle est condamnée à seulement dépeindre, en vertu de ce dogme qui veut qu'il n'y ait jamais qu'une seule forme optimale pour « exprimer » une réalité inerte comme un objet (...). Ces auteurs sans style -Maupassant, Zola, Daudet et leurs épigones- ont pratiqué une écriture qui fut pour eux le refuge et l'exposition des opérations artisanales qu'ils croyaient avoir chassées d'une esthétique purement passive. (...) Entre un prolétariat exclu de toute culture et une intelligentsia qui a déjà commencé à mettre la Littérature en question, la clientèle moyenne des écoles primaires et secondaires, c'est-à-dire en gros la petite bourgeoisie (Barthes écrit en 1953 -ndr), va donc trouver dans l'écriture artistico-réaliste -dont seront fait une bonne part des romans commerciaux- l'image privilégiée d'une Littérature qui a tous les signes intelligibles et éclatants de son identité. Ici la fonction de l'écrivain n'est pas tant de créer une œuvre, que de fournir une Littérature qui se voit de loin ».
Faut-il encore signaler qu'il n'y aucune idée proprement cinématographique dans ce film, rien dans l'image ou le son qui ne soit asservi et vampirisé par cette fausse virtuosité ?
Ce que les rencontres avec les amis « casés » avant le départ des deux personnages nous racontent, c'est bel et bien que seule une idéologie bobo-neuneu (qui ne dit pas son nom) est au travail, trop occupée à acheter un artificiel passé rural à ses personnages (avec les dialogues explicatifs lourdingues qu'on imagine dans le premier acte). Car à la fin, Pirot juge durement ses personnages en leur disant en somme qu'ils avaient bien tort de tenter une aventure qui n'aura mis à l'épreuve que leur amitié (la finale signe leur séparation), et qu'au fond, ils ressemblent bien à ces amis « casés » jusque dans leurs esprits fermés (qui font une rapide équation : réussite = bagnole-maison-femme) avec lesquels ils se disputaient-mais-pas-trop. Ils n'ont plus qu'à ressembler à ce rêve qui n'en est un que par défaut, se conformer et s'adapter à cette normalité qui a fracassé leur envie. Drôle d'idée, propos un peu réactionnaire qui n'a rien compris à celui de Murnau (qui n'était déjà pas le plus grand des progressistes) et qui se destine forcément à être mal interprété (voir le commentaire de Magellan ci-dessous, pas loin de penser sans rire qu'à la campagne « on est bien plus conservateur » !).
Pirot baisse la tête dans le dernier tiers, forcément déceptif mais si terriblement attendu, et débouche comme Lanners dans Les Géants sur une fin en forme d'aveu d'impuissance. Mobile Home offre à voir une mécanique bien huilée, très sophistiquée, mais qui n'avance jamais. On a évidemment le droit de préférer un cinéma qui fait bouger les lignes, ou dû moins essaye sans trop se payer la tête de ses personnages. N'est ni Judd Apatow ni réalisateur de Secret Story qui veut (pour citer deux excellentes productions en prise directe avec la génération susmentionnée). Le sur-place de Pirot n'est ni un propos ni une esthétique, c'est une mesquinerie morale, c'est toujours du sur-place.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ...
- 27