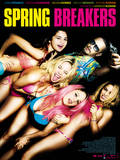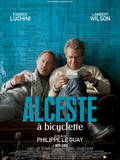VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 27
Publié le 10 avril 2013
L'époque est-elle si morne pour la middle-class que la représentation qu'en donne le cinéma américain se doit d'être elle-même terne, si aseptisée, si platement nivelée par le profilage psychologique de ses personnages que rien ne vient désengluer la morne répétition des séances de jogging, d'engueulades avec papa à la maison en caméra épaule, entrecoupées de séances chez le psy et de virées tristounettes au superbowl ? Ni Judd Apatow sous Xanax (du genre « This is 40 ») ni les frères Farrelly sans le folklore de leur « cour des miracles » habituelle ne se laisseraient aller à une telle platitude de surface, malgré la (f)rigidité partagée de leurs mises en scène respectives. Chez eux, les seconds rôles ne sont pas des prétextes à diluer l'action sur deux longues heures (un running gag insupportable avec un flic et un malade mental s'en charge) mais les authentiques porteurs d'une subversion morale (sous couvert d'une super-régression infantile) qu'on serait bien en peine de chercher ici. Le genre le plus vivifiant, rapide, cinglant et sexualisé inventé par Hollywood avec le burlesque, c'est-à-dire la screwball comedy, se résume à un training vaguement moulant porté par Jennifer Lawrence et une enfilade de scènes déjà-vues mille fois depuis Borzage. Celle du dinner sensée évoqué un « Quand Harry Rencontre Sally » dysfonctionnel et celle qui suit dans la rue, de loin les deux plus réussies, ne sont que de pâles copies de leur modèle, mais elles ont le mérite de faire partager la détresse mutuelle des personnages et de donner l'impression que le réalisateur est sorti momentanément de sa torpeur, tandis que celles de répétitions peinent à se hisser au niveau de pastiche de « Dirty Dancing ». Le film se limite donc vite à un véhicule de performances d'acteurs ; c'est sa seule raison d'être d'ailleurs, puisque son scénario ne tient pas debout, et sa mise en scène épuise son potentiel de naturalisme après une demi-heure. C'est donc logiquement qu'Hollywood a donné un Oscar à Lawrence pour sa prestation la moins sobre et la plus boulevardière de sa jeune carrière (à côté de la morale bas de plafond de « Silver Linings Playbook », « Hunger Games » passerait pour un pensum métaphysique). Il faut la voir, plongée dans la morgue de son eye-liner et de sa teinture noire, débiter des résultats de match une bière à la main d'une voix rauque, en grignotant peu à peu tout l'espace du plan jusqu'à ne rien en laisser à ses collègues comédiens, même au pauvre Robert De Niro qu'on n'avait pas vu si impliqué dans un rôle depuis bien longtemps. On sait que c'est là l'idée que le système hollywoodien se fait d'une prestation marquante (performance : se la jouer perso, et pas jouer tout court), mais force est de constater que Lawrence n'en fait ici qu'une application souvent vulgaire et qu'elle est désormais aux antipodes de l'efficacité de son air buté, déployant des trésors de sobriété dans « Winter's Bone ». Même son « You're killing me! » à sa sœur lors du concours de danse, la tête renversée en arrière, la pupille très dilatée, la mâchoire tordue en angle droit doit tout au spectacle du pathos que donnait Laura Dern dans l'inégal mais passionnant « Inland Empire » de Lynch. A l'heure du final, l'heureux effet choral du dance-contest donne l'envie à David O.Russell de se réveiller pour la seconde fois. Il enchaine trois travellings avant, la jubilation de la petite équipe est enfin lisible et l'affaire est pliée au milieu d'une rue déserte purement artificielle. Le film accouche enfin ?mais avec quelle labeur!? de son dispositif de comédie romantique mollassonne.

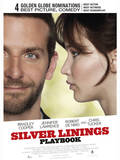
Publié le 2 avril 2013
Peu de films aujourd'hui, pour ne pas dire aucun, parviennent à empoigner les pires excès et rebuts de l'imagerie de consommation contemporaine (clips de hip-hop MTV, pubs, vidéos Youtube, photos de soirées facebook, porno hardcore, nostalgie instantanée style Instagram, le GhettoMySpace de Dan Goodman, carte postale, jeu vidéo, cinéma hollywoodien, etc.) comme le fait Spring Breakers. Il s'agit d'en presser, d'en compresser la chair digitale, glacée, pour en extraire une sève critique acide, d'en tailler des petites boucles narratives à faire virevolter dans un montage tantôt hoquetant tantôt ample, à faire tournoyer sur elles-mêmes, autant de petites gélules lysergiques dont le bad trip s'achèvera dans un tunnel meurtrier, d'en ravaler jusqu'au dégoût de la répétition pour s'en inoculer la nausée générationnelle. Korine tourne rapidement le carnaval en mascarade, la farce en cauchemar, dans une séquence d'introduction en forme de trauma, que ce grand film sur la reprise ne cessera de rechercher comme magnétisé (le périple des filles vers la Floride) puis de ressasser jusqu'à plus soif (à répéter qu'elles n'ont jamais été aussi bien, libres, que les gens sont gentils... alors que l'on ne voit que le contraire). Ailleurs, dans l'invention plastique la plus saisissante du film, le climax d'une scène d'orgie dans un appartement se prolonge d'une rêverie tellement saturée d'alcool et de drogues que les visages s'en dissolvent les uns dans les autres dans l'imagination des filles roulant vers le commissariat, des images qui figurent une suite de tableaux flottants, sorte de Francis Bacon datamoshés. L'intrigue bascule dans sa seconde moitié autour de la figure du gangster incarné par James Franco dans un schéma étrangement proche de « The Master » avec son tutorat perverti, son schéma d'influence et de domination qu'il fait mine d'installer avant de le saper de l'intérieur, son goût pour le moderne, pour l'ellipse opaque. Sur le plan moral, Korine est proche de la position de moraliste aigu du Gus Van Sant de « Elephant » et « Paranoïd Park », mais parvient à nuancer la pose avec une mise en image à l'opposé de l'indolence trompeuse des images du regretté Harris Savides. Il se tire de sa position paradoxale envers ses personnages en aimant les corps de ces filles (à commencer par celui de sa femme Rachel) et en aimant les filmer, tantôt platement comme dans la pire comédie de studio, tantôt sous toutes les coutures imaginables. Le chef-opérateur (et Belge, ce qui ne gâche rien) Benoît Debie prolonge ses expérimentations d'artificier de la photographie sur la gamme qui court nerveusement du bleu électrique au rose sang déjà parcourue pour « Enter The Void » de Gaspard Noé. Cette mécanique visuelle ne devrait pas occulter le travail sur les modulations de la lumière, qui travaillent un spectre très varié du orangé illuminé et malickien des vitraux d'églises aux néons fluo d'une station service, d'un coucher de soleil saturé sur la plage au carrelage verdâtre et glauque d'une cellule de garde-à-vue. Tout semble électrique, artificiel, chaque image est plaquée comme un palimpseste sur une ribambelle de clichés qui lui préexistent, en même temps que cette image réduit le cliché, l'écrase, pour en faire une sorte d'image au cube. Le cinéaste parvient ainsi à une prouesse en ne déviant pas d'un iota de son projet cinématographique qui consiste à faire surgir des tréfonds de l'Amérique white trash des odes au vandalisme et de faire sourdre le freak régressif qui sommeille en chacun dans un pays toujours révulsé à tout écart de la norme. Le Korine de « Spring Breakers » n'a rien cédé à celui de « Gummo » ou « Kids », au contraire il a même gagné en virulence en s'unissant au contraire du radicalisme arty/fauché de « Trash Humpers » (2009), et en célébrant cette coalescence finement incestueuse. A l'arrivée, le film est plus proche de la mission anthropographique et documentaire de Jean Rouch que des vidéos mises en scène de College Fuck Fest. Il est intéressant de noter comment le film est positionné sur le marché, avec sa bande annonce racoleuse mais complètement mensongère. En vérité, on a pas le temps de s'attarder sur les bikinis, de jouir de ces corps filmés dans des ralentis syncopés, malgré les loops purement musicaux qui les brassent à l'envi, ni même de s'offusquer du matraquage abrutissant des beats concassés de Skrillex. Si la bière coulant à flot, les sportifs américains torse nu et les filles montrant leurs seins à la caméra flanquées d'un sourire béat sont là, les fusils sur la plage, les cagoules roses à la Pussy Riot et les mains maculées de sang sur le piano recouvrent rapidement tout du poids insensé de leur visuel gangrené jusqu'à l'ahurissement pur et dur d'une reprise bouffonne et très émouvante à la fois, déjà d'anthologie, du « Everytime » de Britney Spears. Le film, changé en une gigantesque machine à broyer les déchets de trente ans d'american way of life selon MTV, se charge alors d'une furie politique qui en vient à monter en épingle une authentique « lutte raciale » entre le dealer joué par James Franco et le monopole sur le quartier d'un caïd Black, soldée par une mission expéditive et suicidaire qui donne la (dé)mesure de sa vacuité. Spring Breakers est repoussant, sale, malséant, vulgaire, grotesque, et c'est tant mieux pour tout ceux qui s'y sont fait prendre en croyant s'y rincer l’œil. James Franco y fait un grand numéro de burlesque digne du M.Merde de Denis Lavant dans « Holy Motors », et Selena Gomez impressionne dans une scène de face à face avec lui, érotique et révulsive, filmée comme un viol, qui rappelle celle entre Willem Dafoe et Laura Dern dans « Sailor et Lula ». Laissons à Korine, inlassable analyste de son propre travail en donner la meilleure définition : « This film is where retardation and transcendence intersect. » Grandiose et abruti, purement musical et euphorisant, Spring Breakers est le point terminal du modèle du « film d'une génération » déjà bien perverti par « Elephant », et l'instantané de l'effondrement de toute une civilisation.
Publié le 25 mars 2013
Beau premier film, quoique rattrapé sur ses dernières minutes par une tendance refoulée au sentimentalisme (les larmes que les héros réprimaient jusqu'à lors) sous le thème fordien de l'appartenance au territoire sur lequel on vit, l'héritage que l'on fait de ses parents, sorte de pendant ironique et contemporain au sublime « Drums Along The Mohawk » (1939) via la moiteur des marais de « Swamp Water » (Jean Renoir, 1946). La comparaison avec le cinéma de Malick dont on a bardé le film dès ses passages très remarqués en festivals,tient de l'argument publicitaire et de la paresse intellectuelle (il y a bien une voix-off, mais le ton ici est radicalement différent: ici affective et narrative plus que spirituelle) plus que de toute autre chose. Que je sache, Malick n'a jamais mis en scène d'imaginaire de personnage, comme c'est le cas ici avec les Aurochs, dû moins pas avec une telle littéralité. L'essentiel de la valeur humaine du récit passe -fait rarissime dans le cinéma américain- de l'individu vers la communauté. Le travail esthétique, à la confluence d'un southern gothic marécageux et d'effets spéciaux et spécieux à l'onirisme utilitaire (on pense à l'usage allégorique, assez similaire, qu'en faisait Bong Joon-ho dans « The Host »), poussent le film vers une « économie du milieu » franchement indécidable quant au propos mis en œuvre, qui détonne quelque peu tandis que son paradoxe initial (indie cute vs. tentation disneyenne) passe au second plan. Remarquable en revanche cette façon de ne jamais esthétiser une misère pourtant bardée de tous les apparats de la sursignifiance, ou de renforcer artificiellement la splendeur (car c'en est une) de la description hyperréaliste du bidonville –surtout lors de la nuit de tempête, où l'intérieur de la cabane se hisse à la hauteur d'un bricolage pasolinien d'un valeur quasi-ethnologique. On ne sait trop si on doit priser le travail de décorateurs ingénieux ou louer un repérage habile et respectueux de la région qui a conduit à la mise en images spectaculaire de ce lumpenprolétariat dans son bric-à-brac précieux et complètement déjeté, bientôt lessivé, enfoui sous les eaux et la boue, ce qui ne fait qu'accentuer sa qualité souterraine, primaire et primordiale, constituant comme une strate de civilisation antérieure à la nôtre, et pourtant simplement voisine. L'autre lieu marquant du film est un bordel filmé comme chez Pabst ou Von Sternberg, c'est-à-dire sorti à la fois d'un conte pour enfant et d'une rêverie d'opium, où la cruauté de la verticalité du rapport hommes-femmes et le jaillissement d'un plan de crocodile poêlé bien juteux se mêlent jusqu'à l'indistinct d'une berceuse qui emporte tout, chant des sirènes qui balaye d'un même revers réel imaginaire, rêves, utopie de classe, fantasme. Zeitlin, bien que fidèle à son filmage onirico-embedded, donne une ampleur quasi-myth(olog)ique à ses personnages, à la manière d'un Pedro Costa, en magnifiant les gestes les plus élémentaires et en changeant une série de calamités en autant de plaies d'une justice divine comme un levier propre à souder une communauté nouvelle, si bancale et précaire soit-elle (c'est le sens du plan final). La lecture en ressort forcément critique, carrément politique, et on est en droit de regretter que le réalisateur s'en embarrasse si peu.
Publié le 17 mars 2013
Le fan-club de Stephan Streker ayant fini d'obturer l'espace de ce forum en disant tout le bien qu'il se devait de dire sur son film (commentaires extatiques ci-dessous d'une volée de nouveaux inscrits qui donnent tous cinq étoiles), il est possible de parler de « Le Monde Nous Appartient » sans ce relent de copinage et de connivence qui le dessert finalement plus que tout autre chose.
Neuf ans après un premier long-métrage tout à fait réussi sur la condition solitaire du prétendant-acteur égaré dans la faune de Hollywood (« Michaël Blanco » en 2004, dont le titre international était « Life Belongs To Us »), Stephan Streker approfondit le thème, passe de la vie au monde, de l'homme aux hommes, recentre le sujet à Bruxelles et l'éclate dans une vision polyphonique. C'est la bonne idée et la limite du film, les « destins croisés » se limitant à une série de hasards et de rencontres qui s'ignorent dans la rue ou en club sur le mode répétitif du « le monde est petit » (alors que « Michael Blanco », tout aussi riche en lieux communs, disait plutôt « la vie est courte »), peut-être topographiques mais pas vraiment cinématographiques, jusqu'à une issue forcément fatale (pourquoi anticipée ?) où le fatum manque curieusement de poids. C'est que Streker n'étant ni Griffith ni Paul Thomas Anderson, il manque à son montage la respiration élémentaire qui préside à ce genre d'entreprises, le goût du court-circuit narratif (la co-présence sur les écrans de « The Master » creuse le fossé entre eux) et la progression dramatique (pourtant anticipée lourdement par un flash-forward introductif) manque de cette prédestination conviée par le genre. La fragilité et la maladresse de « Michaël Blanco » (de l'acteur M. Goldberg, du découpage minimal de Streker,du tempo quasi-liturgique, schraderien du montage) étaient, au delà de l'avalanche de références piochées dans l'Almanach du parfait petit connaisseur des « Movie Brats », ce qui faisaient sa singularité, parvenaient à émouvoir et donnaient une vision mémorable d'une ville la nuit, sujet melvillien par excellence.
Et si les prétentions de Streker-metteur en scène sont saines voire même précieuses aujourd'hui, que la vigueur et la dynamique de ses travellings-avant procurent un authentique plaisir de spectateur, que les boucles nocturnes de son récit font éclater de l'intérieur la platitude du paysage psycho-social du cinéma belge actuel, les références au cinéma américain envoyées comme des signaux de détresse sont un peu lassantes à la longue. Escalators à la De Palma dessinant des lignes de fuite bientôt bouchées, travellings kilométriques, poses de petite frappe jamesdeaniennes de Vincent Rotiers au volant, jusqu'à la faute de goût navrante d'un refrain d'Ozark Henry (« Stand By Me ») repris par toute la distribution exactement comme dans le mauvais clip d'Aimee Mann au milieu de « Magnolia » (Paul Thomas Anderson, 1998). Le meilleur du film tient sa vision au cordeau de Bruxelles, et dans quelques champs/contre-champs où Streker peut donner sa mesure de directeur d'acteurs (la déclaration d'amour de Rotiers à son assistante sociale), dans cet intimisme et cette simplicité recherchés mais efficaces (le pouce de Gourmet qui se soulève de son journal lorsqu'on lui annonce le décès de son fils) et pas dans une mise en images parfois grosse comme un rhinocéros au milieu de la rue de la Loi.
Publié le 10 mars 2013
Le vieil ermite prostré dans sa grotte, l'artiste muré dans son orgueil, le face à face de « monstres sacrés » : les archétypes et éléments constitutifs charriés par "Alceste à Bicyclette" ont de quoi rebuter a priori, au moins autant que le spectre des bons sentiments nous faisait craindre le pire avec “Les Femmes du 6è Etage” du même Philippe Le Guay, qui était pourtant une belle surprise en optant pour un sensualisme à la Renoir plutôt que pour le film social en bleu/gris à la Cédric Kahn (au pif). Et cette fois encore on aura tort. Il y a une véritable écriture “à la Le Guay” qui tarde à chaque fois à s'affirmer, mais le place deux têtes au-dessus de la moyenne du cinéma français pitchable avec deux têtes d'affiches imposées par TF1. Le moindre mérite du film est d'ailleurs de tomber à pic dans la polémique du salaire des acteurs en France. La scène où Valence (Wilson, grisonnant & très mannequin H&M) révèle son cachet par épisode de la série TV pour laquelle il est très populaire est drolatique pour la tête de chien battu que pique Luchini. Celui-ci cabotine à qui mieux-mieux évidemment, surtout dans les scènes de répétitions, mais le film étant construit comme un véhicule pour sa personnalité, on ne s'en offusquera guère : les meilleures scènes sont toutes celles où les deux comédiens ne jouent pas “Le Misanthrope”. L'intelligence du scénario est de s'échapper de son programme un peu mortifère (les comédiens qui répètent entre eux, ça ressemble à l'antichambre de la mort, comme dans le “Vous N'avez Encore Rien Vu” de Resnais) par des trouées improbables de petits bonheurs simples (balades en vélo, intermèdes gastronomiques). La construction globale de l'intrigue, plutôt téléphonée, en prend un coup mais ménage alors quelques chausses-trappes malicieux : la visite de la maison qui dilate l'annonce du titre de la pièce que Valence propose à Tanneur, l'arrivée impromptue d'une aspirante actrice X professionnelle venue observer les acteurs et déclenchant chez eux un irrésistible désir paternaliste (avec cette réplique de l'un, soudain philosophe: “On aurait pas dû la laisser partir comme ça à Bucarest, hein !”), un épisode burlesque de Wilson dans un jacuzzi, un gag digne de Quick et Flupke avec un vélo qui tombe à l'eau, un pastiche hilarant de téléfilm TF1 auquel tout le monde semble avoir pris du plaisir. La gratuité de ces moments fait leur beauté, et fait glisser le film de son sujet trop certain vers une épiphanie de l'instant et de la digression plutôt roborative. Le peu de complaisance dont le scénario fait preuve à l'égard de Luchini, pourtant impliqué au projet dès la base, laissé comme une sorte d'ermite de fable à son état végétatif dans sa maison de l'île de Ré parfumée à la fosse sceptique est relativement étonnant, laisse deviner un goût de l'acteur pour l’auto-dérision qu'on ne lui connaissait pas et dessine en creux la complicité entre l'acteur et le réalisateur. Ce dernier temporise les échanges verbeux avec une mise en scène d'une rare platitude, presque paresseuse, qui pousse tout de même le bout du nez lorsqu'il s'agit de filmer le plus intense de tout cela : c'est-à-dire non pas les revirements d'égos blessés (qui servent de coudes à la narration) mais les plaisirs de la table (un gros plan gourmand sur des crevettes décortiquées, l'irruption inattendue d'un plat d'huitres) qui constituent l'essence de ce partage.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 27