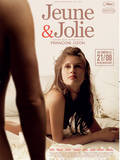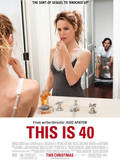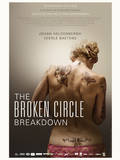VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 27
Publié le 24 novembre 2013
Voici venu le temps de faire solde de tout compte avec Pedro Almodovar. La roublardise avec laquelle s'avance ce vingtième long-métrage de l'auteur de « Tacones Lejanos » (1991), sa bande annonce sur fond de Pointer Sisters, son générique rétro-kitsch, rend comique n'importe quelle critique tentant de défendre derrière ces affèteries pas même drôles au troisième degré un pseudo-génie d'Almodovar, chacun de ses films rendant l'hypothèse plus chancelante et farfelue (relire à ce sujet les commentaires de ce forum sur « La Piel que Habito »). La piste la plus rationnelle à suivre pour « Los Amantes Pasajeros » serait qu'il s'agit d'un canular du cinéaste destiné à mesurer jusqu'à quel point certains critiques sont capables de le suivre. Disons-le tout net et tant le film s'affiche comme tel : il s'agit d'une série Z du niveau de dignité esthétique d'un roman-photo, d'une mocheté et d'une platitude publicitaire absolue et assez irrésistible, appelant moins la comparaison avec un remake sexué de « Y'a-t-il un pilote dans l'avion » des Zucker/Abrams qu'avec un anonyme téléfilm de M6 tourné en trois semaines ou la movida des débuts de l'auteur. La bonne nouvelle est qu'Almodovar se prête très volontiers à ce petit jeu de déflation de sa figure de Poulidor des festivals, versant dans l’auto caricature sans la moindre once d’auto-dérision, et assumant jusqu'au terme de ce petit carnaval bigarré, dans des nuages de mousse blanche à même le tarmac qui ne viennent pas dissiper tout à fait la rêverie, ou l'hallucination, c'est selon. On pense irrésistiblement à ces phrases de Roland Barthes : « J’éprouve pour ma part ce léger trauma de la signifiance devant certains photos-romans : « leur bêtise me touche » (telle pourrait être une certaine définition du sens obtus) ; il y aurait donc une vérité d’avenir (ou d’un très ancien passé) dans ces formes dérisoires, vulgaires, sottes, dialogiques, de la sous-culture de consommation » (dans « Le troisième sens », 1970). Au-delà de sa métaphore paresseuse de l'Espagne en crise (un avion qui chute sans fin, où le peuple est assommé de somnifères tandis que la classe affaire s'hystérise et baise à tout va), Almodovar n'a jamais cessé de travailler ces formes à la fois archaïques et post-modernes du mauvais goût hétérogène, mais le rendu en est ici d'un lisse sans pareil et sans comparaison, du pastiche pour les seules fins d'un caprice personnel roboratif. Non qu'il n'y ait de scènes réussies localement : les premières dans la cabine de pilotage, avec son défilé de personnages truculents et le running gag du verre de tequila, une quarantenaire déflorée dont l'amant presqu'involontaire, sous narcoleptique, se réveille caressé par des mèches de cheveux qui vont et viennent dans son cou, une chorégraphie dont on ne sait quoi penser sur « I'm So Excited », pas du tout comique mais pas vraiment embarrassante non plus, les plans de l’aéroport vide. En tant que comédie, le film est raté, mais il l'est tout autant lorsqu'il négocie un virage vers le drame et le thriller avec l'atterrissage de l'avion, alors que ces changements de ton et le rythme des acteurs sont en eux mêmes assez harmonieux.
Ce théâtre de boulevard est filmé avec tout le détachement et le décollement ironique que cela suppose, le scénario en pilote automatique (on dirait un premier jet foutraque d'idées mal proportionnées, accolant les saynètes sans dynamique externe) et l'intelligence du découpage en plus. La paresse d'Almodovar-metteur en scène est à la limité du péché, et l'oblige à des économies de moyens qui confirment l'orientation délibérément fauchée de l'esthétique : ainsi le traitement sonore, d'une pauvreté de sitcom (aucune ambiance de cockpit, de cabine ou extérieure, effets sonores et bruitages limités au minimum syndical), ainsi le jeu outré des stewards, dans une sorte de principe réducteur souvent salvateur pour un auteur (lire Accatone ci-dessous). Et tout ceci est assez triste, sérieux même. Même la peinture des mœurs sexuelles cède moins volontiers à la trivialité que par le passé. La bisexualité et l'homosexualité se résument à une caricature endimanchée du coryphée grec, et l'hétérosexualité reste un non-choix ravalé à une série d'images irregardables parce que trop vues (pub ou mélo, pas de demi-mesure). La « bêtise traumatisante » de ce faux objet de consommation courante n'a donc d'égal que son intelligence lisse et oubliable, et la lourdeur de son trait que le comique plat avec lequel elle s'affiche. Ceux qui veulent en découdre encore avec Almodovar trouveront quelques pages senties (« Rien sur Ma Mère »), refusées partout, dans l'excellent « Piges Choisies » de Luc Moullet (Capricci, 2009).

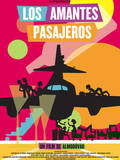
Publié le 28 août 2013
Toujours cette rétention à pouvoir estimer un cinéma où le réalisateur fait son beurre sur le dos des personnages... Ici, c'est peu de dire que François Ozon se réinvente en proxénète : il exploite, déshabille, fait pleurer, minauder, courber l'échine, non seulement au personnage de Vacth mais à tous les autres, sa famille bourgeoise trop moyenne pour être honnête, les amis d'Isabelle, flics et psys, vraisemblablement à fourrer dans le même grand sac. Il distribue les claques et les travellings avant à chaque fois que l'adolescente passe à l'horizontale ou sous la douche. Ozon se croit plus malin qu'eux et que son sujet : il a tort. C'est lui qui est bas, scabreux et sale, et son spectateur qui est haut. A côté de « Vivre sa Vie » ou « Deux ou trois choses que je sais d'elle », son film n'a vraiment pas de quoi frimer.
Le programme de « Jeune & Jolie » est celui d'un porno type (éducation d'une nymphette), recette digérée qui se décline ainsi : 1/4 de voyeurisme pur mais non assumé, 1/4 de drame familial aussi finement écrit qu'un épisode de « Plus belle la vie », 1/4 de psychologie de comptoir (absence du père, etc. même et surtout si le personnage du psychologue est moqué) et 1/4 de chronique amoureuse adolescente, encore plus paresseuse et bouffie de lieux communs que ce qui précède. En vérité, le film est à mille lieux de toute perversité et de tout malaise, ne capitalisant que sur l'idée de malaise, le concept de perversion, etc. Le symptôme et jamais la chose ou l'effet. Je ne peux que répéter un avis déjà formulé sur « Dans la Maison » : « Pas de perversité possible dans un cinéma qui n'a pas de profondeur (à l'opposé d'un Rohmer par exemple), et se borne à régurgiter des codes préexistants vaguement redistribués. Chez lui, tout n'est que pure façade », et que cette façade soit destinée à être démolie, consolidée ou ravalée ne change rien. Puisqu'il est exclu qu'Ozon soit un imbécile, il ne peut être qu'aveugle. Voir autant sans rien regarder, cela tient de l'aveuglement. L'incapacité de l'auteur à regarder sa créature autrement que comme une putain, comme une adolescente ou comme une élève témoigne de son impuissance à projeter sur les êtres autre chose que des métaphores ou des sociotypes dignes d'un sujet de JT, à ressentir le monde tel qu'il tourne, à dépasser des clichés qui le submergent et qu'il se borne à répéter. « Dans la Maison », qui souffrait des mêmes maux, s'arrêtait après deux scènes. « Jeune & Jolie » s'arrête juste après son titre, c'est pire.
Si le mystère que voulait sonder Ozon était l'adolescence, il est resté à des kilomètres de lui et ses tentatives d'approche sont plombées d'une telle roublardise de scénariste (la répétition inlassable des mêmes scènes de passe, la tautologie embarrassante des quatre parties) et d'une telle programmatique de soirée-débat qu'elles s'annulent à mesure que le film progresse : ni tout à fait dans la provocation pour les seules fins de la provocation ni tête baissée dans la comédie que le film aurait pu être (la scène hilarante de l'arrêt cardiaque du client, vite ravalée dans les monochromes du drame français sub-standard), « Jeune & Jolie » ne peut même pas profiter de son effigie dressée dans chaque plan, à force de ne voir en elle qu'une gravure de mode. Ce « voir sans regarder », cette fascination bête et méchante est d'autant plus dramatique que la simple révision distraite de quelques minutes d'un film comme « Sous le sable » (rediffusé en ce moment sur Arte) permet de se rendre compte qu'il y a dix ans encore, Ozon avait un véritable désir de cinéaste, une franchise à regarder les corps. Quand et où se sont-ils dilués, perdus ? Disons que la cruauté dont un Pabst-manipulateur de créatures était capable avec les Loulou et Thymiane jouées par Louise Brooks était le gage même de son empathie de cinéaste, et le point de départ d'un regard accru sur une réalité sociale et sur une vérité humaine que tous ses efforts concourraient à faire toucher du doigt. Il est clair que Ozon parviendrait comme il le voudrait à cette cruatué, à filmer chaque émotion et chaque réaction comme un symptôme si son film n'en était lui-même pas un, celui d'un pauvre filmage englué dans une absence de position morale bêtement compensée par cette minable attitude de donneur de leçons (le prof auquel il se substitue en le rejetant dans le off). L'esthétique vieille et moche de « Jeune & Jolie » navigue, comme tous les Ozon depuis dix ans (Potiche, Ricky, etc.) entre la sitcom M6 et le téléfilm France3 du dimanche après-midi, camouflant sous son auteurisme reblochon très 90s (perversions discrètes de la bourgeoisie) son absolue inconséquence (grand sujet, zéro traitement). La scène de fête est à l'insigne du reste : Marine Vacth (insérez deux épithètes : un mélioratif et un péjoratif) promène sa tronche de mannequin boudeur dans les pièces tandis qu'Ozon promène sa caméra sans ne rien montrer : telle amante imaginaire éconduite, tel couple qui s'embrasse, tel pauvre garçon un peu benêt en bout de parcours, seul sur la terrasse, dont la naïveté fera l'affaire en guise de conclusion des amours d'une fille trop iconique pour accéder à la beauté.
Insignifiant objet à l'arrivée, creux, plat, lisse, bâclé, mal dialogué, peu joué, pas dirigé, vaguement mieux découpé que « Dans La Maison » mais amoindri encore une fois par une série de zooms masturbatoires du pire effet, « Jeune et Jolie » contient quand même une belle scène, celle où les élèves d'une classe récitent le mantra rimbaldien du film (« On est pas sérieux quand on a dix-sept ans ») puis sont interrogés sur le sens du texte. Pendant cinq plans, on sent que Ozon se met en veille, les scrute et les écoute vraiment, presque sans condescendance. C'est peu, trop peu pour faire un film digne. Le cinéma français a donné quelques beaux films sur l'adolescence (« La Femme de l'Aviateur » de Rohmer, « 36 Fillette » de Breillat, « La Drôlesse » de Doillon, pour ne citer que trois chefs-d’œuvre) ; il est évident que celui-ci n'a ni leur trempe elliptique, ni leur ambition sociologique, ni leur acuité de regard.
Publié le 5 mai 2013
Pauvre petite comédie (française qui plus est, donc presque déjà condamnée) ! Tout ce qu'on lui demande : une construction scénaristique sans faille, un tempo démentiel, trois vannes à la seconde (dont une punchline pour la bande-annonce, si possible), de l'amplitude (sociétale, c'est permis), des acteurs convaincants et solidaires (effet « troupe » autorisé, voire indiqué), un découpage tiré au cordeau, une photographie pas trop publicitaire, quelques inventions sonores à vot' bon cœur m'sieur dames, et même une mise en scène pas trop mécanique (en option). Trop pour un seul film, pour un seul genre, même « bon (chic bon) ». De la comédie, on n'attend trop souvent uniquement des chefs d’œuvres, alors qu'on s'acclimate fort bien d'un film d'action tiède si deux séquences sont réussies (genre Fast and Furious), d'un film d'horreur absolument emmerdatoire pour deux ou trois effets amusants (style Paranormal Activity), d'un film de science-fiction raté pour un « production design » correct (« Oblivion » par exemple). A la comédie, on se permet de réclamer un niveau qualitatif et de densité qu'on ne se permettrait pas de demander à un bon gros drame d'auteur. Haneke peut manquer de la moindre once de morale dans « Amour », Audiard peut se faire esthète grotesque de la misère dans « De Rouille et d'Os », MacQueen peut se révéler incapable de simplement raccorder deux plans dans « Shame », Mingiu se draper dans ses sentencieux plans-séquences à l'épaule (« Au-dela des Collines ») : tous peuvent se permettre des creux narratifs insondables, une inconstance rythmique totale, mais Almodovar n'a pas droit à une vanne de pétomane dans son dernier film sans être mené au pilori. Le "cinéma d'ôteurs" mondialisé crève sous la fausse légende du Sujet. Il serait temps d'arracher une bonne fois pour toutes la nourriture du bec des cinéphages du dimanche affamés. Dans « Les Gamins », soit le moins-pire de la production franchouillarde de ces derniers mois, deux générations de comiques sont convoquées, mais pas pour nous inviter au spectacle traditionnel, un peu éreintant, du petit jeune qui bouffe le vieux parce qu'il est plus rapide et plus en forme. D'ailleurs Boublil éprouve parfois une forme de syncope du verbe qui sied à ce qu'il faut de décontraction chabatienne. Marciano/Boublil ont une tendresse vacharde pour l'éternel « esprit Canal » de Chabat (donc pour son humour absurde qui n'en avait que faire des histoires de couple et du quotidien), caricaturé en beauf mollasson qui végète devant sa télé, attendant qu'on vienne le désincarcérer de son canapé. Comme quoi il suffit de peu finalement : que le spectateur ait la sensation d'assister à une véritable rencontre entre deux comédiens, qui jouent ensemble et y prennent du plaisir et pas à une succession de numéros de stand-up solitaires et tristounets (le dernier Apatow par exemple, déprimant). C'est la scène du supermarché. On se fout de la gueule du vendeur, on se vanne sèchement pour s'appréhender, on picole pour se connaitre, investissement de l'espace par la dérision généralisée et les vertus de la camaraderie masculine. Une belle misogynie s'affiche et un racisme ordinaire pointe son nez : des sociotypes plutôt que des personnages. Peut-être pour cette raison, le film est incroyablement peu burlesque : ce qui a été perdu dans l'interstice générationnel, c'est décidément le corps et ce qu'on peut en faire (le couple parodiant les acteurs pornos excepté), limité à un seul gag ici, et purement onaniste -tout se perd, rien ne se transforme. Le scénario soigne aussi les seconds rôles, tous aimablement peinturlurés (mentions spéciales au sosie d'Amaury Vassili et au dealer), pris dans les mailles d'une comédie romantique qui turbine au modèle américain, et autant à la guimauverie de base starring Richard Gere qu'au régressif digéré de Farrelly/Apatow, et s'en sort plutôt bien dans la compromission -art télévisuel s'il en est, si bien qu'on lit de manière limpide la perfection du prime-time TF1 du dimanche soir que le film aura tôt fait de réussir (rassurez la famille : tout rentre dans l'ordre et dans le confort bourgeois à la fin). Ces « Gamins » ne sont pas déshonorants, pour une simple raison : pour enlever l'honneur d'un film, il faudrait d'abord qu'on ait consenti à lui en donner. C'est ainsi qu'on en viendrait presque à éprouver pour ces « Gamins » un peu lourdingues à force d'aller piquer de tous les côtés les miettes d'un charme qu'ils n'ont pas une certaine forme de pitié tendre, qui tout compte fait, n'est peut-être pas le pire des sentiments.
Publié le 18 avril 2013
Judd Apatow est en pilote automatique depuis les fades et mécaniques "Wanderlust" et "Five-Year Engagement" (2012) et sa production s'affaisse à chaque nouveau titre dans une léthargie qui repousse -c'est bien là son seul mérite- les limites de la-comédie-pas-comique. Où est passée la régression tendre de « Superbad », la peinture du mâle américain mélancolique de « Forgetting Sarah Marshall », le burlesque stone de « Pineapple Express » ? Le spin-off du couple modèle joué par Paul Rudd et Leslie Mann, seconds rôles de « Knocked Up/En Cloque Mode d'emploi » à l'heure de la crise de la quarantaine avait du bon sur le papier et semblait signer un retour aux affaires te(i)nté par l'autobiographie. Las! La mollesse de l'humour dans la plupart des scènes (quelques répliques décochées qui font mouche localement), le manque de rythme de l'ensemble (qui s'étend sur 2h20), la tendresse vacharde pour ces quarantenaires qui pètent au lit et fument en cachette n'a de réponse que dans la rigidité et les manques du découpage, parfois franchement maladroit (au magasin de Sandie, au barbecue final), qui peine à raccorder le plus basique des champ/contre-champs, et deviennent irritants. Et si Leslie Mann écarquille ses grands yeux à longueur de scènes et Paul Rudd semble avoir avalé une boite de Prozac (il n'y a qu'à comparer avec sa jubilation en surfeur crétin dans « Forgetting Sarah Marshall »), les filles Apatow sont adorables dans leurs excès de potacherie. Mais quand les enfants se bornent à jouer aux enfants et les adultes aux adultes, c'est le signe que quelque chose de ce jeu de masques avec la façade lisse prônée par la société et sa marge s'est irrémédiablement perdu. Autant dire que le système Apatow est proche de la dissolution totale, et que tout y glisse lentement vers l'agacement : la photo de studio aseptisée, qui fait ressembler chaque scène à une pub pour Ricorée et pas à une version critique du rêve de réussite américain, le conformisme petit-bourgeois vers lequel aspirent tous les personnages, l'absence d'idée et d'inventions de mise en scène, surtout dans la bande son, de relief dramatique, la monotonie de la tonalité. Les quelques bonnes vannes sont du niveau d'un stand-up généralisé où chacun jouerait pour lui seul, et la semi-improvisation coutumière de la tribu de comédiens ne s'harmonise jamais dans une vision d'ensemble qui la sous-tendrait: voir la scène où Leslie Mann fait avouer le vol de 12000$ à son employée jouée par Charlyne Yi, complètement perchée, dans un grand mais solitaire et trop court effort de cabotinage. Ça ne veut pas dire que chaque scène est ratée, il y en a même quelques réussies ci et là, et plutôt dans la première demi-heure, mais quand elles le sont elles ressemblent à des petits sketches qui, même enfilés les uns aux autres, peineraient à faire décoller le film de son horizon de chronique bardée de (dé)notations de la culture populaire américaine. Le seul plan réellement effectif émotionnellement est celui où le couple sort de la réunion de la médiatrice parentale de l'école, l'air abattu, avant d'entrer et repartir chacun dans une voiture différente, sans communiquer, mais Apatow s'y montre plus proche d'Antonioni que de Woody Allen. Pour signifier la déflation constante de l'ensemble, une scène de fête d'anniversaire vire au rire jaune, si bien que quand Jason Segel débarque avec son abattage en gourou de la gym -et de la séduction, on dirait un frère Marx égaré chez Abbott et Costello.
Publié le 14 avril 2013
A aucun moment, aucun plan, Van Groeningen ne retrouve la vigueur biographique de son précédent long-métrage (« La Merditude des Choses ») dans cet affreux tearjerker sur un couple de chanteurs country flamands qui doivent « faire face » au cancer de leur enfant. Non seulement le film est indigne (avec ses personnages complaisamment filmés dans l'hystérie qui faisait déjà friser « La Merditude... ») mais il se sert de la maladie et de l'enfant, réduit à l'état de pion perceptif -qui lui, peut souffrir en silence- comme d'un levier scénaristique à une seconde moitié qui fait la chronique du couple disloqué. On assiste en fait à une sorte de mix improbable entre « Walk The Line » et « La Guerre est Déclarée », une bardée de métaphores balourdes en plus (les vitres de la véranda où les oiseaux viennent s'écraser) et pâtissant de ces deux comparaisons, n'ayant ni la séduction narrative du premier, ni l'élan vital du second. Le film ne fait que confirmer une attirance quasi-maladive d'une frange de privilégiés du cinéma belge actuel pour le cinéma américain, et l'accointance parfois ambiguë des décors de notre campagne locale avec certains espaces de l'Amérique profonde, mais aussi souligner à quel point ce cinéma-là, miséreux, ne sait pas quoi en faire. Il va sans dire que pareil mélo, qui patauge dans ses propres suffisances, ne contient pas une image, pas une réplique, par une réaction psychologique qui ne relève pas du plus pur cliché, vu cent fois ailleurs, chez Murnau, Borzage, Sirk, Ozu, Rossellini, Kapoor, Demy, Garrel ou Gheerbrant avec cent fois plus d'intelligence affective et de bonté, magnifié par une mise en scène toute entière tournée vers une vérité humaine à (faire) toucher du doigt. Alors à quoi bon s'y mesurer, lorsqu'on n'a ni le talent ni le métier de ces hommes-là, qui avant d'être des cinéastes étaient ou sont des êtres et des moralistes à même de frémir des mêmes frémissements que leurs personnages et interprètes ? C'est aussi la preuve qu'entre un navet belge et un navet américain, il faut toujours préférer le second : parce qu'à force de n'avoir jamais peur du ridicule, l'américain évite d'y sombrer.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 27