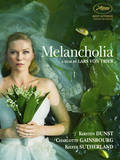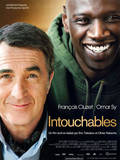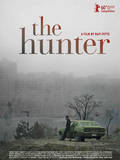VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- ...
- 27
Publié le 5 janvier 2012
L'objet du projet filmique n'est pas toujours où on le croit : le véritable sujet de La Guerre Est Déclarée sont les stratégies qu'un couple met en place pour résister à la pesanteur du quotidien. Qu'au final cela ne fonctionne pas mais que le jeu en valait la chandelle en reste une morale possible, mais pas cette morale molle qui interdirait l'humour d'une scène inouïe : celle du couple soudé la nuit précédent l'opération de leur fils qui surenchérit des possibles ratés qui pourraient le handicaper pour juguler leurs peurs. Le film et Donzelli fourmillent de ce type d'idées, en lancent quinze à la minute au spectateur sans souci d'organisation, pas toutes convaincantes (les moments de comédie musicale font franchement sous-Christophe Honoré, c'est dire...), joyeusement incohérentes (trois voix-off différentes avec le même statut) ; un inarticulé discours du cœur qui tient de la synesthésie pour spectateur. Parmi les meilleures : une soirée open-kiss, un plan de bataille puis un conciliabule à l'arrivée dans l'hôpital parisien et un mixage audacieux qui mime le lent synchronisme des amoureux (cette façon qu'ils ont de se déclarer leur amour sur un écho de piscine au beau milieu d'une soirée, de jeter ensemble leur cigarette et descendre d'un muret) qui est la condition sine qua non de leur existence en tant qu'entité. Faire les mêmes gestes à des centaines de kilomètres de distance, tomber dans les bras l'un de l'autre : ces moments de pure symbiose organique trouvés fondent une parataxe de l'amour et de la mort. Rapidement, on le comprend : déconcilier la maladie de l'enfant et l'amour dont il est le résultat ne sera pas envisageable, c'est la raison, cheville soudée à la condition d'existence du film à faire -qui ne tient en rien de l' « exorcisation » d'une expérience douloureuse, d'une mise à distance, ou même de l'auto-fiction. Les inventions vont jusqu'à trouver les inserts « malickiens » de la fusion érogène amoureuse comme de la prolifération des cellules cancéreuses dans un documentaire scientifique de Jean Painlevé des années 30 sur la cristallisation du sucre.
Un film juke-box parfois justifié (Le « O Superman » de Laurie Anderson sur l'escapade foraine), parfois comme soulignement inutile (Yuksek, Sebastien Tellier) mais qui emporte totalement l'adhésion par un torrent d'émotions contradictoires. Reste un beau secret : comment ce film parvient-il à échapper à la niaiserie (tant d'amour!) ou au voyeurisme (la pulsion autobiographique) en filmant un heureux no man's land entre les deux ? La réponse mise à plat entamerait peut-être déjà l'équilibre qui rend La Guerre Est Déclarée au statut du film français de l'année. A la fin spectateurs, détruits mais solides, on se rappelle la maxime du petit Cédric filmé par Denis Gheerbrant : La vie est immense et pleine de dangers.

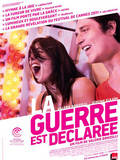
Publié le 31 décembre 2011
Publiez votre classement de vos films préférés de 2011 !
Voici le mien : 1. MELANCHOLIA, Lars von Trier / 2. HABEMUS PAPAM, Nanni Moretti / 3. MYSTERES DE LISBONNE, Raul Ruiz (2010) / 4. PATER, Alain Cavalier / 5. LE QUATTRO VOLTE, Michelangelo Frammartino / 6. LA B.M. DU SEIGNEUR, Jean-Charles Hue / 7. BLACK SWAN, Darren Aronofsky / 8. DES FILLES EN NOIR, Jean-Paul Civeyrac (2010) / 9. LA GUERRE EST DECLAREE, Valérie Donzelli / 10. LE GAMIN AU VELO, Luc & Jean-Pierre Dardenne / 11. TREE OF LIFE, Terrence Malick / 12. SUPER 8, J.J. Abrams / 13. OKI'S MOVIE, Sangsoo Hong / 14. FILM SOCIALISME, Jean-Luc Godard (2010) / 15. AURORA, Cristi Puiu / 16. BOXING GYM, Frederick Wiseman / 17. L'APOLLONIDE, Bertrand Bonello / 18. ESSENTIAL KILLING, Jerzi Skolimowski / 19. ATTENBERG, Athina Rachel Tsangari / 20. SCREAM 4, Wes Craven.
Pas vu, pas pris en compte : O TORINO LOI/ LE CHEVAL DE TURIN, Bela Tarr ; HAHAHA, Sangsoo Hong, UN ETE BRULANT, Philippe Garrel, MEEK'S CUTOFF/LA DERNIERE PISTE, Kelly Reichardt. Oki's Movie et Meek's Cutoff ne sont jamais sortis en salle en Belgique (ils n'existent même pas selon le moteur de recherche de Cinebel). La B.M. Du Seigneur a eu droit a une unique projection dans le cadre du Focus Capricci dans la programmation de l'Ecran Total, Des Filles En Noir une unique projection à l'UGC de Brouckère pour Eurociné 27, la journée du cinéma européen le 09 mai 2011 (vraisemblable « obligation culturelle » dont le complexe bruxellois s'est acquitté avec le service promotion minimum : nous étions six dans la salle du Grand Eldorado). Évidemment, c'est mieux que rien, mais tout de même ! J'ai retenu les dates de sortie belge de ces films, je spécifie "(2010)" lorsque le film est sorti sur les écrans en France l'année d'avant. La sortie officielle de A DANGEROUS METHOD est le 04/01, il sera donc comptabilisé pour 2012.
Depuis la triste fin du meilleur cinéma du pays, l'Arenberg à Bruxelles -dans une sorte d'indifférence médiatique générale absolument désolante, il devient encore plus difficile d'avoir accès à certaines cinématographies : avoir le malheur d'être Belge et aimer le cinéma signifie soit avoir un budget Thalys conséquent pour se rendre à Paris où à peu près tous les films sont visibles en salle, soit télécharger, ce qui signifie découvrir ces films entre les pixels de son écran de laptop (et dans le cas de Tarr et Garrel au moins, ce serait absolument lamentable). Que font les distributeurs, les exploitants -à part bloquer leurs salles pour deux mois avec des rouleaux-compresseurs du type "Rien A Déclarer" ou "Intouchables" (et ce, jusque dans certaines salles qui se réclament d' « art et d'essai », appellation stupide qui ne veut plus rien dire si elle a jamais voulu signifier quelque chose) ? J'aimerais pouvoir faire un constat plus optimiste, mais ce ne serait ni honnête ni représentatif de la situation.
Du reste, 2011 fut une riche année cinématographique. Bonne année 2012 à toute la communauté CINEBEL et à très bientôt !
Publié le 21 décembre 2011
La question ne se pose pas de savoir si Restless est un « grand » ou un « petit » film. C'est le film d'un grand cinéaste ; il faut l'apprécier comme tel. Dans un entretien datant de la sortie de La Mort d'Empédocle, Jean-Marie Straub rapportait ceci sur John Ford : « On lui demandait ce qu'il préférait au cinéma, il répondait "Renoir" et le journaliste demande : "Alors, dites-moi quel film de Renoir" et Ford répond : "Non, non, tous". Eh bien ça, c'est quelque chose de sérieux sur un cinéaste ; parce qu'en effet, on ne peut pas choisir parmi les films de Renoir ». Évidemment, il y a loin de la coupe de l'auteur de Mala Noche aux lèvres de celui de Partie de Campagne, et on peut choisir entre Paranoïd Park et Even Cowgirls Get The Blues, mais le bon mot est valable ici pour comprendre l'attachement qu'on peut développer face à une filmographie aussi riche, variée et pourtant cohérente, idiosyncrasique que celle d'un réalisateur capable d'aligner My Own Private Idaho, To Die For, un remake de Psycho, Elephant et Gerry en à peine plus de dix ans. Van Sant n'est évidemment pas Renoir : son style est plus immédiatement reconnaissable, mais il peut exceller aussi bien dans un film plus classique comme Milk que dans ses expérimentations sur l'adolescence qui constitue l'essentiel du cinéma des années 2000, Elephant et Paranoïd Park en tête. L'auteur au sens plein du terme ne cesse de jouer au chat et à la souris avec le système des studios hollywoodiens en injectant une personnalité forte dans les projets les plus commerciaux (Finding Forrester, Good Will Hunting), et à première vue Restless constitue plus une tentative de classicisme qu'une expérimentation Bela Tarresque à la Last Days. L'anecdote obéit ainsi au canevas très typé et cadenassé de la comédie romantique avec ses passages obligés de séparations, retrouvailles, sans beaucoup de comédie mais un surplus de romantisme mortifère, mais le grand sujet porté par Van Sant reste l'indolence de l'existence dans une esthétique de la mort au travail, avec une éthique de la consolation d'avant l'orage. Il faut louer dans cette liturgie la collaboration de Van Sant avec le chef opérateur Harris Savides (la trilogie de GVS, mais aussi Somewhere de Coppola, Zodiac et The Game de Fincher, Birth de Glazer) qui atteint de nouveaux pics : cette automne de la vie et des sentiments est magnifié mais jamais figé dans une gamme de sépias, ocres et marrons, où la lumière a la triste et belle fonction de sculpter non plus les formes et l'espace mais le temps qu'il reste, un peu à la manière de Hsiao-Hsien Hou.
Bon indice encore : confié à un réalisateur de moindre talent du genre Mottola, Gondry, Baumbach ou même Wes Anderson, les écueils d'un scénario aux scènes impossibles de ridicule auraient fait sombrer le projet. La scène de présentation d'Annabel devant la tombe des parents d'Enoch ou celles de traitements à l'hôpital en sont de bons exemples. Ici, on navigue en eaux troubles, entre une sensibilité morbide non feinte pour les personnages (désamorçage de l'effet « Love Story ») et une oscillation transparente entre adéquation à leur strict point de vue et légers décollements externes. Nulle rupture de plan ou de la musique n'accompagne la crise d'Annabel qui intervient dans la plus limpide des scènes du film : deux sœurs discutant ensemble dans leur cuisine. Plus tard, c'est la mort la plus douce jamais filmée, une sorte d'épiphanie sourde de l'amour qui se délie par un bris de verre : tout ceci n'était qu'une mise en scène des personnages eux-mêmes. A répéter à tue-tête la mort, l'invoquer et traquer ses signes dans le quotidien, Restless dessine un beau triangle (n'écartons pas le 'buddy' fantôme Hiroshi) dont il ne s'échappera pas, avec une diaphane invitation à la célébrer.
Publié le 14 décembre 2011
Intouchable, le film l'est au moins doublement pour de mauvaises raisons : par son succès écrasant il semble inaccessible au discours critique, mélioratif ou péjoratif d'ailleurs, et quand bien même on voudrait l'accrocher sur quelques points, tout se passe comme si au-delà d'un certain niveau de popularité, les commentaires qui l'accompagnaient devenaient obsolètes. Une trentaine d'avis laudatifs qui répètent tous exactement (au mot près parfois) la même chose ont-ils une utilité ? Ils ont un poids, c'est certain, mais un sens ?
Du reste il serait temps de faire un sort aux préambules oratoires (ici-dessous Philippe Masse qui nous a habitué à moins de démagogie et plus d'humour) qui préviennent, avant même l'intrusion du moindre commentaire négatif, des bémols et impressions négatives qu'on pourrait tenir sur un film, surtout lorsqu'il s'agit de rappeler un vieux fantasme : jouer l'affect pur du spectateur néophyte en pleine pulsion scopique contre l'humeur glaciale du cinéphile toujours ronchon à grommeler sur un raccord (et caricaturer ainsi deux camps qui n'existent pas dans la pratique). L'exercice « critique » ne veut pas dire juger de façon défavorable, et n'empêche à aucun moment le plaisir de spectateur (deux « art à développer » différents, pour paraphraser Brecht). Il serait temps de se décoller de ces a priori sérieusement datés. On se complait alors dans une opposition communautaire nauséeuse, où il y aurait d'un côté des critiques intellectuels, pas du tout à même de recevoir un film pour ce qu'il est, et de l'autre un public toujours enthousiaste, biberonné aveuglément au pathos et à la catharsis à 7,50€ sans s'apercevoir qu'il ne s'agit trop souvent qu'un contemporain opium des peuples. Heureusement, la critique sérieuse de films (c'est-à-dire : ailleurs qu'en Belgique) n'en est plus à ce stade depuis environ 60 ans, surtout que les questions esthétiques sont loin d'être celles qui prévalent -raison pour laquelle on pourrait effectivement dézinguer Citizen Kane en quelques phrases, mais que cela n'aurait pas grand sens et serait sûrement très gratuit. Comme si l'on ne pouvait avoir le cœur chaud et la tête froide ?
La doxa, si puissance soit-elle, ne doit pas occulter voire interdire l'exercice critique et analytique du spectateur, et certainement pas des seuls scientifiques intéressés par la sémiologie et l'épistémologie. L'art n'est pas une démocratie : le peuple n'a pas raison, sinon les blockbusters Pirates des Caraïbes et autres Harry Potter seraient les meilleurs films du monde et cela reste encore à démontrer. L'histoire du cinéma est un heureux tamis, qui nous a permis de récupérer des perles vouées à être jetés aux oubliettes pour leurs insuccès public (Citizen Kane p. ex. encore) : tout cela est admis depuis longtemps. Resterait alors une troisième histoire, contradictoire, clivée, faite de reflux et de divorces orageux, qui serait l'impossible compromis entre les deux précédentes : celle d'un art, le cinéma, et l'autre d'une industrie de grand succès populaire, qui s'avère ironiquement homonyme. Mais depuis McLuhan, nous voilà quittes en débats stériles : le message, c'est le médium. Qu'on ne revienne donc pas me sonner le glas populiste en m'opposant à une masse, dont il est aussi sous-entendu par opposition à l'autre groupe qu'elle est idiote et informe -c'est tout aussi insultant pour elle. Je n'en crois rien : nous sommes tous des spectateurs avant tout, égaux de cœur, et les préoccupations du cinéma, qui ont changé après 1945, qui ont changé après 1968, qui ont changé après 2001, sont sans exceptions des problèmes d'éthique. Le statut du cinéma est double, c'est là qu'il est un phénomène inédit : tout film prétend simultanément à être une œuvre d'art et un produit économique destiné à un public, c'est intranchable, le reste n'est qu'affaire de proportions (mais lesquelles!). Il s'agirait alors de déplacer la question sur un autre plan : à vous de choisir, esthétique et/ou politique et/ou économique, etc. Tous ces films « ne sont que » des films, comment distinguer l'un plutôt que l'autre dans une masse sinon par le discours qui les accompagnent : promotionnel souvent, critique ou analytique. Se situer dans tout cela,c'est déjà faire preuve d'un esprit (qu'on dit critique), et a fortiori a contrario du courant. L'avis de tout le monde sur une œuvre n'est pas un avis, l'unanimité n'est même pas une position ou un choix, c'est un non-choix, le plébiscite aveugle reste aveugle, or au cinéma il faut voir. Trente commentaires identiques, trente voix qui hurlent à l'unisson au chef-d'œuvre se fondent en une seule (je leur préfère le mot de Torelli : « Ti avverto se in qualche concerto troverai scritto solo dovra essere suonato da un solo violino. »), creux, qui n'a ni embouchure ni contenu, où le médium devient le massage, du consensus. Au-delà encore de ces dimensions, ces inexportables produits nationaux que sont les comédies françaises, lorsqu'ils se transforment sous l'impulsion populaire de pareils micro-phénomènes de société, deviennent bien malgré eux des véhicules idéologiques qui les dépassent. Si naïf soit-il, Intouchables propose une France qui serre la main à une autre qu'elle n'aurait jamais du rencontrer : on dirait un buddy-movie méta-sociologique. Mais l'utopie est unilatéralement compromise et la scène-clef au goût amer reste celle où Philippe dit à son ami pourquoi il a choisi Driss : parce que les « gens de cité n'ont aucune pitié ». Le film bascule alors dans une amertume terrible, et n'arrive pas à confirmer autre chose que cela, l'absence de pitié, alors que le film lui-même en a trop et s'apitoie volontiers sur la description du grand bourgeois et serre les dents lorsqu'il faut « descendre » en banlieue, là précisément où il devient difficile de lire le feelgood movie of the year vanté par le reste du monde : plutôt un mythe de Pygmalion qui se règle à coup d'ascenseur social soudain en marche (voilà pour l'utopie) mais pour l'exemplarité du cas seule, validée du cachet artificiel « basé sur une histoire vraie » qui marche toujours lorsqu'on est peu regardant sur la qualité morale de l'entreprise de mystification mise en branle par ce cinéma français récent qui met en jeu le triomphe de l'amitié et la fraternité sur l'amour (Ch'tis, Les Petits Mouchoirs, Des Hommes et des Dieux,...), avec une certaine constante misogyne assez désagréable ici. Soit encore : le dressage d'un banlieusard qui ne pense qu'aux allocs aux vertus du travail forcené et du luxe des hautes sphères sur lequel il est inquiétant que personne ne glose.
Venons-en au film, tristement minoritaire dans le propos. Cela n'a rien d'anormal, puisque tout ce qui précède semble servir de bouclier au discours sur le film lui-même : il est bien joué par Cluzet et Sy (avec un très beau avant-dernier plan sur Cluzet à la fenêtre du restaurant où il exprime une palette rare d'émotions en quelques secondes avec l'usage seul des muscles faciaux et des sourcils), on s'y amuse de beaucoup de vannes bien lancées (sur l'opéra, le Téléthon, Dunkerque), on y mouille l'œil un peu parce qu'on a mal aux jambes à force d'autant d'appels du pied, mais les défauts sont nombreux, à commencer par des personnages secondaires caricaturaux, bâclés et mal interprétés (la secrétaire Magalie, Elisa, la fille de Philippe), un canevas hyperprévisible qui bloque tout autre plaisir que celui des digressions comiques du couple Cluzet/Sy, des longueurs terribles dans la fin du 2ème acte et du 3ème, des conventions qu'on espérait dépassées comme le flash-back introductif, des ruptures de tons qui pourraient fonctionner mais mal intégrées dans le rythme global (la scène d'action en introduction, l'agression du blond stationné devant l'hôtel particulier de Philippe, l'intrigue secondaire du « petit frère » dont on se fiche comme d'une guigne), et la maladresse réaliste descriptive d'une banlieue soudain réaliste où tout est gris et cadré en caméra épaule, et où Driss/Sy perd immédiatement son sourire solaire dès qu'il revoit sa Mütter Courage faire des ménages. Le précédent film de Nakache et Tolédano, Tellement Proches, était bien mieux écrit, moins ripoliné et mené avec plus de rigueur. Pire : sous un déluge aussi écœurant que le final plein bons sentiments prédigérés, Intouchables en vient même à devenir pour le spectateur un tant soi peu rompu à l'exercice du pathos forcené (et dragué par l'immonde piano dégoulinant de Ludovico Einaudi qui se croit peut-être dans un mauvais mélo de Cottafavi des années 40) ce paradoxal apologue au handicap : car on se dit trop souvent qu'il vaudrait parfois mieux être sourd et aveugle que de voir ça.
Publié le 7 décembre 2011
Installé à Paris mais retournant régulièrement filmer en Iran, Rafi Pitts surprend avec un film de genre qui cartographie un Téhéran blême et atone avant de prendre la tangente dans une forêt anonyme et labyrinthique. Disjonctions topographiques qui dès le prologue assènent le malaise vertigineux de nausée à la Sartre qui sera celui de son héros, entre deux chargements de carabine. Mais d'où viennent ces cliquetis métalliques réverbérés dans la grande nuit encadrant le quotidien du veilleur de nuit ? En quoi annoncent-t-il la fureur discursive qui va balayer la seconde moitié du film pour en supporter tout le poids d'une allégorie, évidente mais nécessaire, de la répression iranienne. Donne-t-il un sens au-delà du contexte posé par le fabuleux premier plan du film, un dé-zoom sur des visages révoltés qui dévoile une bande de motards bassidjis roulant sur un drapeau américain ?
Si le film prendra corps au-delà de ce squelette solitaire et mutique qu'il impose au début et risquera -c'est sa plus belle idée- de jeter un pont dramaturgique entre contexte politique local et aspirations de série B américaines, c'est grâce à ce Meursault que le cinéaste compose lui-même, opaque visage allongé d'indignation mêlée de dégoût, à la conscience soudain réveillée, au déterminisme buté par la mission programmatique qu'il s'impose. The Hunter accumule les scènes maigrement connectées les unes aux autres, installant dès son prologue une esthétique du raccord manqué, du flash-back non signalé, de la liaison par la proximité des forces en présence, et non de leur attirances l'une par l'autre. Tout comme il annonce les glissements du sens du réel que va subir son personnage principal, aussi violentes que les ellipses soulignées par le bruitage. Clic-clac. En retournant ainsi l'arme contre son pays tout entier, Pitts fait montre d'une virulence de propos rare, d'autant plus précieuse qu'il met un point d'honneur à obtenir le visa de censure de son pays afin de tourner en toute légalité et pouvoir distribuer ses films sur le territoire. D'autant, encore, que Pitts scénariste mais aussi acteur ne fait preuve d'aucune indulgence pour psychologiser de son personnage puis jeter ce trousseau de clefs toute faites au spectateur. L'homme est perdu dans un fond de champ, l'expression illisible barrée par une porte lorsqu'il apprend le décès de sa femme et de sa fille. L'enchainement causal -dont on devinera à terme qu'il s'agissait d'une vertigineuse chute morale- qui déroule alors son inéluctable réseau mène de déchéance en humiliations successives au fil, ténu mais tendu, d'un hommage au film de genre américain des années 70 (le titre est emprunté au roman de Richard Stark qui a inspiré Point Blank de John Boorman), Targets de Peter Bogdanovitch en tête. La poursuite en voiture et la longue dernière séquence en forêt soulignent cette approche détournée du polar politique, jouant du parallèle discursif comme assise d'un style rêche et acerbe à l'image de l'auteur : non réconcilié.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- ...
- 27