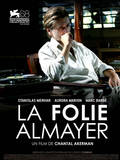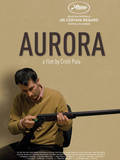VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ...
- 27
Publié le 28 mars 2012
L'Art d'Aimer, titre et intertitres empruntés à Ovide, déçoit. Les constantes du badinage à la Mouret s'y retrouvent, mais dans un système qui tourne à vide, autour d'une série d'historiettes vaguement chorales, aux entrelacs pauvrement dessinés. Son didactisme du discours amoureux le rapproche encore plus de Rohmer mais d'un Rohmer méconnu, celui des aventures de Reinette et Mirabelle plus que des Contes Moraux. C'est d'autant plus dommage qu'on tient avec Mouret un des meilleurs dialoguistes du cinéma français actuel, un Feydeau qui s'ignore (cette prédilection pour les portes et chambranles séparant les amants, les appartements voisins), et que sa petite bande d'acteurs fidèles (Bel, Stocker, Godrèche) s'élargit ici de quelques transfuges : si Ascaride est très moyenne, que Ulliel mérite une paire de claques comme d'habitude, Julie Depardieu se et nous surprend à réfréner la maladresse qui la cantonne dans des seconds rôles de grande fille gaffeuses : ça se voit, et ça lui donne paradoxalement un certain panache dans un cinéma où l'hésitation incessante, l'envie tiraillée, les troubles du langage par la passion constituent l'essence des échanges entre les êtres. Mais plus appliqué encore que le maitre, le véritable nouvel élève s'appelle ici François Cluzet et c'est un enchantement de technique et de délicatesse : certes il raffine aussi quelques tics présents à l'auto-caricature dans Les Petits Mouchoirs, mais on découvre sa précision d'horloger dans un tempo plus serré qu'à l'habitude (il faut dire qu'il a comme partenaire Frédérique Bel, qui souffle le chaud et le froid sur leurs rôles respectifs), son regard en retrait très Cary Grant lorsqu'il ne comprend pas une situation, sa mâchoire elle-même accusant un mouvement vers l'arrière, de pair avec une stature légèrement basculée, sa façon d'emplir le blanc de son œil d'une pupille pleine, d'attaquer les phrases à toute blinde sur un borborygme et de les achever sur une suspension un ton au-dessus, sa prédilection pour son profil droit et les chemises blanches au col large, tout ceci lui donne une assise, un air effaré qu'on pressentait ailleurs mais qui n'avait jamais donné une telle pleine mesure.
La brise burlesque qui soufflait explicitement sur Fais-Moi Plaisir!, où Mouret campait un Gaston à la libido sérieusement titillée, a disparu ici. Elle revitalisait pourtant sa mécanique de récits gigognes, et laissait augurer un autre futur pour le cinéma de Mouret. A choisir, redécouvrez donc plutôt Changement d'Adresse et Fais-Moi Plaisir, deux des meilleures comédies françaises des années 2000.

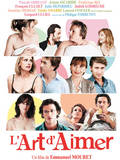
Publié le 23 mars 2012
Des sentiments sans carnation ni lendemains et du principe d'incertitude laissé dans le sillon de l'école de Berlin (cette nouvelle Nouvelle Vague du cinéma d'outre-Rhin qui émergea début 2000) et très précisément par le Yella de Christian Petzold (2008), arrive Unter Dir Die Stadt plus d'un an après sa sortie française (sur les écrans liégeois du moins, et pour deux séances seulement ; il me semble que feu l'Arenberg l'avait programmé en juin dernier). Ces deux films situent les contours opaques de leur forme sur l'axe du thriller, dont le sujet apparent est un énième trio adultère, (très) vaguement inspiré des amours contrariées de David & Bethsabée -si les Inrocks le disent... Il est cependant un quatrième coin à ce triangle, en termes strictement géométriques, puisque la ville joue ici le rôle de l'intermédiaire, puis de l'adjuvant puis de l'opposant de ces deux trajectoires humaines convergentes (qui se tendent à se rejoindre quelque part vers l'infini). Il est beaucoup question dans les discussions de Svenja de l'attachement qu'elle éprouve pour sa ville natale, sa difficulté de s'attacher à Francfort, surtout quand l'ombre se dessine de devoir déménager à nouveau pour l'Indonésie. Enchevêtrement compliqué de béton et de verre, de portes translucides et d'artificielles tâches de verdure, obstacle concret contre lequel la peau vient achopper, la ville délimite et constate, la ville sous ceux qui du haut de la tour qu'ils ont érigé dirigent le monde depuis cet obscène symbole phallique, eux les nouveaux méchants idéels du cinéma et de la société, et aussi longtemps que le premier réfractera les questions de la seconde : les banquiers dont la rapacité n'est plus à démont(r)er mais qui gardent quelques cartouches de mystère et une aura de sadisme autour de leur personnalité afin de réassoir si besoin en est un pouvoir abstrait dans un futur illusoire, à moins qu'une simple cigarette suffisent à les craindre (comme c'est le cas dans une scène ici sur l'abus de pouvoir). Neutraliser l'ennemi sans se salir les mains semblent être leur préoccupation majeure, et se fier à l'impersonnalité de leurs toujours impeccables costumes trois pièces risquerait de faire manquer les éclats d'une colère accumulée dans un ascenseur ou les sourires carnassiers des vainqueurs se changeant en rictus. Cette neutralité de façade sert Hochhäusler, dont la moindre référence n'est pas bressonienne mais hitchcockienne (le premier plan du film, autour d'un sac à main, évoque directement celui de Marnie) : comme dans Torn Curtain par exemple, le feu des passions couve sous la glace des atmosphères de complot et des cadres au scalpel, et l'amour est le nerf de la guerre (hors-champ). Ce « sehnsucht », cette nostalgie pour les corps, Hochhäusler en raréfie l'usage pour en multiplier l'intensité : les effets sont d'autant plus ravageurs que ces scènes sont introduites brutalement, sèchement interprétées. A force de fouiller la plaie, le cinéaste semble trouver, souterraine, cette chaleur, cette sensualité promise. Son prix, heureusement détaché de considérations morales, c'est une dialectique simple (démarche centrifuge) entre les humains et leurs machines, leurs humeurs et la nouvelle « neutralité » du monde et des renvois (démarche centripète) à l'histoire du cinéma, plutôt abondants quitte à frôler la sclérose.
C'est chaque plan que Hochhäusler fait jouer sur un niveau intertextuel, ne serait-ce les abondantes allusions thématiques à la modernité cinématographique et son inoxydable « incommunicabilité » du couple, cependant qu'il « invente » ni plus ni moins qu'une proposition de recadrage en post-production qui débouche sur de stupéfiants gros plans (de purs rapprochés dans l'axe en l'occurrence) dont la concrétion forme une série de champs aveugles dans le film, l'élevant du sens obvie au sens obtus -pour reprendre la terminologie de Barthes. La technique la voici (développée dans un article paru dans les Cahiers n°672 de novembre 2011) : chaque scène est couverte en un plan large (ou mastershot) qui est ensuite recadrée en post-production pour fabriquer des inserts, ou bien pour y appliquer des mouvements de type travelling latéral générés électroniquement, à un stade de création du film moins couteux que celui du plateau de tournage. On peut discuter la fiabilité du processus, notamment dans sa perte de qualité et de définition de l'image de ce nouvel avatar de la volonté de maitrise absolue du cinéaste coupé de certaines considérations économiques et techniques (le 4K pourrait-il minimiser ces effets ?), toujours est-il qu'Hochhäusler le tire vers des propositions esthétiques franchement inédites, et qu'on peut aussi en lire aisément les avantages : le mystère peut venir de la plus neutre et banale des chambres d'hôtel, l'inquiétante étrangeté peut naitre d'un accroc dans un mur, d'un biscuit croqué. Cela lui permet aussi de gagner du temps pour travailler le jeu d'acteurs en plateau et éviter au maximum les consensus qu'entrainent naturellement le tournage de chaque nouveau plan.
Je parlais de la forme d'un thriller : elle se matérialise autour d'une oscillation des pôles narratifs. Leçon d'Hitchcock encore : c'est sortir du point de vue des personnages pour voir « objectivement » la bombe placée sous leur table qui crée quinze minutes de tension, de suspense au lieu de quinze seconde de surprise à son explosion. La scène d'écoute de Gang Gang Dance le met en évidence autour d'un simple effet d'auricularisation : il y a un avant et un après dans chaque scène de la première moitié du film. Ce qui, ailleurs, peut être dérangeant, est ici valeur ajoutée à cette ambivalence de la narration que Hochhäusler veut donner à ressentir (celle-là même de la séquence finale de l'Eclisse d'Antonioni ?) et ce qui change ou plutôt qui glisse, c'est bien le point de vue spectatoriel. Ce passage de l'un à l'autre, temporisé, rappellent les corps à leur mission contemporaine : lutter contre l'envahisseur urbain, contre ces quartiers d'affaires technocratiques qui ne ressemblent pas à des constructions humaines et déconnectent les individus qui y sont plongés les uns des autres. Et le tout dernier plan, une fois encore, est un exemplaire recouvrement du réel comme une claque à la figure des personnage, une politique du pire à l'image de la virgule dichotomique du titre : à trop garder distante notre vie du monde « d'en bas », on n'a pas vu la catastrophe arriver.
Publié le 18 mars 2012
« Librement adapté » de Conrad (précise le générique), La Folie Almayer scelle surtout les retrouvailles avec une veine romanesque, pour ne pas dire romantique et lyrique des fictions de Chantal Akerman, La Captive en tête. Cela commence avec l'ondulation réfléchie de la lune dans les eaux troubles d'un fleuve sur le prélude de Tristan et Isolde de Wagner, celui-là même qui nous sciait dans le siège de Melancholia voici six mois. Dans un dancing borgne au fin fond du Cambodge, un homme s'avance vers la scène où un autre homme, plus jeune, croone sur Sway de Dean Martin. L'homme monte sur scène et poignarde le chanteur, les danseuses vahinés s'échappent toutes sauf une, qui reste comme en transe, imperturbable à mimer des vagues de ses mains en chaloupant du bassin. A l'annonce de la mort du chanteur, elle s'arrête, avance vers le devant de la scène et entonne une élégie. Pour peu, on se croirait au Club Silencio de Mulholland Drive, avec le playback interrompu par crise cardiaque avant le Llorlando de Rebekah Del Rio. « Avant, ailleurs » racontera, sans balises, ce qui a amené à cette scène, soit un amour filial déchiré par un mystérieux chercheur d'or(qui a la stature et le charme ténébreux de Marc Barbé) puis par la folie de la solitude paternelle, stationné ad vitam dans sa maison (la folie du titre) en lisière de la forêt hostile.
Ne nous laissons pas duper par cette apparente construction en flash-backs : là où Akerman nous entraine, c'est là où le tracé des routes s'achève, où les rives du récit sont débordées par d'incessants reflux haptiques, des syncopes hallucinatoires qui prennent la trajectoire de longs travellings latéraux. Le roman de Conrad était d'ailleurs sous-titré : « histoire d'une rivière d'Orient ». Ces trajectoires sinueuses, serpentines bousculées des accès de colère du personnage de Stanislas Merhar, deviennent rapidement le squelette souterrain du film, qui dessine en filigrane sa forme même. Contrairement à un large pan de sa filmographie, Almayer n'est pas un film dont le dispositif précède le récit, ou l'assujettit à une structure qu'il génère lui-même (Hotel Monterey, Jeanne Dielman, Nuit et Jour,etc.), parfois donné tel quel dans le titre (Je Tu Il Elle, Saute Ma Ville), et qui a parfois rapproché l'œuvre d'Akerman des promesses transversales de la muséification.
L'improvisation du tournage offre une structure certes incertaine, mais réjouissante pour son absence de complexe quant à son rendement narratif. Tel dialogue explicatif fait tout à coup progresser d'un bond le récit qui s'enfonçait jusqu'à lors dans la forêt tropicale, dans des baroud dignes de ceux d'Apichatpong Weerasethakul. La comparaison n'est pas que superficielle, puisque c'est dans une même torpeur hallucinée que se noient les interprètes, et que les travellings finissent sur leurs mêmes visages figés dans la végétation luxuriante, guettant l'ami/ennemi tapis dans une semi-obscurité. Et le spectateur de s'engouffrer à leur suite, trop heureux de gouter à l'éblouissement de soudaines percées de soleil à travers les branches ou d'un bain mérité sur le fleuve doré. Car la lune reflétée dans l'eau ne se révèlera être qu'un phare de bateau s'avançant vers le ponton, une tempête éclatera dans la nuit ; le réel de l'existence (qui pour Akerman comme Conrad, précède l'essence) viendra comme un fantôme hanter les âmes jusqu'à en être le seul palpable reflet.
C'est que la cinéaste raffine surtout une esthétique de la prosopopée qui est une constante chez elle, portée plus par les absences que la présence de deux interprètes rêvés (rêveurs) : la première est Nina jouée par Aurora Marion. Son visage buté, barré par un front très droit, ses yeux d'un noir impénétrable, son regard hypnotise avant de dévorer sa proie, et ses deux lentes avancées d'un plan large jusqu'au très gros plan constituent deux climax possibles de la fiction. Son statut évanescent de modèle désincarné est lui-même menacé par un retour de réel en vase communicant : virée du pensionnat, elle redevient une trop petite fille qui fume pour se donner un air de grande, mais se retrouve vite à errer dans les rues de la ville, voler une mangue, pisser dans une ruelle. Mais l'instant d'après, elle change encore de visage, de peau : languide, elle fume au pied d'un arbre, louvoyant avec son amant, le dangereux mercenaire Daïn.
Quant à Stanislas Merhar, épatant cargo fantôme qui prête sa carcasse voutée au poids des années qui ne passent pas, sa composition spectrale rappelle la phrase de Ionesco : « La raison, c'est la folie du plus fort ». Exhibant faiblesse, déréliction, désespoir, rage contrite, il achemine lentement son corps vers le splendide plan final où avec une rarissime économie d'effets -un papillonnement de cils fébriles, laissant le soleil se déposer douloureusement sur ses mèches blondes- il obscurcit son regard d'un voile d'absence qui se mue en une tristesse insondable. Le meilleur film d'Akerman depuis Sud (1999) et formellement une de ses expériences les plus abouties sur la direction d'acteurs.
Publié le 7 mars 2012
Viorel, un quarantenaire qui vient d'être licencié (ou de quitter son emploi) couche avec une femme, en épie une autre marchant avec un enfant dans un terrain vague de la périphérie de Bucarest, se rend à l'usine, à l'armurerie, achète un fusil, mange ses tartines en voiture, prend une douche, essaie le fusil, fait des préparatifs pour rénover son appartement,... Vers 1h20 de film, il abat deux personnes dans le parking d'un grand hôtel. Il faudra en tout 3h de film pour comprendre ou du moins entendre ses motivations, et connaitre l'identité des victimes. Puiu le dramaturge a troqué l'absurde pour l'existentialisme, le Ionesco de La Leçon pour le Camus de l'Etranger, mais a gardé intact son humour noir, le cynisme de situations extrêmement tendues (une simple découpe de pommes de terre avec un regard oscillant de la lame du couteau à la jugulaire de la ménagère devient un suspens difficilement soutenable) puis déliées (innombrables gestes non-interprétatifs de Viorel, errances dans des appartements). Au fil d'erratiques plan-séquences semi-répétés pourtant pleins de panache et d'assurance, il coule une chape d'obscurité identificatrice sur ses scènes les plus « béhavioristes » qui contaminent jusqu'à la narration. Il trouve (comme le Rafi Pitts de The Hunter) dans la position du réalisateur-acteur une autre possibilité de ne pas laisser le spectateur s'identifier à son rôle, et jeter aux orties toute psychologie. Difficile d'établir les liens entre les personnages, leur relation d'appartenance les uns aux autres, le dialogue reste extrêmement laconique, les situations floues : tous les principes utilisés par Puiu concourent à brouiller l'intelligibilité de son récit, et c'est tant mieux, puisque ses buts ne sont pas là. Tout le film se dérobe à notre rationnel, notre volonté de rassembler les bribes d'information ; la résistance créée par ce procédé est jouissive pour peu qu'on accepte cette convention nouvelle. La caméra a pris ses distances pour se satisfaire le plus souvent de la captation pure du temps réel, des automatismes des actions humaines. Puiu désosse le thriller comme Skolimowski déshabillait le film d'action : pour en tirer une forme épurée, tendant vers l'abstraction, pour en purger une essence métaphysique qui se dérobe à nous lorsqu'on a le sentiment de l'attraper. Aurora, qui emprunte presque son titre à Murnau, pourrait tout aussi bien s'appeler Essential Killing. La représentation de la violence, qui est l'autre question de ces deux films, Puiu la traite avec un luxe de précision effarant (les préparatifs) et de réalisme terrifiant (le volume des détonations, la rapidité de l'acte) qui ne vire jamais à la boucherie gratuite. Ty Burrs du Boston Globe écrira avec beaucoup de justesse « It's refreshing to be in the hands of a director who knows what violence is ».
Sur un plan plus classique, le sujet de la banalité du mal avec refus de psychologie a été vu dix mille fois dans le film d'auteur contemporain, mais peut-être jamais avec une telle obstination descriptive, une telle volonté d'éprouver le spectateur et de le hanter par le temps et la topographie des espaces filmés (la caméra est certes à l'épaule, mais comme chez Straub ou Rohmer, fixée en un seul point de la scène et panote sur son axe pour suivre l'action). 3h de film, ce n'est pas tellement long pour nous donner la sensation de l'importance que c'est d'ôter une vie humaine tout en assistant à l'effondrement moral d'un homme loin d'être un monstre, d'autant qu'aucun tic ou code de jeu d'acteur facile ne vient l'appuyer.
« Je vais essayer d'être le plus précis possible » se confie finalement Viorel. Le plus effrayant dans le système Puiu, c'est peut-être encore sa glaçante précision. Ne dévoilons pas davantage l'excellent dialogue final, traversé d'une douce folie, qui nous laisse entendre un temps que nous nous serions fait avoir sur la santé mentale du protagoniste. Le réseau réflexif dans lequel Puiu nous invite à rentrer est bien celui d'un tueur à la frontière de la folie. Nouvelle conscience opaque masculine dans ce cinéma roumain contemporain, proche du policier de Politist, Adjectiv qui aurait basculé au delà de son questionnement sur les lois. Mais Aurora franchit un pas de plus dans la disparition de l'arrière-plan socio-politique qui apparente cette cinématographie nationale à une énième poussée du néo-réalisme. Rien que de l'humain en berne ici, dans des accès de glauque et de tragique en sourdine : c'est toute l'ambition comme la limite du principe. Rien que l'arrachage, méticuleux et finalement transgressif, d'un décorum à son époque, d'un document à sa fiction, de sa part d'ombre à un homme.
Publié le 18 février 2012
Nouvelle fantaisie en couleurs du trio Abel-Gordon et Romy, La Fée s'échappe une fois encore du côté de la côte (comme dirait Varda) pour dévider sa mélancolie humaniste à travers un carnaval de corps dégingandés, une frise de situations rocambolesques qui cheminent lentement les unes vers les autres (toutes lignes d'horizon gardées) dans une miniature d'humour poétique et perforée tout droite sortie d'une orgue de barbarie. Dans ce nombre congru de décors rapidement topographiables (hotel, hopital, bar, plage, en boucle), le plaisir toujours conscient du spectateur reste intact à pénétrer dans un univers autarcique régi par ses règles propres (jusqu'à celles de la pesanteur). Tati-esque paradigme : la comédie, c'est la vie regardée avec suffisamment d'attention. Comme les marches des hôpitaux sont toujours enfumées, les fous toujours affectueux, les vêtements faits pour être portés. Trop regarder, ou regarder de trop près (comme le patron super-myope du bar l'Amour Flou), ça crée plus que des ellipses jour/nuit étonnantes, mais des trouées du temps, comme l'effet de révélation de la nuit des policiers passée dans l'entrée de l'hôtel sans trouver le bouton pour activer la porte. Humour = décalage, et les différentes plaques tectoniques du réel s'entrechoquent dans La Fée : l'une d'elle, moins harmonieusement assemblée aux autres, tient d'une vague dimension sociale avec la sous-intrigue des trois émigrés -qui clôt d'ailleurs le film avec un léger goût d'amertume.
Vu de l'extérieur territorial (La Fée frappe contre les parois de son bocal), il y aurait fort à comprendre que cette douce absurdie à la belge sonne aussi comme un cachet de qualité, peut-être aussi gangrénante que la tradition de qualité à la dent dure du cinéma français : il serait peut-être grand temps de commencer à s'en méfier, avant que ne se forge un folklore bariolé qui collera aux doigts comme le sparadrap du Capitaine Haddock -je sais que je vous parle. Ce film signe après tout (et avant tout) la conception d'un burlesque hybride qui emprunte l'esthétique de la course poursuite à Buster Keaton, le minimalisme sourcilleux et socialement inquiété des décors de Kaurismaki, le rigorisme du cadre bressonien et les grandes silhouettes malhabiles à Jacques Tati, les corps dansés de Pina Bausch, la fantaisie marine coloré en-chantée à Jacques Demy et Walt Disney, plus toute la tristesse qui sourd délicatement derrière chacun d'eux. Humour = politesse du désespoir.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- ...
- 27