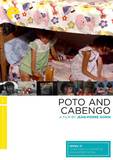VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- ...
- 27
Publié le 3 juillet 2012
Un mécanicien taciturne sort de prison (Robert John Burke, à l'underplay bressonien) et revient dans sa petite ville de province natale, comme un étranger au début d'un western. Une lycéenne qui rêve de fin du monde (regrettée Adrienne Shelly) solde son existence proprette et son futur tout tracé pour partir avec lui. L'actualité de ce film qui se termine par un discret mouvement de grue ascendant des deux amants regardant arriver la catastrophe à l'horizon n'est pas à démontrer : la politique mondiale et les spectres d'hier ont changé, mais le climat dépressif et le sentiment d'urgence dépassée sont étrangement similaires. Apocalypse now, redux. Les premiers films d'Hal Hartley, réalisés dans un mouchoir de poche entre 1989 et 1993 sont arrivés en Europe en sorties successives, de l'automne 1991 et l'hiver 1993. Indépendant, Hal Hartley l'est économiquement, mais aussi et surtout esthétiquement : The Unbelievable Truth (1989), Trust (1990), Simple Men (1992), Survivng Desire (1983) & Flirt (1993) faisaient entendre sa voix bien personnelle, mais bien solitaire aussi. L'inouï chez Hartley tient d'une condensation narrative autour d'observation de la vie en banlieue des petites villes telle qu'il n'y avait guère alors que Lynch avec Blue Velvet, et plus lointainement Preston Sturges, pour la satiriser. "What is she talkin' about ?" demande le père très terre-à-terre qui ne comprend rien aux prédictions nostradamusiennes de sa fille à la table du petit-déjeuner. "She's talking about the end of the world, and by the way the washing machine is broken !" répond la mère en trainant les pieds, voilà pour le ton décapant de l'ensemble. Un découpage intense, une puissance dynamique de volumes qui n'est pas sans évoquer Raoul Walsh (ses axes favorisant les diagonales du cadre, ses angles d'attaques et de fin de scènes qui témoignent du même esprit de synthèse, de la même concision), un tranchant opaque de l'ellipse et des cuts du montage, une dilatation, un suspens des réactions de personnages, un retard dans la réplique d'où nait un intense humour à froid, laconique et pince-sans-rire. Il y a des petits mouvements de caméra, comme le travelling demi-circulaire dans le garage, ou la très légère ascension de grue du plan final, mais ils sont toujours discrets, très coulés. Peu de cinéastes, hormis Clint Eastwood peut-être, auront si bien fait entendre le désarroi moral (ce "teen angst") et l'état psychique perturbé des années 90 naissantes, un état d'hypersensibilité épidermique mais aussi de détachement désincarné, une façon d'être au monde sans être au réel qui se radicalisera début 2000 (Elephant de Van Sant) qu'on retrouve plus en musique chez Yo La Tengo bien sûr (souvent au générique de ses films), Morphine, Red House Painters, Low, Slint, Lycia, Galaxie 500 ou Windy & Carl mais aussi chez Lisa Germano, Lida Husik, Juliana Hatfield (qui semblent les modèles les plus directs pour l'inspiration de ses personnages féminins). La musique de Jim Coleman anticipe d'ailleurs ici le "Edge of the Ape Oven" des Royal Trux de trois ans (boite à rythme disloquée et guitare désossée). Vus à hauteur d'homme, leçon bressonienne oblige, ses personnages sont d'une extrême solitude et profondeur, dotés d'une riche vie intérieure même si parfois réduits à des silhouettes ou croqués en deux répliques (le photographe), et surtout très inquiets, sans avenir plausible. Ce sont les femmes qui prédisent et ressentent l'imminente fin du monde tandis que les hommes feignent de se déchirer dans des combats de coqs pour se faire remarquer. Hal Hartley, cœur à vif, forge un vocabulaire personnel entre l'existentialisme de Schatzberg, celui de Malick et l'absurde de Jim Jarmusch (et donc de Beckett), dans le cinéma indépendant américain toujours préoccupé par les vies à la dérive, sans attaches, et les schèmes éprouvés de la comédie de mœurs cynique. Todd Solondz, très influencé par Hartley, en sera le point d'aboutissement.
En exhibant le squelette de son storytelling rôdé (les intertitres « but », « meanwhile » en sont les stigmates), Hartley pose des archétypes pour mieux leur planter dans le dos un récit de comédie romantique à la Miracle of Morgan's Creek, où Chris Cooke ressemble d'ailleurs à William Demarest. Nombre de spectateurs cesseraient de s'emballer pour les fades comédies actuelles s'ils connaissaient seulement le travail, injustement oublié, de Hal Hartley.


Publié le 27 juin 2012
What kind of bird are you, Wes Anderson ? Le présent Moonrise Kingdom, titre d'un paradis terrestre tout indiqué, n'apporte qu'un élément partiel de réponse. La conviction que met l'auteur à reproduire un royaume magique et perdu de l'enfance est sensible dès la première séquence, fabuleuse leçon de découpage en forme de coupes entomologiques sur une maison de poupée bien réelle à coups de travellings lissant les parois, appuyé par Britten en renfort discursif. Ça se poursuit avec une sorte de Luc Moullet local qui nous plante didactiquement le décor de l'île (cartes à l'appui) et l'affleurement d'un burlesque discret ici et là : Edward Norton qui marche plié en deux dans la tente de Sam, l'inventaire des bagages de Suzy (charmante Kara Hayward), une mouche sur l'oreille de Bruce Willis, le jet de chaussure de Bill Murray sur Norton. En découvrant les joies du tournage au grand air après Fantastic Mr Fox, film d'animation et donc de studio par excellence, Anderson ne réenvisage pas sa mise en scène mais conforte en une série de repères topographiques sa vision géométrique et ordonnée du plan, et laisse la porte de l'émotion ouverte sur tout le segment central, bien séparé des figures d'ordre qu'incarne chaque personnage adulte. Ainsi, dans ce monde confortable et harmonieux, primitivement perspectiviste, on peut surprendre une image d'une violence inouïe (avec un basculement d'axe à 180°), celle de Sam perçant les oreilles de sa belle à l'hameçon tandis qu'un virginal filet de sang coule dans sa nuque, mais celle-ci est absorbée dans un flux de teintes automnales et de trucages bricolés qui tendent plus vers l'authenticité de l'évocation d'un univers imaginaire enfantin que vers l'emballage arty. Un peu ce qu'était Eternal Sunshine à Michel Gondry comparé à ses autres films : la légitimation par le sujet d'une esthétique maniériste dans une adéquation fond/forme qui la justifie tout en confortant ce style sur la longueur d'un long-métrage. C'est un autre écoulement, véritable torrent d'eau cette fois, qui fait revivre l'art de la maquette et l'effet spécial argentique (le Scout Master Ward sauvant le Commander Pierce), jusqu'à la sève quasi-hitchcockienne d'une poursuite à l'énergie paratonnerre au final sur le sommet de la chapelle. Contrairement à ce que les exégètes andersoniens affirment, Moonrise Kingdom pourra plaire à ceux que les précédents films de l'auteur n'avaient pas convaincus : les scènes à deux de l'escapade du couple Kara Hayward et Jared Gilman et surtout leur danse maladroite sur la plage sur fond de Françoise Hardy, un usage modéré et surprenant du gros plan pour faire surgir l'émotion (retrouvailles en plein champ, dans les vestiaires), la condensation narrative brillante qui résume la relation épistolaire des enfants, la magnificence du sentiment amoureux avec le ralenti simple de la cérémonie de mariage sont des expressions inédites d'un romantisme incroyablement décomplexé, même gonflé d'une nostalgie envahissante, dans ces temps où ce sentiment s'exhibe avec beaucoup de noirceurs morbides (Habemus Papam, Melancholia,...). Moonrise Kingdom, film tout entier vu par le prisme de jumelles d'aventuriers en culottes courtes, compte parmi les plus beaux zooms que nous ayons vus depuis les années 70, et un merveilleux générique final qui rend à Desplat ce qui appartenait à Britten.
Publié le 21 juin 2012
Avengers commence mal, dans une lenteur impossible pour un film d'action de 2012, avec une improbable imitation de Stargate, plus un peu d'X-Men, de Transformers et une scène de torture presque purgée du bondage attendu de la Black Widow (Scarlett Johansson) par les services secrets russes en la personne de... Jerzy Skolimowski ! Soit l'opposition personnifiée du « drôle de » film d'action à l'européenne (Essential Killing) et du film d'action U.S. dans le cadre de celui-ci : devinez qui gagne... Et du reste ça ne s'arrangera pas : la monotonie de ce gros nanar sans ambiance n'a d'équivalent que dans la logique additive qui préside à la rédaction de son scénario. Plus de stars, plus de combats, plus d'argent, plus longtemps mais pour quoi ? Pour qu'au fond, le spectateur en vienne à se dire que ça a quelque chose de vexant qu'une bande de dix mecs en collants sauve l'humanité toute entière en se passant les plats lourdement, dans une guerre d'égos qui déborde le cadre du scénario sans être pour autant une option digne de le relancer, surtout lorsque le jeu de massacre accepte de descendre de ces cieux pour poser en ville son combat final, qui rappelle fort celui de Transformers 3 en moins inventif mais tout aussi éprouvant. Les civils deviennent soudainement un enjeu vingt minutes avant la fin du film alors qu'on en voit pas un seul pendant deux heures. « With all of this happening now, people will need a bit of old-fashioned » : pas sûr que cette réplique de Tony Stark (R.Downey Jr., dans le seul numéro à sauver) ait été intégrée par quiconque de l'équipe de ce film qui compte trop peu de dénotations humoristiques sur l'imaginaire technologique (à la Minority Report de Spielberg) et de sous-entendus, sur l'homosexualité de Loki par exemple, qui donnait au Thor de Kenneth Branagh son ton de récréation dérisoire. Les corps sont incroyablement peu érotisés et mis en valeurs dans Avengers, celui de Johansson en tête, coincé dans les brillances d'une photographie à la patine rétro, un sound-design sans imagination, une bande originale horriblement routinière, un découpage pauvre et sans imagination. Mais si Avengers est une réponse, le bruit et la fureur équivalents, à la franchise de Michael Bay, ce n'est que pour maintenir l'assertion que le cinéma n'a rien à gagner en forgeant dans la pâte numérique sa nouvelle mythologie, plus protubérante que la précédente, où les corps sont souples, pas habiles mais agiles (comme chez Bresson) et manipulés, mais où l'émotion reste un maigre filet dont tout le monde semble se méfier terriblement. Un inlassable « retour du même » qui surligne la décadence qualitative du cinéma mainstream américain depuis quinze ans. Alors, quelle différence avec Act of Valor, le film de propagande sur la Navy Seal qui bouche actuellement les écrans ? La réalité du terrain ? Rien n'est moins sûr... Avengers est taillé de la même écorce : une éreintante démonstration de la suprématie de l'armée américaine (qui y croit encore ?) agrémentée du dévoiement de notre devise nationale et de trop d' inside jokes qui ne feront sourire que les nerds qui se rendent chaque année en pèlerinage au comic-con de San Diego.
Publié le 17 juin 2012
La virilité n'est désormais plus le monopole des blockbusters militaristes et belliqueux made in U.S.A. Dans un boucan d'enfer comparable, un certain cinéma d'auteur (d'hauteurs plutôt, vu sa façon de lever le menton face au spectateur avant de lui asséner une gifle d'une main tout en le caressant dans le sens du poil de l'autre) peut lui aussi mont(r)er du poing et axer sur des épisodes de violence complaisante ou de curieux avatars de la Loi du Talion son moteur dramaturgique, démonstration institutionnalisée à l'appui avec les films de la Compétition Officielle cannoise cette année (voir Cahiers du Cinéma n°679) : théories masculinistes, réponses burnées et surenchère à-qui-mieux-mieux avancées par Reygadas, Hillcoat, Loznitsa, Seidl, Haneke qui refont dans la cour de récré la compet' de qui a le plus gros film : le plus sérieux, le plus pessimiste, le plus dur, le plus long, le plus prise-de-tête (dans le Reygadas, très littéralement, le personnage s'en autodécapite de joie). Ecrasé sous des tonnes d'intentions et un storytelling envahissant, on voit dans De Rouille et d'Os, brassage malheureux de plusieurs nouvelles de Craig Davidson, davantage le film qu'Audiard aurait pu réaliser que celui qu'il a effectivement fait : en film d'action dans la lignée des bandes-dessinées graphiques de Luc Besson (les combats de coqs auquel se livre le personnage de Matthias Schoenaerts), ou en comédie érotique (scène très drôle où Schoenaerts demande tout de go à Cotillard si elle “veut baiser”, lui étant “opérationnel”), l'objet aurait pu tenir la route, c'est-à-dire en épousant un peu aveuglément la courbe de son personnage principal, cette force brutale et imbécile qui traverse le film comme une balle perdue. Schoenaerts est la bonne nouvelle (sinon la révélation pour certains) du film, en homme fracturé au front buté qui a gardé une partie du charisme bovin de Rundskop pour le transférer dans ce nouveau corps, plus sculptural, un peu improbable (voir les yeux écarquillées de Cotillard -elle fait ça très bien- le regardant se battre). Dommage que le prologue passé, on en vienne à voir venir les coups du sort comme autant de signatures de la plume des auteurs pour surnager dans une bluette qui ne s'assume pas, à mi-chemin entre un Intouchables hétéro, empesé de ralentis édifiants et un Biutiful moins symboliste mais aussi stupidement esthète. Le plus désagréable reste pourtant à venir... Œil pour œil et dent pour dent, et même ravalé à une série de combats de coqs ineptes, De Rouille et d'Os devient une démonstration un poil fascisante dans le registre de Avengers ou Hunger Games (par exemple) sur un struggle for life darwiniste pour apprendre comment énoncer son petit catéchisme audiovisuel (le héros finit avec sa famille dysfonctionnelle en star souriante du free fight) dans une scène finale d'un ridicule éprouvé. Les intentions spiritualistes prônées par Audiard et son scénariste Thomas Bidegain (une quasi-scène de prière sur Katy Perry), l'envie de dépeindre une esthétique « de la Grande Dépression » feront pouffer à la vision du film, qui sous couvert de fable sociale veut attirer la sympathie pour un personnage de brute imbécile qui bat son fils et fait perdre son emploi à sa sœur avant de se racheter in extremis dans une scène à l'hôpital où Audiard frôle son modèle avoué, Alejandro Gonzalez Inarritu (cette scène au téléphone fait écho à celle de Brad Pitt dans Babel), autre champion du forcing scénaristique bassement immoral. Audiard semble mûr au niveau de sa mise en scène (cadrage et étalonnage surtout) pour son fantasme secret : rejoindre l'écurie de Luc Besson et nous délivrer enfin le film d'action décervelé qui lui pend au nez depuis quelques années maintenant.
Publié le 12 juin 2012
Authentique curiosité à (re?)découvrir que ce film de Jean-Pierre Gorin, compère des années mao de Jean-Luc Godard (crédité co-réalisateur de Vent d'Est, Tout Va Bien,...) et édité en DVD par Criterion. Gorin part aux États-Unis sur la trace de deux fillettes, sœurs jumelles qui jusqu'à l'âge de sept ans ont développé un langage parlé et compréhensible par elles seules. Les scientifiques, pédopsychiatres, et autres linguistes les examinent et s’interrogent tandis que la presse les bombarde en une avec une hypothèse sensationnaliste : l’invention d’une langue nouvelle. La beauté et la puissance du film est de faire d'un enjeu théorique majeur du siècle, le langage, sur lequel tous les grands auteurs se sont penchés, de Proust à Barthes, de Blanchot à Debord, un enjeu pratique et même vital. Poto & Cabengo est d'abord touchant, dans la solitude un peu autistique de ces deux enfants jouant ensemble sous les caméras des scientifiques qui les regardent comme des objets d'études ; puis iconoclaste, à mesure que Gorin, dans une démarche ethnographique et sociologique, s'approche de leurs lieux de vie et décrit un environnement familial tragiquement banal (une optique loufoque qui rejoint celle des premiers Errol Morris, The Gates of Heaven (1978) et Vernon, Florida (1981)) ; ensuite terrifiant lorsqu'il apparait que les carences et la confusion dans l'anglais et l'allemand parlés et mêlés indistinctement par les parents et la grand-mère qui ont élevés les enfants sont à la source de leurs troubles syntaxiques et identitaires dont celles-ci se sont protégés comme elles le pouvaient, avec leurs moyens minuscules et leurs façons espièglement subversives, mais en ouvrant sous leurs pieds un gouffre existentiel qu'elles n'auraient du voisiner qu'à l'adolescence. La technique simple de Gorin, alternant interviews de spécialistes et des adultes, scènes de vie quotidienne et de jeu des enfants prises sur le vif, et écrans noirs où il inscrit son trouble avec humour (il fait défiler des chaines de points d'interrogation et de « What are they saying ? ») accuse positivement de l'influence godardienne : arrêts sur image, cut au noir, cartons, voix-off venue de cette nuit du cinéma donnent un tempo hésitant mais un rythme très sûr au film, sorte de valse étourdie (la course de Gorin après les fillettes à la bibliothèque, véritable leçon d'humilité face à l'altérité) entre passé proche, présent et futur annoncé. Car le cinéaste, qui vient pour briser le regard précédent, celui des analystes, est (à son tour) vu par les enfants comme une porte d'entrée vers le monde. Cette brèche qu'il forme entre l'intérieur et l'extérieur servira aux filles à s'extirper de leur étouffant cocon, et offrira au spectateur cette séquence inouïe, que tout cinéaste devrait visionner avant d'aller filmer son prochain, où le réalisateur attrape grâce à quelques heureux hasards le mouvement frénétique de deux filles découvrant l'univers tout entier (animaux, livres, autres enfants,...) mais se fait surtout distancer, dépassé par le plaisir des filles de déambuler dans un espace ouvert jusqu'à les perdre de sa caméra dans une joyeuse cacophonie. L'émouvante question se déplace alors, et ce n'est bientôt plus : ces enfants sont-elles d'une intelligence différente pour s'être inventées ce monde voisin du nôtre ou sont-elles mentalement retardées pour leur incapacité à apprendre l'anglais ? Mais bien : comment, étant étrangères à notre monde, retirées de lui et surprotégées jusque dans leur domicile, comment vont-elles pouvoir y entrer, comment vont-elles parvenir à communiquer, se faire comprendre, à aller vers l'Autre ? L'analyse prime chez Gorin, mais pas sur les parallèles que l'auteur peut établir entre sa situation d'étranger et la leur. Poto et Cabengo, Grace et Virginia portent en elles toute la tristesse d'un monde auquel elles n'ont même pas accès, mais l'entêtement naïf qu'elles mettent, et Gorin à leur suite, à refuser de la laisser les submerger (Virginia prise de panique à l'idée de prendre le bus) est encore le plus fort. Pas une économie concertée de l'émotion, mais des images de son équivalence dans une dialectique insoluble de la solitude du cinéaste, du noir originel de la salle de cinéma, et du discours comme clef d'accès à ce monde à portée de mains. A la fin, il n'y a plus que les regards immenses et réciproques, perdus et retrouvés, inquiets et frondeurs de ces jumelles à jamais dissonantes à ceux qui les entourent.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- ...
- 27