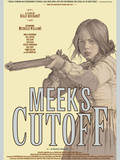VictorB
- 37 ans
- Membre depuis le 17/05/2011
- Nombre de critiques : 131
Films préférés de l'utilisateur VictorB
Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- ...
- 27
Publié le 3 septembre 2012
Pour le meilleur et pour le pire, dans sa filmographie en dents de scie mais qu'il faut défendre, Wes Craven a tellement infusé le genre jusqu'à le saturer de signes, de codes et de dispositifs spéculaires qu'il semblerait que certains de ses films tardifs, le présent My Soul To Take (2010, sorti en France ce mois-ci) et Scream 4 (2011), n'obéissent qu'à une vaste programmatique qui les dépasse en redistribuant ces signes dans un ordre vaguement variable, mais avec une joie de mettre en scène et une densité narrative furieuse et réjouissante. On peut véritablement parler de cinéaste en courant alternatif, tour à tour adoré et détesté, entre ses échecs abyssaux (Music of the Heart, Cursed,...) et ses réussites éclatantes (Hills Have Eyes, Nightmare on Elm Street, Shocker, Scream 1 & 4,...). Il y avait les couples hitchcockiens, qui se formaient dans le suspens et la poursuite, sous la menace et il y a les communautés craveniennes, fondées dans et par l'horreur et le meurtre. Éric Rohmer rêvait jadis d'un ordinateur qui distribuerait des synopsis de film : on dirait que Wes Craven l'a inventé. Mais My Soul to Take (magnifique titre) ne donne pas le temps de se reposer sur ces beaux gosses décervelés et brutaux, forcément capitaines de l'équipe de rugby, ce trio de mean girls, dont la meneuse froide révèle forcément une sœur fragile, cette WASP rousse forcément fervente tendance Shyamalan, cet aveugle plus lucide que tous et ce duo de nerds, buddies parfois digne du burlesque (l'instant magnifique où ils s'observent à faire les mêmes gestes et dire les mêmes choses dans le couloir avant d'entamer une chorégraphie proche de la scène du miroir de Duck Soup des Marx Brothers). Craven part du cliché, le plus éculé possible, pourvu qu'il n'y parvienne jamais : le burlesque mène au tueur (comme dans Nightmare), les poursuites sur des fausses pistes où la tension se perd soudain, les niveaux de réalité enchâssés s'écrasent les uns sur les autres dans une perplexité partagée par le spectateur, un peu déceptive mais enterrée sous un goût facétieux pour les coups de théâtre à répétition. A ce titre, Craven est l'opposé d'un Shyamalan dont il aime moquer les archétypes (la rousse wasp précitée, très Bryce Dallas Howard dans The Village) : Craven tourne des pastiches là où Shyamalan réalise des fables très premier degré. Le premier utilise l'horreur visible, la soif de monstration, mais aussi vise à une certaine platitude dans l'accumulation absurde des morts et des rebondissements, il est très américain ; le second est un cinéaste du suspense et la croyance pure, ralentit sans cesse la narration et retarde si possible jusqu'à l'annuler la vision de l'horreur, mise sur le hors-champ, avec une sensibilité dans l'héritage des cinéastes européens (Hitchcock et Tourneur). Une même admiration mêlée d'envie de sabordage des codes narratifs hollywoodiens les unit, mais les sépare radicalement dans le traitement qu'ils leur réservent, l'un plein de discorde et de rage (New Nightmare, la tétralogie Scream), et l'autre de respect (le fabuleux Lady in the Water, Signs, Unbreakable). Craven n'est jamais aussi habile que lorsqu'il enfile les actions à vitesse dans l'étourdissante séquence d'introduction en flashback, aux points de vues aussi schizophrènes pour le tueur que pour le spectateur, où lorsqu'il côtoie le grotesque d'une balade en forêt qui vire à la mauvaise plaisanterie, puis suspend son déroulé pour un coup de téléphone involontairement létal. Virtuosité : les communications téléphoniques, qui empoisonnaient déjà la saga Scream dès son meurtre matriciel semblent obséder Craven (une scène brillante de Scream 4 y était dédiée), et jouent un rôle subversif de frein aux folles embardées du récit, notamment parce qu'elles détournent toujours momentanément l'attention (et dans le film d'horreur, seul le moment et l'instant sont fatals) et suspendent les scènes les plus capitales de l'action, en même temps qu'elles signalent au spectateur la lame qui va venir saigner les personnages. Sociologue qui s'ignore, Craven n'a jamais radioscopé ou disséqué tel un entomologiste l'adolescence et ses « mal-êtres » (qui sont souvent des aspirations d'« être-ailleurs ») comme Gus Van Sant l'a fait par exemple ; il a véritablement été avec les adolescents. Si on sépare les cinéastes entre ceux qui analysent les jeunes générations de l'extérieur et ceux qui s'y intègrent et parlent pour elle, Craven fait partie des seconds. C'est son humanisme à lui, anti-carriériste dans un système hollywoodien qui n'attend que des carrières et pas des œuvres, derrière les boucheries agathachristesque de ses fausses bande-dessinées et le graphisme de ses flots d’hémoglobine. A ce titre empathique (et emphatique), il crée ici un de ses plus beaux personnages, l'anti-héros Bug (Max Thieriot) assailli par les âmes des morts autant que par les fausses pistes et chausse-trappes du récit, dont la plus grande culpabilité est d'être trop naïf et l'incertitude d’être au monde est la plus grande douleur. La fin du film, décevante, est la conséquence des dégâts collatéraux qui ont affectés le film. Réécritures, recastings, retakes, blocages des distributeurs : en tout plus de trois ans (Craven répétait à sa femme : « Celui-ci aura ma peau! », quelques années après son quadruple pontage), sans parler de la réception critique désastreuse du film aux États-Unis expliquent ce retard du film en Europe où il a failli ne jamais sortir. Mais cette finale simple au whodunit est finalement bienvenue : elle dégonfle avec une dérision peu commune un scénario de tous les possibles dans un univoque qui aplatit le genre à sa propre suffisance : un réveil poisseux de la métempsycose.


Publié le 28 août 2012
Mystères de Lisbonne tisse une toile d'araignée romanesque à la Dumas autour du personnage de l'orphelin Joao, recueilli par le Père Dinis dans un pensionnat de la fin du XIXè siècle. Adaptation d'une saga littéraire de Camilo Castelo Branco (Amor de Perdição, Francisca adaptés par de Oliveira), Mystères de Lisbonne brasse une matière tellement ample qu'il ouvre sans cesse sur des dimensions enchâssées, des histoires génératrices d'histoires elles-mêmes (sujet Ruizien), à l'image de ces personnages d'observateurs de l'action (serviteurs, enfants), encadrés par les portes, les fenêtres, commentant de façon picturale -Velasquez n'est jamais loin- la mise en abyme du récit. Cette démesure protubérante, ce récit inquiétant et instable car ivre de lui-même, donne surtout un relief à des personnages brossés dans leurs ambiguïtés mélodramatiques aux résonances titanesques (l'ex-gitan sulfureux devenu abbé, le traitre meurtrier qui est en fait un sauveur providentiel,...). « Comprendre {un film de Ruiz} est facile, je l'ai fait à chaque vision de ses films. Mais entre deux visions, je n'aurais pas pu raconter l'histoire à mon meilleur ami. C'est là un trait baroque. Le scénario, comme le reste, est en trompe-l’œil » écrivait Daney (Cahiers n°345 spécial Raoul Ruiz, mars 1983). A peine le placement minutieux de ses cartes effectué que Ruiz va saboter le jeu de l'intérieur en mixant la temporalité de façon extrêmement insideuse, capricante, opérant flash-backs, flash-forwards, multipliant les narrateurs (jusqu'à sept voix-off différentes!) autant de plans-séquences semi-circulaires, comme autant de pièces mouvantes d'un puzzle dont l'assemblage serait tellement parfait qu'il semble de plus en plus devenir impossible, jusqu'à remettre en cause comme jamais au cinéma la notion de « présent » de l'action.
Ressassement, ressouvenir, reprises kierkegardiennes, ces Mystères sont des secrets proprement cinématographiques, leur moteur créateur est perdu dans les interstices, collures et failles du montage, démultipliant les potentialités de structures à chaque détour de la Providence (si elle existe : dans les mains d'un démiurge invisible et pervers). Le film génère aussi un temps propre qui n'est ni linéaire ni cyclique, mais un dense réseau d'interférences et perturbations, bien cerné par un thème envoutant et lancinant de Jorge Arriagada. Jamais guetté par le formalisme ou l'assèchement de son concept, le film s'amuse au contraire des torsions que la chance impose au réel, à moins que ce ne soit le contraire, avec une ampleur et des détours basculant dans le surréalisme le plus pur. De larges mouvements de travelling latéraux et courbes traversent les espaces immuables et suivent ces joueurs du destin avec une obsession pour le plan-séquence, subtilité de plus dans cet art proustien, ces re-épisodages incessants et robbe-grilletiens d'un récit perforé de trous essentiels. Le découpage et la narration, faussement sobres et apaisés, font penser aux structures perverties du Bunuel tardif, mais le poids des f(r)ictions fait tituber un moment ce colosse, et la densité des fils narratifs, rebondissements et revirements du sort abrupts (Camilo Castelo Branco écrivait des pages au kilomètre) renoue ni plus ni moins avec les feuilletons fantasques de Louis Feuillade (Fantomas, Les Vampires,...) où l'arbitraire d'une conduite improvisée au jour le jour de l'intrigue débouchait lui aussi sur des bizarreries du destin finalement bien terrifiantes de réel. Sa fuite en avant est comme une chute, ses apparitions/disparitions de personnages soudaines ne semble obéir qu'à une mécanique extrêmement obscure qui se dérobe à nos sens. Et Ruiz de retomber plus loin dans son amour surréaliste pour les contre-plongées baroques et gros plans d'objets, dans l'aspect le plus décoratif de sa mise en scène (le cinéaste dont il est le plus proche est décidément Orson Welles, c'est évident depuis les Trois Couronnes du Matelot (1982) jusque dans la séduction de ses voix-off), mais tellement sapé de l'intérieur et porté à une dimension foisonnante que le film s'élève encore d'un niveau sous cette pression stylistique bienvenue. La dernière heure de la version film (4h36) est fabuleuse (L’Énigme du Père Dinis et La Vengeance de la Duchesse de Cliton). Existe aussi une version TV de 6h nettement plus sage dans sa construction. Cette saga gigogne se destine à rester le testament d'une œuvre heureusement insaisissable. Ruiz était un continent de cinéma (114 titres dans sa filmographie, aux deux tiers inconnus), son œuvre un iceberg dont ces Mystères sont la pointe émergée, mais non moins trompeuse sur ses dimensions exactes.
Publié le 22 août 2012
Avec la bande à Mandrin, brigands exilés en rase campagne dans l'Aveyron et l'Hérault du XVIIIè qui entament une nouvelle campagne de contrebande suite à l'exécution de leur meneur, Rabah Ameur-Zaïmeche (scénariste, réalisateur, acteur, producteur et même imprimeur) a trouvé une utopie pour juguler la complainte de Mandrin et par la même occasion, réalisé son meilleur film. Ameur-Zaïmeche a le goût du « poétique dans l'historique » (pour reprendre le mot d'Ishaghpour sur Godard), et celui de la fable, transforme l'essai métaphorique (Dernier Maquis) en allégorie fantasmatique mais très concrète (les combats, le marché libre). La première brise à souffler les braises du récit ne tarde pas à venir : voilà que le marquis (Jacques Nolot, dans son meilleur rôle en tant qu'acteur) recueille un colporteur égaré (Christian Milia-Darmezin) dans son carrosse. Mais le commerçant n'est pas habitué à ce mode de transport et les hoquets rocailleux de la route ne tardent pas à lui donner des hauts-le-coeur. Tandis que le colporteur supplie son hôte d'arrêter le véhicule, le fou-rire qui prend le marquis est aussi celui de l'acteur qui le joue -et qui ne le joue plus à ce moment-là. Les disjonctions et court-circuits narratifs opérés par Rabah Ameur-Zaïmeche (abrévions R.A.Z.) ne conduisent pas à une réflexion, vue et revue chez d'autres, sur le film et sa fabrication, parce qu'il aurait lu quelque part que « tout film de fiction est avant tout un documentaire sur sa fabrication », mais sur la jouissance du spectateur, en prise directe avec la confection toute artisanale du film qu'il a sous les yeux. Retour à la jouissance de la chose-cinéma contre plaisir de l'effet-cinéma (Holy Motors,Twixt : les films importants de 2012 y reviennent décidément). « Le plaisir, au cinéma, a partie liée au triomphe d'une illusion : le spectacle d'un personnage-acteur-corps-voix confondus. Au plein de cette confusion. » (S.Daney,La Rampe,p.69). Or qui vois-je dans Les Chants de Mandrin ? Le rôle ou la joie de l'acteur à le jouer ? Les deux, rigoureusement superposés. Non plus « cacher cet acteur que je ne saurais voir » mais « montrez cette confusion qui n'opère plus » mais qui peut me réjouir autant qu'elle embrase l'écran. Les plus beaux moments du film sont aussi les plus instables, et c'est toute l'honnêteté de R.A.Z. que de rendre cette fragilité du matériau à son équivoque fondateur. La démarche atteint un pic à la fin lorsque le réalisateur prend l'acteur dans ses bras et hurle le vers manquant de la complainte : « Du haut de ma potence/ Je regarde la France ». Le réalisateur endossant le rôle de Bélissard livre chacune de ses répliques au jeu des doubles sens. « On a pas besoin d'être courtisé » dit-il en farouche indépendant du cinéma français. Son cinéma, comme la bête qu'il présente au colporteur, est lui aussi « croisé avec un pur sang arabe ».
Le cinéma de R.A.Z. est tellement déconnecté de toute logique économique (et la rentabilité commence au stade de la narrativité ; ici pas besoin de raconter), guidé du seul bâton du sourcier, qu'il peut s'attarder à tout ce que le direct lui ouvre comme possibilité: escapade lyrique sur des chevaux courant en rond, injonction narrative (il suffit qu'on remarque que « les femmes sont rares » pour qu'elles apparaissent dans le plan suivant), goût pour la préciosité du langage (souvenez-vous du « ragondin » de Dernier Maquis), sensualité de la lumière (plan inouï d'une poitrine féminine soulevée par sa propre respiration).
Leur gratuité touche au sublime. Toute cette douceur ne peut pourtant pas rendre inaudible les puissants appels à l'insurrection du cinéaste : ils dessinent une communauté accueillante mais hors-la-loi (on occulte souvent la brutale ouverture du film, trois morts). Les Chants de Mandrin récompensent tous ceux qui ont cru (à raison) depuis le début en son auteur. Quand il accélère brutalement la narration où qu'il tourne face au soleil (silhouettes de cavaliers embrasées) ou qu'il partage son cadre en 2/3 de ciel-1/3 de terre, R.A.Z trouve même des restes de mythologie fordienne, qu'il fait sortir de la terre de l'Aveyron en automne comme autant de pépites égarées. Les anachronismes ne sont évidemment pas envisageables dans ce bric à brac culturel et religieux issu d'époques métissées, et qui fait penser au Pasolini de Edipo Re ou au Fassbinder de Die Niklashauser Fart. On trouve même dans leur marché du parfum pour ces dames ; on est loin des Converse subliminales de Sofia Coppola. La révolte et la révolution, c'est toujours ici et maintenant, comme les pouvoirs du cinéma. Les jurons, les teints, la bave sont bien d'aujourd'hui. Dans la plus belle scène du film, alors que les contrebandiers manquent d'être assiégés dans la ville et préparent une barricade, Bélissard cite les paroles d'A Ton Etoile écrites par Bertrand Cantat : « A la joie/ A la beauté des rêves » comme cri de guerre avant que pour conclure la scène il lance un « C'est terminé pour aujourd'hui ! » comme un assistant annoncerait une fin de journée, et que les rires éclatent de connivence. On ne sort pas du paradoxe d'être dans cette joie de faire un film et de vouloir le dire en même temps. C'est à ces paroles d'une autre chanson de Noir Désir, naturellement titrée Le Vent Nous Portera, qu'amène finalement la trajectoire de cette histoire de l'Histoire : « Infinité de destins/ On en pose un/ Qu'est-ce qu'on en retient ? ».
Publié le 14 août 2012
Silent Survivor est le titre d'une longue piste (31 minutes) inclue sur la réédition de la musique du film Angst de Gerald Kargl et signée Klaus Schulze. Morceau redécouvert sur des bandes oubliées, dont le seul point commun avec ceux de la bande originale est d'avoir été composé à la même époque, Silent Survivor a tout de l'inédit sorti du fond des tiroirs, qui ne ravira que les fans en stade terminal. La piste, avec ses drones de synthés industriels improvisés qui surgissent vers la moitié de la piste, mixés très en avant, notes plaquées sur la clavier à la manière brutale d'un Thelonius Monk, n'aurait pourtant pas dépareillé sur le film qui, fait rare, a été monté en fonction de la musique et non l'inverse (elle fut composée intégralement avant le tournage).
Quel rapport, me direz-vous, avec le film lui-même, diamant noir égaré de la boite de Pandore de la décennie, et récemment exhumé en DVD par Carlotta ? Eh bien la logique d'effacement, d'oubli, qui préside à la destinée funeste de ce film véritablement maudit.
Ce track absent est la clef pour (ne pas) entrer dans Angst, film que tout le monde semble vouloir oublier, de Schulze parce qu'il juge le résultat « ridicule » (dans les notes de l'album il écrit : « C'était un film tellement fou que je me demande qui ils auraient finalement dû arrêter : le tueur (dont s'inspire le récit -ndlr) ou le réalisateur ») au réalisateur lui-même par amertume envers le résultat final, dont il ne veut plus parler.
Gerald Kargl appartient à cette catégorie assez rare de cinéastes dont le premier long-métrage est leur chef-d’œuvre... parce qu'ils n'en ont jamais tourné d'autres ! On lui adjoindra en priorité La Nuit du Chasseur de Charles Laughton et Honeymoon Killers de Leonard Kastle. Claude Beylie écrivait au sujet du second dans « Vers une Cinémathèque Idéale », en 1982 : « Rien n'exige d'un cinéaste plus de tact et de mesure que le traitement d'un fait divers sordide (...). La monstruosité est un vrai miroir aux alouettes. C'est un succédané grossier du mélodrame, une perche boueuse tendue aux médiocres, amateurs d'émotions fortes ». Empoignant cette citation a contrario un an plus tard (même s'il ne l'a sûrement pas lue), Kargl en redéfinit le relent moraliste bon teint et implante une caméra-satellite autour de son anti-héros affolé et ridicule, un tueur vaguement inspiré d'un autre, bien réel, qui défrayait alors la chronique pour avoir assassiné dans les quelques heures qui suivaient sa sortie de prison. A mille lieux de la question malgré son évidente actualité politique (et les débats qu'on imagine sur la récidive, sur la perpétuité effective pour les psychopathes, sur leur traitement en hôpital plutôt qu'en prison), Kargl n'essaye pas de nous faire pénétrer l'esprit du tueur (comme le ferait n'importe quelle série TV policière de bas étage) mais véritablement de nous faire « tourner autour » d'un corps affolé, gluant de sueur, cet animal plus traqué que traqueur par un système d'oppression sociétal auquel le dispositif filmique se joint volontiers, le découpage se partageant en mouvement de grue ascendants complètement délirants et système de miroirs très complexe élaboré par Zbigniew Rybczy?ski permettant de tournoyer, via un système de harnais, autour de ce personnage qui nous embarque dans une traque démentielle, filmée en quasi-temps réel avec des ellipses très discrètes (de sa sortie de prison au lendemain matin). La descente aux enfers du personnage se double ainsi d'une « montée au ciel » de la caméra : cinéma du pur vertige, ni terrestre ni aérien mais occupé à mesurer la distance entre les deux, cinéma du sentiment du sol qui se dérobe sous les pieds, des échelles impossibles. Kargl invente tout un langage passant du micro au macroscopique, un grotesque carnavalesque et psychédélique (l'état d'hystérie et de transe qui saisit le tueur le réduit à l'état de gros insecte affolé) et dix prouesses techniques à la minute pour éviter de nous noyer dans un réel d'une glauquerie rarement atteinte. Grâce à cette attention au public (et à mille lieux de toute envie d'épate gratuite), Kargl évite la complaisance du cantonnement au point de vue subjectif d'un malade mental, auquel trop de réalisateurs irresponsables associent leurs spectateur. Chaque plan de Angst devient une micro-symphonie hallucinée, trop occupée à topographier l'univers de la banlieue autrichienne pour être tout à fait contaminé par la fièvre de tuer du personnage, un but unique et si simple que ses ramifications ne peuvent être que complexes, un décalage tel avec le déroulé de l'action qu'il débouche souvent sur des sommets de burlesque inattendu (la grand-mère qui meurt collée au mur), de décollement (humour=décalage, et ici on ne saurait être plus littéral) de l'horreur hyperréaliste vers le cauchemar kafkaïen. Soyons clairs mais précis : ce qui est proprement traumatisant dans Angst est le traitement de l'anecdote et du personnage par le travail de la caméra et de la mise en scène, pas cette anecdote elle-même, ni le niveau de violence ou de gore représenté, toujours rallié à l'humour (les giclées de sang subjectives des jugulaires de la fille). Le tueur-né, mais loser fini, à mille lieux des psychopathes à l'intelligence démoniaque et la précision melvilienne de toutes les séries (A à Z) américaines, rappelle volontiers le Archibald de la Cruz de Bunuel. Et le réel de tomber par pans entiers dans un imaginaire sordide qui renverse la vieille opposition réalité/fantasme (où le second est vécu comme un échappatoire à la première), tandis que le tueur nous inonde d'une voix-off au curieux statut (écrite au passé comme une confession) qui ne cesse d'évoluer à mesure que les « plans » qu'il élabore se soldent par des échecs les uns après les autres, dessinant une figure de minable monomaniaque incapable d'exécuter son délire. L'originalité de ce ton, de cette thématique finalement rohmerienne de l'écart entre les intentions énoncées d'un homme et ses actes réels, se mesure bien à l'extrait qui suit : « Je montrerai ces cadavres à mes futures victimes : elles en mourront de peur » annonce le tueur dans son délire tandis qu'il sort de la propriété en voiture avec les corps dans le coffre. A peine a-t-il fait dix mètres qu'il percute un autre véhicule et prend péniblement la fuite dans un état de panique total avant d'être arrêté à la station service où son calvaire avait commencé, dans un calme absolu. La même année 1983 verra l'antithèse de Angst sortir sur les écrans : L'argent de Bresson. La société est omniprésente dans L'argent ; le protagoniste de Angst s'en coupe immédiatement après un contact traumatisant (scène de la station service). Mais l'un comme l'autre, débarrassés de leur aura funeste, sont des films d'une profonde tristesse sur l'incapacité de vivre dans un monde mécanisé où les gens sont des machines absurdes aux réactions téléguidées. Nihilistes, ni l'un ni l'autre ne dessinent d'échappatoire, de rêveries ni de solution même provisoire (sinon la repentance chez Bresson le catholique, mais elle est bien maigre en proportion du chemin de croix).
La (re)découverte de ce Angst se double donc de la cruauté qu'une telle inventivité de metteur en scène, une telle originalité de ton, une telle audace formelle ait été réduite au silence suite à cet échec public (sans compter les entraves en France de la commission de contrôle, insensible au caractère de farce grossière du film), dont l'influence se sent pourtant sur toute une génération de cinéastes de genre. On peut voir toute la filmographie de Gaspard Noé (pour ne citer que lui, Seul Contre Tous en tête) comme des variations mineures sur Angst.
Publié le 10 août 2012
A côté des grands faiseurs de la machine « alternative » américaine (car c'en est une aussi : les Jim Jarmusch, Richard Kelly et autres Kevin Smith, tous en panne aujourd'hui) et des tribus de poseurs-prétendants à Sundance, aussitôt apparus aussitôt disparus (Shane Carruth, collection printemps-été 2004 : quelqu'un a des nouvelles ?), on trouve une poignée de cinéastes qui tracent des sillons d'une discrétion incroyable, qui pourra leur assurer cette hypothétique gloire une fois venue -c'est un pari, entendons-nous bien, dans un renversement de force directement proportionnel, je veux dire l'accès au saint des saints : la postérité. Kelly Reichardt est l'une d'eux, et c'est une femme, ce qui est encore plus rare et notable. Elle ne va pas essayer de rouler des mécaniques à la Kathryn Bigelow ou Debra Granik, serrer les dents plus fort que les mecs dans un milieu hyper-macho, ou aller ânonner stupidement des slogans dans des manifs du MLF. Non, son truc, c'est le cinéma de territoire, et plutôt bien circonscrit : une longue promenade en dehors des cartes établies d'un pays bien étrange, les États-Unis (l'Oregon précisément, ici Burns, et avant ça Portland et Bagby Hot Springs), qu'on ne reconnait jamais dans ses films alors qu'en bon spectateur on le connait bien sans y être allé. Autant Old Joy (2006) était aqueux, moite, que Meek's Cutoff est asséché, aride. Reichardt y place sa caméra à l'arrière d'un convoi de braves, pionniers malgré eux, échappés de leur groupe et perdus dans l'Ouest américain par la faute d'un cowboy incompétent (le Meek du titre, l'accent too much de Bruce Greenwood). Ça commence les pieds dans l'eau pour se poursuivre sur une série de sols différents, plus ou moins craquelés, salés, blancs, infinis. Ça ne s'achèvera, au prix d'une longue errance, que sur une timide note d'espoir : un arbre maigrelet au milieu de rien, mais synonyme éteint de vie quand même. Cette recherche de la terre promise est en prise directe avec le John Ford de Wagonmaster (1950), limpide référence lorsqu'il s'agit de faire traverser aux chariots une pente raide. La fin, une leçon de démocratie et amorce du passage de la loi naturelle à la loi des hommes comme Ford les affectionnait, où Meek l'autoritaire borné s'en remet à la femme et à l'Indien simultanément, leur assignant la mission de guide pour la suite du récit, produit une curieuse occurrence entre ces deux figures impossibles du western. L’Indien, longtemps bloc d'altérité impénétrable, hors champ inquiétant de l'action, peut maintenant trouver à qui mesurer sa solitude de personnage marginal et condamné au silence, enfin échanger avec elle un regard à travers les branches de l'arbre de vie desséché. Il s'éloigne, dans le regard de la petite troupe : il n'y a plus qu'à le suivre. Rod Rondeaux, cascadeur à Hollywood, endosse le rôle et porte cette absolue altérité jusqu'à l'inoubliable plan final, rédimant secrètement celui de la Prisonnière du Désert. Sauf que pour Reichardt, ce grand récit biblique que Ford n'a jamais cessé de raconter est à réécrire du point de vue de celles qui déchiffrent mal les tractations des hommes, celles qui se lèvent en premier dans la nuit pour moudre le café, celles qui aperçoivent en premier les Indiens. Son film est un des plus directement mais intelligemment féministe vu depuis des années. Elle a compris que la femme dans le western (maman, enfant, tenancière de saloon ou putain) est toujours le personnage qui assiste discrètement à l'action des hommes sans pouvoir y prendre part, mais qui perçoit, entend, comprend tout de sa perspective différente ; son féminisme est cinématographique : une affaire de point de vue, visuel (la caméra un peu trop éloignée, renversée dans l'autre axe comme un contre-champ longtemps gardé secret) et sonore (les voix un peu trop éloignées des hommes pour être intelligibles). Ne rognant jamais sur ce principe, Reichardt fait de Meek's Cutoff un film très intéressant et subversif dans son apport sur les focalisations dans le western. Elle a aussi le don de créer des images entêtantes, curieuses et simplement symboliques : splendide passage d'une rivière où l'une des épouses porte à bout de bras une cage à oiseau ; inoubliable image de ces trois corps avançant contre le soleil, à l'arrière du convoi ; travelling insensé sur une femme qui cherche son foulard emporté par le vent puis revient vers son mari en criant son nom, etc. L’Amérique de Reichardt ressemble à celle des débuts d'Errol Morris, le pittoresque en moins, l'existentialisme d'un Jerry Schatzberg en plus. Ce n'est pas tant une Amérique de désaxés, de marginaux que de promeneurs solitaires, parce qu'ils n'appartiennent à aucune terre, qu'ils ne sont nulle part chez eux. Le parcours du territoire n'est pas tellement une trajectoire et plus le territoire est circonscrit, mieux il sera investi et fera écho à la déroute du personnage : on peut tourner en rond, voire rester sur place. La première heure de Wendy & Lucy (2008) se déroule dans un périmètre d'une centaine de mètres carrés. Wendy, déjà jouée par Michelle Williams, y répète sans cesse « I'm just passing through ». Si Mikhaël Hers était américain, on peut parier que ses films ressembleraient à ceux de Reichardt : même magistrale intensité et opacité dans le rendu du temps, hypersensibilité de l'instant, une sorte de réalisme magique qui aurait déchanté de sa capacité à s'échapper du réel, mêmes « actes apparemment sans intérêt qui font surgir à tout un sens profond » (Luc Moullet). Comme dans le cinéma des Straub ou de Ford, le vent a beaucoup d'importance dans la narration chez Reichardt. Tous les personnages de ses films marchent contre le vent, et prennent un rythme spécifique : lorsqu'ils avancent le temps est comme bloqué, ils se « déplacent » physiquement peu. Lorsqu'ils ne bougent pas en revanche, le temps s'écoule de façon organique, mais c'est une douleur car on mesure que même les bons moments que l'on vit sont en train de fuir, de nous glisser des mains, à moins qu'ils ne soient déjà que la trace d'autres passés (Old Joy). Les personnages luttent davantage contre eux même que contre les autres, et ont un compagnonnage forcé, douloureux mais résolu avec les éléments.
Note : merci donc aux Grignoux, entre deux séances de téléfilms-TF1 à la Quand Je Serai Petit et de Darknighteries blockbustées de se rappeler vaguement qu'ils ont une mission culturelle. Ce Meek's Cutoff n'a aucune chance face à eux, même dans les salles sensées le protéger, ce qui prouve que les exploitants sont trop souvent de petits frileux aux vues étroites et accessoirement que le monde est mal fait. Délai d'attente : un an et seule une mesquine dizaine de séances pour le voir, autant dire qu'il vaut mieux ne pas partir en vacances. Un an de plus que le reste du monde pour (re)découvrir le splendide Deep End de Skolimowski ou le Ich will doch nur, daß ihr mich liebt de Fassbinder, un an de retard pour voir enfin ce Meek's Cutoff réalisé en 2010. Reichardt, elle, prépare déjà Night Moves, et on sait qu'on peut compter sur elle.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- ...
- 27