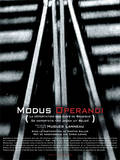crissou
- Membre depuis le 23/08/2006
- Nombre de critiques : 147
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ...
- 30
Publié le 29 août 2008
Epouse de Miguel Enriquez, dirigeant assassiné du MIR, Carmen Castillo est exilée à Paris à partir de 1977. Elle devient écrivain et réalisatrice. Ses livres et ses films évoquent son pays, la lutte pour la liberté et la démocratie et la situation du continent latino-américain.
Nouveau documentaire sur le Chili, Calle Santa Fe s'intéresse à la période qui a suivi le coup d'Etat du 11 septembre 1973. Ce film suit le parcours du MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) dont son combat contre la dictature du général Pinochet. Le point de départ de ce récit historique et personnel, l'attaque par l'armée de la maison de Miguel Enriquez et Carmen Castillo, calle Sante Fe, le 5 octobre 1974.
Au travers de ce documentaire, Carmen Castillo mêle histoire personnelle, chronologie du MIR, de sa création (1965) à son démantèlement (1989), et Chili d'aujourd'hui. Calle Sante Fe est autant un documentaire de mémoire qu'une remise en question des actions menées pendant cette période. Basculant d'interviews à des documents historiques en passant par de nombreux témoignages, sa longue durée (2h45) ne se fait à aucun moment ressentir.
Calla Santa Fe apparaissait comme un exercice difficile, parler d'histoire tout en y étant intiment liée pouvait se révéler très casse gueule. Pourtant, Carmen Castillo s'en sort à merveille grâce au fait, qu'elle remet en question l'utilité du MIR, pour lequel elle militait. Son film réussit à retracer l'histoire du MIR, les événements de l'après coup d'état ainsi que de son combat et de son questionnement personnel. Calle Santa Fe nous fait découvrir avec justesse une autre facette du Chili des années 70 !
Á Retenir : deux jeunes rappeurs militants, des voisins à la mémoire efficace, des parents compréhensifs, une maison remplie de biblots et des souvenirs douloureux.


Publié le 27 août 2008
Né à Varsovie en 1962, Andrzej Jakimowski a réalisé plusieurs documentaires. En 2002, il écrit, réalise et produit avec ses propres fonds, Plisse Les Yeux, son 1er long métrage. En 2005, il participe au projet Solidarnosc, Solidarnosc... avec 12 autres réalisateurs.
Porté à bout de bras par le jeune acteur Damian Ul, tout juste âgé de 10 ans, le personnage de Stefek est le véritable moteur de cette chronique douce-amère. Se déroulant dans un tout petit village de la campagne polonaise, Tricks révèle le quotidien de nombreuses familles polonaises au travers de ce petit garçon et de sa quête pour réunir à nouveau ses parents.
Le réalisateur polonais réussit à proposer une tranche de vie captivante grâce à l'optimisme sans faille de son jeune personnage principal. L'histoire prend le temps de se mettre en place ainsi que ses différents intervenants. La tension et l'excitation sont palpables lors de la mise en oeuvre du plan de Stefek, pris au jeu que nous sommes de vouloir la réussite de ce petit bout plein de volonté.
Tricks ne révolutionne en rien le cinéma d'auteur mais apporte un bon de vent de fraîcheur où l'abnégation et la naïeveté prend le dessus sur la pauvreté et la misère du quotidien. La véritable révélation est le jeune Damian Ul, qui apporte une dimension supplémentaire à cette histoire de famille séparée. À découvrir sans crainte si vous êtes en manque d'une bonne dose de positivisme.
Á Retenir : des soldats qui montent la garde, un vendeur de pommes chanceux, un garçon qui n'a pas peur des trains, une voisine bimbo envahissante et une alfa romeo sensible aux besoins naturels.
Publié le 26 août 2008
Diplômé à l'IAD en réalisation, Hugues Lanneau a fait ses débuts à la RTBF. Il travaille sur plusieurs reportages et collabore à l'émission Moi, Belgique. Il réalise également deux documentaires avant de se lancer dans ce documentaire sur la déporation juive en Belgique.
Pour expliquer la mise en place de la persécution nazi en Belgique, Modus Operandi relate les faits chronologiquement. Le choix de ce fil conducteur tombe dans le sens et permet de se rendre compte comment les nazis ont pu profiter au fur et à mesure de l'aide des autorités belges mais aussi des Juifs eux-mêmes. Il apparait alors clairement comment, peu à peu, le système de persécution nazi a tissé sa toile en Belgique.
Toute la difficulté à réaliser ce documentaire est le manque de document sur cette déportation en Belgique. Hugues Lanneau a dû faire preuve d'imagination et de créativité pour ne pas rendre Modus Operandi indigeste. Entre les interviews et la narration des faits, de nombreuses animations photos viennent aider la mise en image de ces faits historiques.
Ce docu relate avec sobriété et profondeur ces événéments tragiques survenus en Belgique. Malgré le manque de matériel, Hugues Lanneau nous fait parfaitement prendre conscience comment les nazis ont su profiter l'outil politique belge pour, entre autres, recenser la population juive. Modus Operandi est tout simplement un outil important pour les générations de l'après seconde guerre mondiale.
Á Retenir : le logo de la SNCB, des hommes politiques sans conscience, des Juifs trop conciliants, des chiffres qui font froid dans le dos et un enfant accroché vainement à sa maman.
Publié le 25 août 2008
En 2004, Jason Reitman avait surpris tout son petit monde avec le corrosif Thank You For Smoking. Jason n'est autre que le fils d'Ivan Reitman, alias monsieur Ghostbusters. Trois ans plus tard, il revient avec cette comédie dramatique made in USA.
Politiquement incorrect, corrosif et surtout très grinçant, Jason Reitman avait charmé en imposant dès son premier film, un ton très personnel. Avec Juno, le réalisateur américain change de registre, avec une comédie plus sensible et sentimentale. Il s'attaque à l'âge bête de l'adolescence avec un regard moqueur mais compréhensif.
Sous ses apparences plus sages, Juno malmène nos ados en manque de repères. Aidé par le personnage de Juno, entre idéalisme et vulgarité, Jason Reitman réussit à imposer sa griffe sur un sujet au combien plus délicat. Au contraire de son film précédent où il ruait dans les brancards, sa réalisation se fait tout en retenue, par respect vis-à-vis de Juno, son personnage principal.
Même si la fin se veut un peu trop "à l'américaine", où tout est un peu trop édulcoré, Jason Reitman confirme ses talents de mise en image. De temps en temps, le ton corrosif de Thank You For Smoking nous manque mais Juno y gagne en subtilité et en sensibilité. La plus grosse satisfaction provient du fait que le cinéma américain ne s'est pas encore tout à fait replié sur la comédie lourdingue... ouf !
Á Retenir : des petites annonces inédites, un sprint en deux temps, des parents très baba cool, une militante anti-avortement fan des ongles et un adulte pas vraiment prêt à être père.
Publié le 21 août 2008
De nationalité australienne mais né à Macao en 1961, Tony Ayres a déjà réalisé plusieurs documentaires et courts métrages. En 2002, il réalise le drame Walking On Water. Cinq ans plus tard, il écrit et réalise une oeuvre plus personnelle, The Home Song Stories.
Sans être véritablement un film biographique, Tony Ayres s'inspire largement de sa jeunesse. Partagé entre les siens et son pays d'adoption, le réalisateur se souvient de son enfance difficile pour la développer au travers de cette histoire de jeune serveuse nomade à laquelle se raccrochent deux enfants en perte de repères.
Même si le personnage central de The Home Song Stories est Rose Hong, impeccablement interprétée par Joan Chen, l'enfance déracinée en ressort comme le thème principal. Au travers de cette chronique plus amère que douce, Tony Ayres focalise son attention sur les traces que laissent cette vie de nomades sur ces jeunes mômes, tributaires de l'instabilité d'une mère tout aussi perdue.
Avec une oeuvre aussi personnelle, le réalisateur australien secoue nos sentiments et nous empêche de rester un spectateur neutre. Tout au long du film, l'envie est grande de pénétrer au sein de cette famille perdue et de vouloir remettre de l'ordre pour le bien de ces enfants. The Home Song Stories est un film fort émotionnellement et laisse des traces dans nos esprits pendant quelques temps.
Á Retenir : un homme très joueur, un marin trop gentil, une belle-mère omniprésente, une mère un peu instable et des enfants qui ont beaucoup "d'oncles".
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ...
- 30