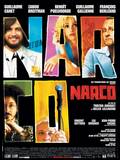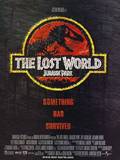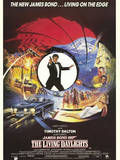tomurban
- Membre depuis le 18/06/2006
- Nombre de critiques : 136
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 28
Publié le 12 décembre 2006
Un comptable, type Américain bien tranquille, et sa toute jeune fille se voit accoster à leur descente à la gare par deux prétendus policiers. Ceux-ci prennent alors sa fille en otage et le soumettent à un odieux chantage. Il doit tuer une importante personnalité politique, qui doit prononcer une allocution pour sa campagne électorale dans l' un des plus grands hôtels de la ville, et ce avant midi. Faute de quoi sa fille mourra !... Dans cet excellent thriller, au suspens haletant, ponctué de rebondissements, au climat oppressant, efficace et sans temps mort, John Badham (à qui l' on doit aussi le "Dracula" avec Frank Langella ou "Drop zone" avec Wesley Snipes, entres autres) à su retrouver les ingrédients et la parfaite alchimie qui faisait toute l' efficacité des films de cinéastes comme Hitchcock. Comment éviter de ne pas se mettre à la place de cet homme (qui pourrait être n' importe qui d' entres-nous), père attentionné à la vie lisse et sans histoire, et qui bascule soudain en plein cauchemar. Ceci, par le simple fait qu' il été choisi au hasard par un homme et une femme chargé de faire éliminer une sénatrice devenue trop encombrante. Victime d' un jeu machiavélique qui le dépasse, Johnny Depp est en tous points excellents, à tel point que l' angoisse de son personnage, qui voit le compte à rebours mortel s' égrenner lentement devant ses yeux (à l' image des horloges qui apparaissent à intervalles régulières dans le film, telles les minuteries d' une bombe). Face à lui, en mettre d' oeuvre de cette sombre machination, Christopher Walken, habitué de ce genre de rôles et dont le physique colle à merveille au personnage, est lui excellent, et fait frissonner à chaque fois qu' il apparaît. Avec ce film, Hollywood a bien montré - un peu malgré lui - que, dans le thriller comme dans les autres genres, les vieilles recettes sont parfois les meilleures.

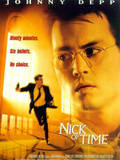
Publié le 12 décembre 2006
Belle comme Aphrodite, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, il n' est guère étonné que Liv Tyler, alias Jewell (autrement dit, bijou ou joyau en anglais, prénom on ne peut mieux choisi) arrive à mener tout son petit monde par le bout du nez. A commencer par le jeune et sémillant Matt Dillon, serveur dans le bar dont elle et son complice voulait vouler la caisse, avant qu' elle ne se ravise et que le jeune dindon de la farce ne l' abatte par amour pour elle. Ensuite, un policier (John Goodman), veuf inconsolable de la disparition de sa femme, qu' elle séduit à son tour pour se débarasser du précédent lorsque celui-ci commence à ne pas accepter ses caprices incessants, qui lui attire de plus en plus d' ennui. Et enfin, le meilleur ami du jeune barman, mari et père de famille respectable, qui est prêt à tout sacrifier d' un revers de main pour q' elle accepte de l' honorer ne serait-ce que d' un baiser. Pour completer sa palette de personnages, Michael Douglas, qui semble prendre plaisir à se parodier lui-même, en tueur à gages qui fixe ses contacts dans un club de bingo pour personnes du troisième âge... Les ennuis que cette femme fatale va provoquer - en toute connaissance de cause - dans la vie de ces trois hommes - victimes consentantes, malgré la réalité la plus évidente - ne vont pas tarder à leurs pleuvoir dessus comme de la grèle !... Les tribulations de ce "quatuor" déjanté, narré sur un rythme endiablé, et sans guère de temps mort et de répit pour les trois pigeons, qui ont même l' air de prendre souvent un certain plaisir à se laisser déplumés petit à petit. Le tout allant crescendo jusqu' à la scène de fusillade finale, sur fond de la musique des Village People, carabinée et déjantée à souhait. Cerise sur le gâteau d' une comédie délirante qui, par le talent des acteurs et la mise en scène plutôt bien inspirée, se hisse assez bien au-dessus de ce qui se fait aujourd' hui en la matière.
Publié le 12 décembre 2006
La narcolepsie dont souffre Gustave Klopp (Guillaume Canet) lui gâche la vie. Cette maladie fait, en effet, qu' il perd connaissance n' importe où et n' importe quand. Ce qui le met dans l' impossibilité de mener une vie de famille stable (entre un vieux père infirme et ancien glandeur professionnel, une femme lassée par ses crises de sommeil répétitives et qui commence à ne plus pouvoir supporter cette vie, et un beau-fils qui le considère depuis toujours comme le roi des nuls) et de garder un emploi plus de quelques jours. Deux choses seulement parviennent à estomper la griserie de son quotidien: son meilleur - et seul - ami, Lenny Barr (Benoït Poelvoorde, excellent comme toujours), qui idôlatre Jean-Claude Van Damme (qui fait d' ailleurs une courte apparition dans le film) et ambitionne de devenir le plus grand karetéka du mode. Et un véritable don qu' il possède pour le dessin. Ainsi, lors de ses crises de narcolepsie, Klopp se retrouve plongé dans des mondes imaginaires, dont il se sert comme inspiration pour en faire des bandes dessinées... Mais voilà que son psychiatre, sa femme et son ami, prenant conscience que ce don pourrait consistuer une véritable poule aux oeufs d' or, décide alors de le mettre sur la touche (à l' aide d' un duo frère et soeur patineurs, qui manient le flingue aussi bien que le patin à glace) et de lui voler le fruit de son talent... Fonctionnant à la fois sur le registre de l' humour caustique et le ton doux-amer, le style et le sujet ne sont pas sans rappeler les comédies de Capra. Si il n' en a pas l' ambition et le but moraliseur, "Narco" n' en est pas moins uneillustration à la fois humouristique et lucide sur ce genre de maux sans gravités physiques mais qui gâche néanmoins la vie quotidienne de ceux qu' elles affectent. C' est aussi le plaisir de voir un duo Canet-Poelvoorde mitonné aux petits oignons et qui fonctionne à merveille, avec un rôle atypique pour le premier et un autre taillé sur mesures pour le second. De la très bonne comédie.
Publié le 2 décembre 2006
Suite du célèbre "Jurassic Park", qui est ici aussi une adaptation d' un roman éponyme de Michael Crichton (le sous-titre Jurassic Park servant, outre à faire la filiation avec le premier film, à ne pas les confondre avec un autre roman du même nom, écrit par Conan Doyle - le créateur de Sherlock Holmes, et qui connut lui aussi une adaptation à l' écran). Le succès phénoménale que rencontra le film de Spielberg à sa sortie fit consacra également celui du roman dont il s' inspirait. Et nul doute que ce fut l' une des raisons principales qui poussèrent le romancier à donner une suite à son histoire. Et à insciter, de son côté, la productrice Kathleen Kennedy à pousser Spielberg (qui, en plus d' être le réalisateur de "Jurassic Park", en était aussi le co-producteur) a continuer sur sa lancée. Ce n' est pas la première qu' une suite a été donnée à l' un des films de Spielberg. On se souvient que le succès, en 1975, des "Dents de la mer", avait donné naissance à trois suites successives (qui ne faisaient pas vraiment honneur à leur aîné), mais que Spielberg avait, prudemment, décliné l' offre de réaliser le second volet (et, au vu du résultat, il a peut-être eu raison). Ici, par contre, il s' est laissé prendre au piège. Peut-être par ce qu' il était convaincu que, pour que cette suite soit digne du premier film et donc la plus réussie possible, il fallait que lui, comme Kathleen Kennedy, reste aux commandes. Si "Le monde perdu" porte bien, du début à la fin, le style bien caractéristique de Spielberg, on n' est, en revanche, pas tout-à-fait sûr qu' un autre réalisateur aurait forcément moins bien fait que lui (Jurassic Park III, réalisé par Joe Johnston - le réalisateur de Jumanki - en 2001, ayat bien montré que Spielberg, aussi talentueux soit-il, n' était pas irremplacable). Ici, plus encore qu' avec "Jurassic Park", Spielberg et son scénariste David Koepp prennent assez bien de libertés avec les écrits de Crichton (la scène d' ouverture, où une jeune fille est attaquée sur la plage par une bande de petits dinosaures étant tirée du premier roman), et y ont apportés de nombreux changements (par exemple, les personnages de Ludlow, le neveu de John Hammond, et celui du chasseur Roland Tembo ne figuraient pas dans le roman, tandis que d' autres qui y étaient se trouvent supprimés dans le film). Mais, il reste encore suffisamment d' éléments du roman de Crichton pour dire considérer que le roman a bien, directement, servi de base au scénario du film. Pour ce qui est des personnages du film, comme dans presque toutes les suites, certains disparaissent, d' autres les remplacent, et certains restent. Ici, seuls Jeff Goldblumm et Richard Attenborough sont toujours de la partie (hormis Joseph Mazello et Ariana Richards, les petits-enfants de John Hamond, qui apparaissent dans une courte scène). A la différence du premier opus, ici les personnages sont un peu moins travaillés et manquent parfois de profondeur, l' accent étant plutôt mis sur les dinosaures que sur les acteurs humains. L' histoire, si elle est assez prévisible (même pour ceux qui n' ont pas lus le roman), reste néanmoins suffisamment captivante pour réjouir tous les fans des dinosaures, et maintenir l' intérêt et l' attention du spectateur jusqu' à la fin. Justement, celle-ci déçoit quelque peu. C' est sans-doute la partie la moins réussie du film (un Tyrannosaure est ramené par bateau sur le continent, mais il s' échappe à son arrivée et se met à semer la terreur dans la ville de San Diego) rappele trop les films catastrophes des années 50 et 60 (les premiers films de Godzilla, par exemple) et il faut reconnaître qu' on a connut Spielberg plus inspiré. Heureusement, cela ne nuit pas au reste du film et ne l' empêche pas d' être, globalement, assez réussi. Une suite qui, on l' aura compris, n' est pas absolument indispensable (comme la grande majorité des suites), surtout pour les admirateurs de Spielberg, mais qui, pour les fans de dinos et du premier film, se regarde avec un plaisir certain.
Publié le 2 décembre 2006
Premier James Bond pour Timothy Dalton, et dernier pour John Barry, le compositeur "attitré" de la série (on lui doit la musique de onze des quinze films des aventures de 007, de 1963 à 1987). Ici, Bond a pour mission d' assurer le transfert et la protection d' un officier du KGB. Mais, lorsque celui-ci est, malgré tout, enlevé, Bond, au contraire de son supérieur, commence à flairer que ce transfuge jouait peut-être bien un double-jeu... Dans le rôle des mauvais, Jerroen Krabbé (le faux-transfuge de l' Est), s' il n' est pas vraiment ce qu' on pourrait appeler un grand acteur, a en tout cas la tête de l' emploi, et c' est assez bien suffisant pour que l' on croit à son personnage. Dans celui du trafiquant d' armes Brad Withaker, le bedonnant Joe Don Baker (qui reprendra également du service, dans le rôle de l' agent de la CIA Jack Wade, dans "Goldeneye" et "Demain ne meurt jamais", aux côtés de Pierce Brosnan) est lui bien plus convaincant, même si les traits de son personnage paraissent quelque peu forcés. Par rapport à ces prédecesseurs (le charismatique Sean Connery, l' aristocratique Roger Moore et le tranquille et effacé George Lazenby), Timothy Dalton est sans-doute le plus "sportif et viril" de ceux à avoir incarnés l' agent 007. Bien plus à l' aise à tenue de moudjhaidin qu' en smoking, ce qu' il perd en charisme, il le regagne en efficacité dans les scènes d' action. Sa partenaire, Myriam D' Abo, quant à elle, est suffisamment jolie et charmante pour qu' on croit en sa capacité de séduction (surtout envers un grand amateur de femmes comme James Bond), mais elle n' en a pas pour autant laissée de souvenirs impérissables au sein des fans de la série. C' est donc surtout par l' efficacité de l' interprétation de Dalton et de la réalisation de John Glen (qui en est ici à son quatrième James Bond, depuis "rien que pour vos yeux" en 1981; et qui en signera un cinquième et dernier, "Permis de tuer", en 1989) qui font la force et la réussite du film. Ainsi que les scènes de combats et de poursuites, et les gadgets (l' Aston Martin Vantage, descendante directe de la DB5 de Sean Connery dans "Goldfinger"; et le porte-clés explosif), très bien imaginés et réussis eux-aussi. Si le film ne figure pas vraiment parmis les plus admirés en encensés, parmis les admirateurs de James Bond, il gagne pourtant à être redécouvert, et peut figurer à bon droit parmis les meilleurs de la saga 007.
- Page précédente
- Page suivante
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 28