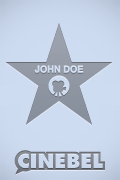Actualités
Nicolas Provost, porte-parole du politiquement incorrect: entretien
Publié le 23 novembre 2011 dans Cinéphiles

Présenté à Gand, “L’envahisseur” a reçu un accueil très positif. Sûr de lui, le jeune cinéaste flamand défend sa vision d’un
cinéma “arty”.
Votre film parle de l’étranger ou de l’étrangeté. Vous avez vécu 10 ans en Norvège… Avez-vous connu ce sentiment ?
Mes films préférés sont des films d’antihéros, d’outsiders, qui cherchent leur place dans le monde, doivent se battre avec la société et avec leurs propres démons. Qui, avec un petit zeste d’héroïsme, essayent de changer le monde. Ce sont pour moi les plus belles histoires, les plus humaines. Je me suis toujours senti un peu comme ça. Ça a peut-être débuté avec Renaix, une ville un peu schizophrène, flamande et francophone. Mes études m’ont emmené par hasard en Norvège, un pays difficile à intégrer, car les gens y sont très fermés. J’ai appris la langue, mais je me suis quand même senti étranger pendant 10 ans. Même si j’y ai été très heureux, il y a eu des moments où j’ai connu la vraie solitude. J’ai connu ce sentiment d’outsider dans l’art aussi. Quand j’ai commencé il y a 10 ans, j’ai dû creuser mon trou dans le marché pour pouvoir faire des films en tant qu’artiste visuel.
Vous sentez-vous plus artiste ou cinéaste ?
Je me sens artiste visuel avant d’être cinéaste. Mais c’est finalement la même chose. Ce que je fais, c’est jouer avec les codes du cinéma. Quand tu travailles avec le langage cinématographique, chaque seconde doit être du cinéma...
En passant au long métrage, votre travail a-t-il été radicalement différent ?
Non. La seule différence, c’est que les œuvres plus courtes, je peux les travailler comme une sculpture. Je prends des éléments d’autres films, ou je les fabrique moi-même, et je commence à sculpter avec le son et l’image, jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose d’intéressant, un concept qui naisse. Alors, je cherche à ce que cette courbe de tension dure le plus longtemps possible, que ce soit une minute ou 20 minutes. Avec le long, on sait qu’on a une contrainte : remplir 90 minutes. Le fait de devoir passer par une histoire plus structurée n’est qu’un autre challenge.
Avez-vous cherché à équilibrer les approches artistique et cinématographique ?
Je voulais faire un film grand public, accessible. J’ai donc choisi une histoire très simple, avec des personnages archétypaux pour créer de l’espace où infiltrer ma poésie, jouer avec les codes, l’image, l’esthétique, les références au cinéma. Un espace où je puisse colorier les personnages archétypaux au départ en personnages de sang et de chair.
Pourquoi cette première scène choc en référence à “L’origine du monde” ?
Je voulais montrer immédiatement qu’il ne s’agissait pas d’un énième portrait sentimental sur la politique d’immigration. Je ne veux pas faire de politique. Je voulais oser prendre ce sujet et le raconter d’une autre manière, de mettre le sentimental et le politique en arrière-plan et mettre en avant l’antihéros, comme dans un western. Oser faire du héros un monstre. Parce que je trouve que le monde aujourd’hui est devenu très politiquement correct. Cette première scène, c’est d’abord comme une pub pour l’Europe, mais c’est aussi un genre de rêve. Pour moi, un bon film, comme ceux d’Hitchcock ou de Kubrick, est comme un rêve. Et un bon rêve, c’est quand la frontière entre rêve et cauchemar est très mince. C’est ça que je voulais dans cette scène. Qu’on ne sache pas si la femme qu’il rencontre est un ange ou un ange de la mort. J’ai choisi Courbet pour plusieurs raisons. Parce que le vagin représente le fait que son histoire à lui est née de la femme. C’est aussi ce qu’il cherche; il vient en Europe pour trouver le bonheur et donc l’amour, et il se voit tomber immédiatement sur ce qu’il veut. Cela va lui échapper, et il ne va plus jamais le retrouver. Et puis, Courbet parce que ce qu’il voulait faire avec ce tableau réaliste, en 1866, c’était aller contre le politiquement correct de l’Académie.
Plus le film avance, moins le héros a de gestes humains, plus il devient monstrueux. C’est une vision inquiétante du migrant…
Je trouve qu’il reste humain jusqu’à la fin. Je ne veux pas le juger. Quand je dis que j’en fais un monstre, O.K., mais je ne veux pas nous juger ou juger les immigrés. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a un sérieux problème, que ça va exploser parce qu’on ne peut pas en parler. C’est un clash de cultures. Qui suis-je moi pour juger l’un ou l’autre ? C’est une tragédie.
Hubert Heyrendt
Mes films préférés sont des films d’antihéros, d’outsiders, qui cherchent leur place dans le monde, doivent se battre avec la société et avec leurs propres démons. Qui, avec un petit zeste d’héroïsme, essayent de changer le monde. Ce sont pour moi les plus belles histoires, les plus humaines. Je me suis toujours senti un peu comme ça. Ça a peut-être débuté avec Renaix, une ville un peu schizophrène, flamande et francophone. Mes études m’ont emmené par hasard en Norvège, un pays difficile à intégrer, car les gens y sont très fermés. J’ai appris la langue, mais je me suis quand même senti étranger pendant 10 ans. Même si j’y ai été très heureux, il y a eu des moments où j’ai connu la vraie solitude. J’ai connu ce sentiment d’outsider dans l’art aussi. Quand j’ai commencé il y a 10 ans, j’ai dû creuser mon trou dans le marché pour pouvoir faire des films en tant qu’artiste visuel.
Vous sentez-vous plus artiste ou cinéaste ?
Je me sens artiste visuel avant d’être cinéaste. Mais c’est finalement la même chose. Ce que je fais, c’est jouer avec les codes du cinéma. Quand tu travailles avec le langage cinématographique, chaque seconde doit être du cinéma...
En passant au long métrage, votre travail a-t-il été radicalement différent ?
Non. La seule différence, c’est que les œuvres plus courtes, je peux les travailler comme une sculpture. Je prends des éléments d’autres films, ou je les fabrique moi-même, et je commence à sculpter avec le son et l’image, jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose d’intéressant, un concept qui naisse. Alors, je cherche à ce que cette courbe de tension dure le plus longtemps possible, que ce soit une minute ou 20 minutes. Avec le long, on sait qu’on a une contrainte : remplir 90 minutes. Le fait de devoir passer par une histoire plus structurée n’est qu’un autre challenge.
Avez-vous cherché à équilibrer les approches artistique et cinématographique ?
Je voulais faire un film grand public, accessible. J’ai donc choisi une histoire très simple, avec des personnages archétypaux pour créer de l’espace où infiltrer ma poésie, jouer avec les codes, l’image, l’esthétique, les références au cinéma. Un espace où je puisse colorier les personnages archétypaux au départ en personnages de sang et de chair.
Pourquoi cette première scène choc en référence à “L’origine du monde” ?
Je voulais montrer immédiatement qu’il ne s’agissait pas d’un énième portrait sentimental sur la politique d’immigration. Je ne veux pas faire de politique. Je voulais oser prendre ce sujet et le raconter d’une autre manière, de mettre le sentimental et le politique en arrière-plan et mettre en avant l’antihéros, comme dans un western. Oser faire du héros un monstre. Parce que je trouve que le monde aujourd’hui est devenu très politiquement correct. Cette première scène, c’est d’abord comme une pub pour l’Europe, mais c’est aussi un genre de rêve. Pour moi, un bon film, comme ceux d’Hitchcock ou de Kubrick, est comme un rêve. Et un bon rêve, c’est quand la frontière entre rêve et cauchemar est très mince. C’est ça que je voulais dans cette scène. Qu’on ne sache pas si la femme qu’il rencontre est un ange ou un ange de la mort. J’ai choisi Courbet pour plusieurs raisons. Parce que le vagin représente le fait que son histoire à lui est née de la femme. C’est aussi ce qu’il cherche; il vient en Europe pour trouver le bonheur et donc l’amour, et il se voit tomber immédiatement sur ce qu’il veut. Cela va lui échapper, et il ne va plus jamais le retrouver. Et puis, Courbet parce que ce qu’il voulait faire avec ce tableau réaliste, en 1866, c’était aller contre le politiquement correct de l’Académie.
Plus le film avance, moins le héros a de gestes humains, plus il devient monstrueux. C’est une vision inquiétante du migrant…
Je trouve qu’il reste humain jusqu’à la fin. Je ne veux pas le juger. Quand je dis que j’en fais un monstre, O.K., mais je ne veux pas nous juger ou juger les immigrés. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a un sérieux problème, que ça va exploser parce qu’on ne peut pas en parler. C’est un clash de cultures. Qui suis-je moi pour juger l’un ou l’autre ? C’est une tragédie.
Hubert Heyrendt