La Religieuse portugaise
Titre original: A Religiosa Portuguesa
Réalisateur:
Origine:
- Portugal
Genre:
- Drame
Année de production: 2009
Durée: 2h07
Synopsis :
Hommes et femmes s'imaginent une vie, se battent pour la construire au mieux. Et souvent, leur destin bascule sur une simple rencontre. Julie qui sort d'une histoire d'amour compliquée est heureuse de pouvoir s'exiler au Portugal pour tourner un long-métrage austère où elle incarne une religieuse. Le soir, elle croise des inconnus qui nourrissent son expérience. Une nuit, elle remarque une nonne, isolée dans une chapelle, et va lui parler.

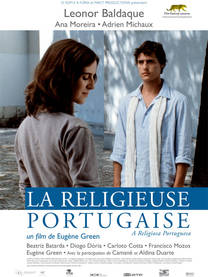

VictorB