L'Incroyable vérité
Titre original: The Unbelievable Truth
Réalisateur:
Origine:
- États-Unis
Genres:
- Comédie dramatique
- Romance
Année de production: 1989
Durée: 1h30
Synopsis :
Josh Hutton, après un séjour en prison pour meurtre, retourne dans son village natal. Il rencontre Audry, toute jeune fille avec laquelle il sympathise. Elle lui propose de travailler pour son père qui tient un garage. Excellent mécanicien, il l'embauche, mais il voit d'un mauvais oeil Josh tomber peu à peu sous le charme de sa fille.
Horaire du film L'Incroyable vérité
CINEMATEK
Bruxelles
| Dates | Versions | Formats | Formats | Heures |
|---|---|---|---|---|
| mardi 24/02 | VO S.t. fr/nl | Dig |
21:15
|

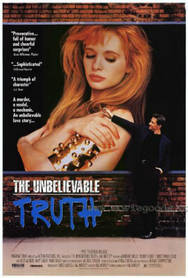

VictorB